#fils et filles de louis xiv
Text

Marie-Anne de Bourbon (1666-1739). Atelier de Hyacinthe Rigaud.
#hyacinthe rigaud#royaume de france#maison de bourbon#marie anne de bourbon#mademoiselle de blois#blois#fils et filles de france#fille de france#royal bastards#fille légitimée#fils et filles de louis xiv#princesse de conti#bourbon conti#maison de conti#duchesse de La Vallière#duchesse de Vaujours#kingdom of france#house of bourbon
6 notes
·
View notes
Text

Portrait of Louise Françoise de Bourbon (1673-1743), wife of Louis, Prince de Condé (1668-1710). Unknown artist.
#royaume de france#maison de bourbon#Légitimée de France#fils et filles de louis xiv#royal bastards#mademoiselle de nantes#princesse de condé#bourbon condé#duchesse de bourbon#duché de bourbon#kingdom of france#house of bourbon#royalty
0 notes
Text
Marie Leszczynska (1703-1768)
Ou celle dont Evelyne Lever dit que si on ne parle pas d’elle, c’est parce qu’elle n’a rien fait de mal

Marie Leszczynska est une figure oubliée de l’Histoire de France et je tiens à vous le dire de suite : les personnages historiques oubliés, c’est ma passion secrète ! Et en plus, Marie est polonaise et étant d’origine polonaise par ma mère (mes arrières arrières grands-parents ont fui le pays pour ne pas mourir de faim), je me dois donc doublement de vous évoquer Marie surnommée « Notre Bonne Reine » par le peuple français !
Notre chère Marie est née le 23 juin 1703 à Trebnitz, en basse Silésie, de Stanislas Leszczynski (1677-1766) et de Catherine Opalinska (1680-1747). Je vous entends me dire : « Mais Marina, c’est Marie Leszczynska alors pourquoi son père c’est Leszczynski ? » Oui, je vous entends de très très loin, j’ai une excellente ouïe. C’est parce qu’en polonais (et en russe aussi), on accorde les noms de famille.
Marie naît de Stanislas qui sera un éphémère roi de Pologne avant d’être chassé du pouvoir. D’ailleurs, pour l’anecdote, au moment de fuir, les servantes ont failli oublier la petite fille et ce n’est que parce qu’une domestique a vu un tas de linge bouger qu’elle a réalisé qu’on allait un petit peu laisser un bébé d’environ 1 an derrière alors que ses parents sont boutés hors de leur palais… Marie suit donc ses parents en exil. La famille finira par pouvoir s’installer en Alsace. Le 20 juin 1717, elle a le malheur de perdre sa sœur Anne, alors âgée de 18 ans, de maladie et son
père en a été tellement affligé qu’il a demandé à sa cadette de ne pas mentionner l’aînée. Marie, en fille obéissante, la mentionnera si peu que son époux, Louis XV, découvre qu’elle n’est pas fille unique bien des années après le mariage !
Le mariage, parlons-en !
Si Marie épouse le roi Louis XV (1710-1774), ce n’est que par un concours de circonstances. Louis XV est le dernier héritier de Louis XIV (1638-1715) : en effet, le Roi Soleil a eu le malheur d’enterrer tous les enfants qu’il a eus avec Marie-Thérèse d’Autriche (qui était espagnole!), il a perdu presque tous ses petits-fils à l’exception de Philippe qui est devenu roi d’Espagne après la guerre de Succession d’Espagne, récupérant ainsi le trône de Tonton Charles II (1661-1700) mais perdant ainsi ses prétentions au trône de France, et parmi ses arrières petits-enfants, seul Louis a
survécu… parce que sa nourrice, Madame de Ventadour, « Maman Ventadour » comme il l’a si joliment surnommée, a refusé de laisser le bébé de deux ans auprès de médecins qui ne font que des saignées et a soigné le garçonnet elle-même ! Alors, certes, si Louis meurt sans héritier, ça passe à la branche cousine des Bourbon, les Orléans, qui descend de Philippe de France (1640-1701), le
frère de Louis XIV. D’ailleurs, le fils de Philippe, Philippe de France (non, je ne me trompe pas, il a vraiment appelé son fils comme lui), a été le Régent durant la minorité du roi.
Louis XV est déjà fiancé à la princesse espagnole Marie-Anne Victoire (1718-1781). Le souci, c’est qu’avec la différence d’âge, Louis est prêt à faire des enfants mais Marie-Anne, elle, bah… elle a genre sept ans. Et on ne peut pas attendre. Donc, on dresse une liste des princesses à marier en Europe puis on écrème. Celle-là est trop jeune, celle-là est trop vieille, celle-là est protestante et on n’a pas envie de s’emmerder avec une conversion, celle-là est anglaise beurk ! Oui, on se croirait
sur Tinder. Comme quoi, on n’a rien inventé. Sauf qu’à force d’écrémer, sur la liste d’une centaine de noms, il n’en reste plus que deux… avec, notamment, Marie, qui n’est pas retenue de suite.
Et Marie, ils vont revenir sur sa candidature : elle est catholique donc pas besoin de la convertir. Elle a sept ans de plus que le roi donc elle est déjà fécondable. Elle a une bonne éducation. Et elle est plutôt jolie, et si les portraits laissés plus tard par Nattier sont fidèles, elle était en effet une jolie femme. Le seul souci, c’est sa parenté un peu faiblarde, surtout qu’il va falloir rehausser le statut du beau-père mais ça, ça peut se faire !
La Princesse Palatine écrit ceci concernant le choix de la fiancée :
« J’avoue que pour le Roi, dont le sang était resté le seul pur en France, il est surprenant que l’on lui fasse faire une pareille mésalliance et épouser une simple demoiselle polonaise, car […] elle n’est pas davantage, et son père n’a été roi que vingt-quatre heures. » Tout cet épisode est repris dans le roman L’Echange des Princesses de Chantal Thomas, lequel a été adapté en film du même nom.
C’est donc par second choix que Marie épouse Louis XV le 15 août 1725 par proxy.
Le mariage par proxy est une cérémonie durant laquelle on « épouse » son futur époux… sauf qu’il n’est pas physiquement présent. Le futur marié reste chez lui et c’est quelqu’un qui prend sa place et le représente. Les mariés ne se rencontrent réellement qu’une fois la dame arrivée dans son nouveau pays. Marie et Louis se rencontrent vraiment le 04 septembre 1725. Le roi est alors un adolescent de 15
ans avec tout ce qui en découle. Il tombe raide dingue de sa Polonaise ! Il se vantera de l’avoir honorée sept fois lors de la nuit de noces ! Vérité ou bien mensonge un peu gras, toujours est-il qu’il l’honorera très souvent puisqu’ils auront ensemble dix enfants et la première grossesse a été gémellaire ! Ce qui lui fera dire « On avait dit que je ne pouvais pas avoir d’enfant, eh bien j’ai fait coup double » !
Ensemble, ils ont eu :
Louise-Elisabeth (1727-1759), la seule fille du couple qui sera mariée. Sa fille Isabelle sera la première épouse de Joseph II, le frère de Marie-Antoinette. Son fils Ferdinand sera duc de Parme et épousera Marie-Amélie, la sœur de Marie-Antoinette (oui, encore!). Quant à Marie-Louise, elle sera reine d’Espagne et l’ancêtre de l’actuel roi Felipe VI ;
Anne-Henriette (1727-1752). Elle a un rôle assez important dans le téléfilm « Jeanne Poisson, marquise de Pompadour » ;
Marie-Louise (1728-1733) ;
Louis-Ferdinand (1729-1765) , père des futurs Louis XVI, Louis XVIII et Charles X ;
Philippe-Louis (1730-1733) ;
Adélaïde (1732-1800). Son personnage sera assez présent dans les débuts du manga et de l’anime Lady Oscar ;
Victoire (1733-1799) Son personnage sera assez présent dans les débuts du manga et de l’anime Lady Oscar ;
Sophie (1734-1782). Son personnage sera assez présent dans les débuts du manga et de l’anime Lady Oscar ;
Thérèse-Félicité (1736-1744) ;
Louise-Marie (1737-1787). Elle deviendra nonne et priera tout le reste de sa vie pour le salut de l’âme de son père, libertin notoire.
Comme vous pouvez le constater, dix enfants en dix ans, ce qui fait que Marie dira un jour : « Eh quoi ! Toujours grosse, toujours couchée, toujours accouchée ! »
Au début, le mariage est assez heureux et Louis reste fidèle, ce qu’il faut souligner quand on sait son appétit sexuel et de qui il descend (Henri IV, le Vert Galant, ou bien le chaud du slip, à vous de voir!). Mais peu à peu, les maîtresses s’enchaînent , notamment quatre des cinq sœurs de Nesle (la fidélité!) et surtout l’iconique Madame de Pompadour (1721-1764). Les infidélités commencent alors que Marie refuse sa couche à Louis : apparemment, suite à une fausse couche, on dit carrément dit à la reine qu’un onzième enfant, ça la tuerait et comme elle n’a
pas trop envie de mourir mais qu’elle est timide, elle ferme sa porte de sa chambre à son époux, sans lui dire pourquoi… Du coup, Louis, il va voir ailleurs. Ca et la différence d’âge qui se fait sentir : de sept ans son aînée, Marie fait vite mature et matrone quand lui, en bien, c’est un jeune adulte qui a envie de profiter des plaisirs de la vie, surtout que profiter l’aide à lutter contre sa tendance dépressive.
Marie ferme les yeux sur les incartades de son mari, se consacre à ses enfants, notamment à son fils survivant qui est l’héritier au trône et dont elle souhaite mater le caractère un peu trop fort. Elle sera très proche de ses enfants et ses enfants lui seront loyaux. Adélaïde, notamment, pour défendre sa mère, appelle Madame de Pompadour « Madame Putain ».

Sauf que vous vous doutez bien, une femme pareille dans le cloaque de vices de Versailles, ça détonne et donc, on se moque d’elle… sauf Madame de Pompadour qui enjoint le roi à passer plus de temps avec sa femme et qui met un point d’honneur à toujours la respecter ! Marie apprécie cela et les deux femmes ont une relation cordiale, presque amicale à la vérité, comme cela sera repris dans le téléfilm français « Jeanne Poisson, marquise de Pompadour », que j’ai déjà cité mais c’est
parce qu’il est super bien fait ! Et puis merde, Charlotte de Turckheim dans le rôle de Marie, pardon du peu !
Sur le plan politique, Marie a peu d’influence sur le roi. Au début de leur mariage, elle a essayé mais s’y est tellement mal prise que dès lors, Louis l’a complètement écarté de ses réflexions. Il faut dire que Marie voulait aider le duc de Bourbon, lequel avait favorisé son mariage, n’écoutant pas en cela les objections de son père. Elle a convoqué son mari dans ses appartements afin de lui demander de conserver le ministère du Duc. Sauf que ça va à l’encontre de l’Etiquette et Louis, seize ans et qui n’aime pas le conflit, le prend un peu mal. Tant pis !
Marie s’efforce donc d’être une bonne reine : gentille, douce, pieuse, charitable… et cela fonctionne puisque le peuple la surnomme « Notre Bonne Reine ». Elle accomplit son devoir de représentation à la perfection et vit son autre vie tranquille, loin des ambitieux, entourée de sa famille et de ses amis.
Hélas, sa vie n’a pas été des plus heureuse : comme vous l’aurez vu, elle a eu à enterrer beaucoup de ses enfants, souvent dans l’enfance, d’autres adultes. La mort de son fils, en 1765, est un coup extrêmement rude pour elle comme pour Louis : le nouveau dauphin, le futur Louis XVI (1754-1793) n’a alors que onze ans. Puis, deux mois plus tard, c’est son père qui meurt d’une manière absolument effroyable : le
peignoir de l’octogénaire prend feu à cause de sa cheminée et si on lui porte secours, il meurt de ses blessures des jours plus tard.
Marie meurt deux ans plus tard, le 24 juin 1768, le lendemain de son anniversaire, à l’âge de 65 ans. Louis sera profondément affecté par le décès de son épouse et s’il aura une dernière grande histoire d’amour avec Madame du Barry (1743-1793), il ne se remariera jamais et ce malgré les pressions du gouvernement. Elle laisse aux français le souvenir d’une personne qui s’est sincèrement souciée de leur sort.
Les punchlines de Marie :
« Il vaut mieux écouter ceux qui nous crient de loin : Soulagez notre misère, que ceux qui nous disent à l’oreille : Augmentez notre fortune. »
« C’est une chose sotte que d’être reine ! Pour peu que les troubles continuent, on nous dépouillera bientôt de cette incommodité. » (quand on sait que la Révolution arrive, on se demande si Marie n’est pas voyante)
« Je n’ai pas besoin de robes quand les pauvres n’ont pas de chemises. »
« La miséricorde des rois est de rendre la justice, mais la justice des reines est d’exercer la miséricorde. » À Louis XV, pour demander la grâce d’un déserteur.
« Tout le bien d’une mère n’appartient-il pas à ses enfants ? » À son trésorier, qui jugeait ses aumônes excessives
Si toi aussi tu veux en lire plus sur Marie, tu peux aller regarder ces sources :
Marie Leszczynska par Jacques Levron
La Reine et la Favorite, Marie Leszczynska, Madame de Pompadour d’Evelyne Lever
Marie Leszczyńska, épouse de Louis XV d’Anne Muratori-Philip
Les femmes de Louis XV DE CÉCILE BERLY
LOUIS XV ET MARIE LECZINSKA D’APRÈS DE NOUVEAUX DOCUMENTS DE PIERRE DE NOLHAC
Billet de Marina Ka Fai
1 note
·
View note
Text
Tartuffe - Molière
Ah là, Tartuffe ! LA pièce la plus controversée de notre cher Molière. L'histoire, subversive pour l'époque, nous semble assez banale aujourd'hui. Nous sommes dans une maison, parisienne sûrement, bourgeoise ; dans cette maison, une famille au bord de l'implosion (mots d'Eric Ruf, que je trouve assez justes).
Une belle-mère pour certains, une mère pour d'autres, une grand-mère pour la plupart, sort, furieuse. La raison de sa colère ? Sa famille n'est pas assez sainte. Madame Pernelle, vénérable ancêtre, trouve sa belle-fille Elmire trop dépensière ; Cléante, le frère d'Elmire, ne devrait pas vivre chez eux ; Damis, le fils d'Elmire, est sot ; Mariane, la fille d'Elmire, pourrait mal tourner ; Dorine, la suivante de Mariane, se mêle de tout. Le fils de Mme Pernelle, Orgon, est le seul qu'elle ne blâme pas, car il a accueilli "un saint homme" dans la maison.
Réunion de famille, plus personne ne supporte "cet odieux personnage" qui semble tout régenter au lieu du patriarche. Valère, un jeune homme, souhaite épouser Mariane, on le lui a promis, ils s'aiment. Seulement, Orgon veut renforcer la place qu'a prise Tartuffe dans la famille, et le marier à sa fille au lieu de Valère. Révolte de toutes parts, Dorine travaille dans leur sens.
Apparaît Tartuffe, qu'on a tant et tant décrit de manière peu flatteuse pour la plupart, qui commence par s'entretenir avec Elmire, qui elle souhaite le convaincre de convaincre Orgon de renoncer à lui donner Mariane. Il lui avoue ici ces sentiments (dans une des plus belles déclarations d'amour que j'ai jamais lues d'accord ?). Damis a tout entendu, essaye de le dénoncer à son père, mais Orgon ne le croit pas, et le ton monte au point que le fils est chassé de la maison et déshérité.
Elmire élabore un plan pour qu'Orgon comprenne enfin la duplicité de son prétendu ami. Caché sous une table, le père va assister à l'étalage du mensonge de Tartuffe : Orgon l'ayant fait son légataire universel, il possède la maison ; il veut Elmire en plus du reste. Le faux dévot révèle alors son vrai visage ; et il aurait presque pu gagner, si l'intervention légèrement deus ex machina du Roi ne l'envoyait pas en prison pour défaire tous les nœuds.
Si les personnages sont globalement fidèles à eux-mêmes, chacun ayant son bon rôle moliérien, la servante maligne, la fille et son amant, la femme inventive, le fils contre son père, le frère raisonnable, deux personnages semblent plus complexes. Orgon peut être représenté de deux façons, soit comme un vieillard qui ne sait plus trop ce qu'il fait et se voue complètement à Tartuffe par stupidité ou énorme manque de jugement ; soit comme un homme dont on complètement retourné le mode de pensée, qui devait avoir une blessure ou une fragilité antérieure dans laquelle Tartuffe s'est engouffrée.
Derrière tout ça, la figure dont on parle tant (et qu'on ne rencontre qu'à l'acte III!), Tartuffe. Menteur, manipulateur, faux dévot utilisant la religion pour servir ses intérêts et justifier tout et n'importe quoi auprès de ceux qui le croient. Figure aujourd'hui proverbiale de l'hypocrisie religieuse, il a fait beaucoup de bruit lors de la sortie de la pièce : le parti dévot, puissant sous Louis XIV, n'a pas supporté qu'on les moque ainsi. Les grenouilles de bénitier n'auraient-elles pas apprécié qu'on jette un pavé de vérité dans leur mare ? Toujours est-il que Tartuffe est ce personnage trouble, toujours dans une double énonciation. On le dit recueilli par Orgon, pauvre enguenillé, sûrement maigre comme un squelette. Fatale ironie du sort, Orgon le premier a fait preuve de charité chrétienne. Aujourd'hui apparemment indéboulonnable de sa chambre à l'étage, il est devenu celui qui murmure à l'oreille d'Orgon, son "maître à penser". Pour le chef de maison, Tartuffe est "son frère", un ami véritable, qui n'a que l'intérêt des autres en tête, c'est cette confiance aveugle qui le poussera à aller à l'encontre de tous les siens jusqu'à ce qu'on lui prouve longuement la duplicité de son protégé.
Mais impossible d'envisager le personnage de Tartuffe sans prendre en compte l'interprétation que le comédien en fait.
Alors bienvenue dans Télé-théâtre, histoire de comparer les différentes versions de ce rôle. (Tumblr étant ce qu'il est, les visionnages de ces différentes versions se feront en posts séparés, et taggés "tartuffe")
1 note
·
View note
Photo

LES LUMIÈRES DE VERSAILLES #leslumièresdeversailles 5 septembre 1725 Le mariage polonais de Louis XV Le 5 septembre 1725à Fontainebleau, le jeune Louis XV, bel adolescent de 15 ans, épouse la modeste et pieuse Marie Leszczynska (22 ans), fille d'un ex-roi de Pologne en exil et ruiné. Ce mariage de l'arrière-petit-fils de Louis XIV, souverain du plus puissant royaume d'Europe, voire du monde, avec une princesse inconnue, est le résultat d'étonnantes intrigues nobiliaires à la cour de Versailles. UNE MUSIQUE D'UN BONHEUR CONTAGIEUX Le nuit des rois: Fêtes royales au temps de Louis XV | Jordi Savall https://youtu.be/ioYK75DkXBU Jordi Savall i Bernadet, né le 1er août 1941 à Igualada (Province de Barcelone, Espagne), est un violiste, chef de chœur et chef d'orchestre espagnol. Il joue un rôle déterminant pour le renouveau de la musique de la Renaissance et de la musique baroque, notamment avec ses ensembles Hespèrion XX et Le Concert des Nations, et avec son interprétation de la viole de gambe dans le film à succès Tous les matins du monde, qui contribue à la popularisation de cet instrument. https://www.facebook.com/groups/716146568740323/?ref=share_group_link https://www.instagram.com/p/CeLR4cAKOXj/?igshid=NGJjMDIxMWI=
2 notes
·
View notes
Photo

“La tondue de Chartres” - Simone Touseau, tondue et marquée au fer rouge sur le front, est conspuée dans les rues de Chartres libérée le jour même – 16 août 1944
Avec le baluchon, Georges Touseau, le père de Simone.
© Robert Capa
Article de Gilles Heuré pour Télérama (photos supplémentaires)
16 août 1944. Alors que les Américains viennent de libérer Chartres, la foule en liesse hue onze femmes, tondues pour s’être livrées à la “collaboration horizontale” avec l’occupant. Parmi elles, Simone Touseau, 23 ans. Le photographe de guerre Robert Capa était là.
Sur le trumeau du portail sud de la cathédrale de Chartres, le « Christ enseignant » ne pouvait rien voir : le chemin de croix de Simone Touseau se déroulait du côté nord. Mais il a probablement entendu les cris, les quolibets et les insultes. Témoin, qu’aurait-il pu enseigner d’ailleurs de ce mercredi 16 août 1944, qui vit les premiers chars américains entrer dans la ville et la foule partagée entre la joie et l’esprit de vengeance ? Dans la cour des communs de la préfecture d’Eure-et-Loire ont été regroupées des personnes soupçonnées de collaboration. Trois hommes sont rapidement exécutés et onze femmes sur dix-neuf livrées aux ciseaux pour être tondues. Le nombre aurait pu être plus important si un capitaine des Forces françaises de I’intérieur (FFI), authentique résistant celui-là, ne s’était interposé pour mettre fin à cette outrageante justice expéditive. Parmi les « tondues » figure Simone Touseau, 23 ans. Et à la différence des autres, elle a été marquée au fer rouge sur le front. Depuis la préfecture, une sinistre procession accompagne la jeune femme, sa mère, également tondue, et son père qui porte un baluchon. Autour d’eux, hommes, femmes et enfants savourent l’événement, remontent la rue du Cheval-Blanc, et parcourent les quelques centaines de mètres jusqu’au domicile des accusées.
Quelque vingt mille femmes ont subi le même sort en France
Les onze Chartraines tondues pour « avoir fait la vie avec les Boches » devaient connaître son nom. Accusées de collaboration active ou de « collaboration horizontale », cette forme de « relation avec l’ennemi » dont la nature sexuelle est la marque d’une coupable infâmie, elles font partie des quelque vingt mille femmes qui ont subi le même sort en France entre 1943 et 1946. La « tonte » à laquelle se livrent des coiffeurs professionnels ou des FFI « de la vingt-cinquième heure » est alors, comme l’a expliqué l’historien Fabrice Virgili, « la première violence exercée contre l’ennemi, ou plutôt contre celle qui l’incarne », par une partie de la population « redevenue actrice » après avoir subi l’Occupation pendant quatre ans. Et comme ce fut déjà le cas lors de la Première Guerre mondiale, la nature sexuelle de la relation revêt une dimension symbolique et encourage tous les fantasmes. L’écrivain Louis Guilloux (1899-1980), à Saint-Brieuc, sera témoin de telles scènes de la Libération, qu’il relate dans ses Carnets : des femmes dont l’une, la tête rasée, ressemble à une « poire pelée », une autre avec une « tête de bagnard ». Et partout la foule qui crie « Hou ! Hou ! ».
De nombreux documents ont rendu compte de ces « tontes » sauvages. Certains sont des photographies prises par des particuliers ou des soldats américains. Mais une photo semble les résumer toutes, celle saisie par le grand photographe de guerre Robert Capa (1913-1954), à Chartres, ce 16 août 1944. Dix jours auparavant, il a débarqué avec la première vague d’assaut du 116e régiment d’infanterie américain sur Easy Red, à Omaha Beach, « Omaha la sanglante », et pris des clichés devenus légendaires dont onze, seulement, ont pu être sauvés d’un séchage intempestif en laboratoire. Après la longue bataille du « bocage », il arrive à Chartres et, alerté par les cris de la foule qui se masse devant les grilles de la préfecture, il parvient à y pénétrer et à prendre en photo le groupe de prisonniers. Au moment où des FFI et une cohue de curieux escortent en riant la famille Touseau, Capa, insatisfait par les photos de dos, fonce pour se retrouver devant le cortège et commence à déclencher son Contax. En reculant encore, il prend le désormais célèbre cliché qui restera comme « La Tondue de Chartres ». Simone Touseau, entourée d’un homme en uniforme et d’un autre en chemise blanche qui se prétend « chef de la résistance policière », porte son bébé de trois mois dans les bras. En robe recouverte d’une blouse, elle est au centre de la photo, comme une pietà pécheresse. Elle ne regarde que son enfant, semblant ignorer les regards tendus vers elle et les sourires des autres femmes qui jouissent du spectacle. Le 4 septembre, le magazine Life publiera le reportage « The French get back their freedom » (« Les Français retrouvent leur liberté ») avec sept photos, cinq de Ralph Morse, l’autre reporter arrivé avec Capa, et deux de celui-ci, dont la fameuse « tondue ».
Une enquête fascinante sur une photo iconique
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans un livre paru aux éditions Vendémiaire en 2011, Philippe Frétigné et Gérard Leray ont mené une fascinante enquête sur cette photo symbolique d’une forme d’épuration peu honorable. « Au départ, explique aujourd’hui Philippe Frétigné, j’ai discuté avec Gérard Leray, professeur d’histoire-géographie et précieux connaisseur de la région et de cette période. Nous échangions simplement sur un élément du décor : la grande porte entourée d’un portail de pierres à arc de style Renaissance où figure un blason représentant un griffon et devant lequel passe la foule en cette journée d’août 1944. La porte en question est celle de l’hôtel de Champrond, à l’époque étude notariale, qui fut jadis propriété d’un haut magistrat de Louis XIV, dont l’avarice aurait inspiré Molière pour son Avare, selon la légende. De fil en aiguille, nous avons finalement retracé l’histoire de la photo, celle des protagonistes, la sociologie politique de la ville et le contexte historique de l’époque. »
Les recherches menées dans les archives françaises et allemandes et les appels à témoins au moyen d’un site Internet les ont ainsi conduits à mieux cerner la personnalité et l’itinéraire de « la tondue ». De faillites en liquidations, rongés par la frustration et la haine du Front populaire, ses parents étaient devenus au fil des années des commerçants déclassés, aux idées ouvertement d’extrême droite. Quand la guerre arrive, ils choisissent d’emblée leur camp. Simone, elle, a un caractère bien trempé. Bachelière, on la dit arrogante. D’ailleurs, elle ne cache pas ses idées politiques favorables au nazisme. Le voisinage fait aussi des gorges chaudes de son comportement, la traite de fille facile. Sa réputation trouve de nouveaux motifs de détestation quand elle devient interprète dans les services administratifs allemands, puis la maîtresse d’un soldat du Reich, Erich Göz. Bibliothécaire dans le civil, il tient la librairie militaire de Chartres. Envoyé sur le front de l’Est, il est ensuite blessé, et Simone se rend en Allemagne en 1943 pour le rejoindre. Une fois rétabli, il est renvoyé en Russie où il mourra en juillet 1944, alors que Simone, déjà enceinte, était rentrée à Chartres.
Dans les derniers mois de 1944, les faits de collaboration reprochés aux femmes suivent une échelle de gravité : avoir adhéré à une organisation collaborationniste et professé des opinions négatives contre la Résistance et les Alliés ; avoir touché de l’argent de l’occupant ; avoir entretenu des relations personnelles avec des membres des troupes d’occupation (collaboration horizontale) ; avoir été coupable de délation. Simone Touseau, qui a aussi adhéré au PPF, le parti collaborationniste de Jacques Doriot (1898-1945), coche donc toutes les cases sauf la dernière, la plus grave. Accusée dans un premier temps d’avoir dénoncé cinq voisins qui ont été déportés, elle évitera le peloton d’exécution, faute de preuves tangibles et grâce à l’habileté de son avocat qui a fait traîner la procédure. Elle ne fera que quelques mois de prison, sortira libre fin 1946 et sera toutefois condamnée à dix ans « d’indignité nationale ». Dépressive et alcoolique, elle mourra en février 1966 à l’âge de 45 ans.
Dans son appartement face à la cathédrale, Philippe Frétigné a tourné la page de cette histoire. Musicien dans l’âme, l’ancien professeur de philo est aujourd’hui facteur de clavecin et il mène des recherches sur l’histoire de l’art au XVIIe siècle. On est loin de la période trouble de l’épuration. Mais il ne peut s’empêcher de faire le lien avec aujourd’hui. « Les cruels déclassements économiques et la précarité croissante d’une partie de la population peuvent aujourd’hui l’entraîner vers des partis fascisants qui exploitent la colère, la haine et la stigmatisation. Karl Marx n’avait pas tort quand il disait que si l’histoire ne se répète pas, elle bégaie. »
Une correction est à apporter à l’article : Robert Capa a débarqué en Normandie avec la première vague d’assaut sur la plage d’Omaha le 6 juin et non pas le 6 août comme l’écrit Gilles Heuré !
Pour en savoir plus sur cette histoire :
Les protagonistes de l'affaire par Gérard Leray, professeur d'histoire
#WWII#Libération de la France#Libération de Chartres#L'épuration#La tondue de Chartres#Collaboration#Women in war#Chartres#France#16/08/1944#1944
3 notes
·
View notes
Text









Petit retour historique sur le quartier des Menus d'où est né la ville. En 1308, le roi Philippe Le Bel se rend à Boulogne-sur-Mer pour le mariage de sa fille Isabelle avec Édouard II, roi d'Angleterre. Constatant la renommée de la chapelle, lieu de pèlerinage attirant même des bourgeois parisiens, le roi, de retour à Paris décide de faire ériger une chapelle plus proche de Paris du nom de Notre-Dame-de-Boulogne. Terrain est proposé aux Menuls-lès-Saint-Cloud par son chancelier, Jean de la Croix qui possédait 5 arpents sur le tertre des Menus. Remplaçant la petite chapelle Saint-Gemme en bois, l'édification de l'église démarre en 1319 (d'où l'erreur de la mairie pour l'expo des 700 ans de la ville en 2019) et se termine le 3 juillet 1330 par la bénédiction de l'évêque Hugues de Besançon sous le vocable de Notre-Dame-de-Boulogne-sur-Seyne. Le villages des Menuls, désormais érigé en paroisse devient Boulogne-la-Petite et son bois, le bois du Rouvray, devient le Bois de Boulogne. L'église devient vite célèbre, le pèlerinage se développe (plus rapide que les 15 jours pour aller à Boulogne-sur-Mer) et les grands noms de l'époque s'y succèdent : le roi Philippe V, Jean le Bon, Jeanne d'Arc, du Guesclin et même le pape Sixte-Quint. Le trésor de l'église et sa renommées croissant, le village se développe, échoppes, auberges, hôtellerie. Ainsi naquit Boulogne. La prospérité gagne la ville, les lavandières vont à la rivière par la rue du Bac et la rue de l'Abreuvoir pour nettoyer le linge des riches propriétaires. La blanchisserie se développe au moment où Monsieur, frère de Louis XIV rachète la demeure des Gondi à Saint-Cloud et s'y installe, organisant des fêtes somptueuses où la noblesse se presse... en déposant leur linge sale à l'aller pour le récupérer au retour. Les 600 personnes au service de Monsieur descendent souvent à Boulogne par le Pavé du Roi (actuelle avenue Jean-Baptiste Clément) et contribuent aussi à l'essor de la ville autour de l'église et des Menus. Au XVIIIe siècle, de nombreuses villégiatures de nobles parisiens sont construits à Boulogne, le château de Meulan (futur Rothschild), la maison Walewska, la maison de l'Abbé Louis de Bourbon, fils illégitime de Louis XV à l'emplacement actuel des immeubles de la France Mutualiste mais les vieilles maisons du quartier des Menus, vétustes, sont peu à peu délaissées par les blanchisseurs au profit de la rue d'Aguesseau puis de la rue de la Rochefoucauld, nouvellement percée. Ce n'est qu'en 1871, après l'incendie de Saint-Cloud que le quartier retrouvera vie avec l'apport massif d'une communauté italienne originaire du Piémont. Les Menus reprennent vie et nombre d'hôtels meublés, de bars se développent dans tout le quartier des Menus.
#boulognebillancourt#bois de boulogne#billancourt#menus#rue des menus#rue de l'abreuvoir#rue du bac#rue du fossé saint-denis#rue du fossé magot#rue des victoires#parc rothschild#boulbil#boulbi#rue saint-denis
2 notes
·
View notes
Text
Peu s'en souviennent, certains l'ignorent (17)
Peu se souviennent de Catherine, premier amour du Roi-Soleil.
En 1643, Louis XIV n'a pas encore 5 ans lorsqu'il devient roi de France. Sa mère, Anne d'Autriche, exerce la régence et veille au plus près sur les intérêts et l'éducation de son fils, ne négligeant pas, semble-t-il, son éducation sexuelle. Inquiète pour la libido de son rejeton, elle aurait confié à Catherine-Henriette Bellier, sa femme de chambre, le soin de le déflorer. C'est qu'elle voulait faire mentir l'expression « tel père, tel fils » ; Louis XIII, en effet, d'un tempérament peu fougueux, a mis près de 23 ans à lui donner un héritier.
Fille de Martin Bellier, commerçant dans le textile, Catherine-Henriette Bellier entre à la cour après son mariage avec Pierre de Beauvais, en 1634. Malgré un physique peu avantageux, elle est borgne, on la surnomme d'ailleurs « Cateau la Borgnesse », on lui prête de nombreux amants. Elle a une vingtaine d'années de plus que le roi, alors âgé de 14 ans, quand elle l'initie aux plaisirs de la chair. Celui-ci en est apparemment satisfait puisqu'elle restera sa maîtresse pendant quelques temps, inaugurant ainsi la longue liste des favorites du Roi-Soleil, parmi lesquelles Louise de La Vallière, Mme de Montespan ou Mme de Maintenon. Anne d'Autriche, pleinement rassurée, accorde à Catherine une pension de 2000 livres ainsi qu'une forte somme d'argent avec laquelle Catherine et son mari, devenu baron par la même occasion, feront édifier l'hôtel de Beauvais, dans le quartier du Marais. Dès lors, elle restera dans les bonnes grâces de Louis XIV et de sa mère. Toutefois, fortement endettée, elle s'éloigne de la cour après la mort de son mari et meurt seule en 1689.
32 notes
·
View notes
Photo

15-549 C’est mon père https://soundcloud.com/jlgaillard/cest-mon-pere Sous le règne de Louis XIV, un officier nommé Duras servait dans le régiment d’Aubusson. La plupart de ceux qui le connaissaient, le croyaient issu d’une puissante famille portant le même nom. Mais il était fils d’un simple paysan. Un jour, son père était venu le voir en sabots et vêtu d’une blouse de laboureur, l’officier le présenta avec déférence à son colonel. Le roi, instruit de la manière dont ce soldat avait honoré son père en présence de tous, le fit venir et lui dit : - Je suis très heureux de connaître un des plus honnêtes hommes de mon royaume. Il semble que ce geste devrait être tout naturel, car ce n’est pas l’habit ni la profession d’un homme qui en font la qualité. Cependant, si nous y pensons, nous constatons que dans notre monde où tout est « tape-à-l’œil », des fils et des filles qui ont bénéficié du travail acharné ou des sacrifices substantiels de leurs parents n’ont pas toujours la simplicité de cet officier. Eh oui, cet homme est mon père, ne vous en déplaise, il est né à une autre époque, c’est vrai. Il n’est peut-être pas versé dans les mathématiques modernes, ni dans l’informatique c’est encore vrai. Il est plus à l’aise en pleine nature que dans vos salons artificiels. Mais, c’est mon père, je l’aime et le respecte. Si je suis ce que je suis, après Dieu, c’est à mes parents que je le dois et, bien que je sois adulte, j’aime à connaître leur avis et à m’entretenir avec eux. Les choses iraient certainement mieux si comme l’officier de Louis XIV la jeunesse savait honorer ses parents. C’est le seul des dix commandements qui soit suivi d’une promesse : Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. Exode 20 :12. #LouisXIV #officier #aubusson #régiment #armée #365histoires #paysan #sabot #colonel #roi #royaume #profession #jeunesse Jean-Louis Gaillard www.365histoires.com www.jlgaillard.fr https://www.instagram.com/p/CbHZ064sWZL/?utm_medium=tumblr
#louisxiv#officier#aubusson#régiment#armée#365histoires#paysan#sabot#colonel#roi#royaume#profession#jeunesse
0 notes
Text
Gare au Scorpion !

Il se passe beaucoup d’événements ces temps-ci. Des événements qui fendent le cœur, d’autres qui confondent l’esprit, des troisièmes qui troublent l’âme. C’est dû au fait que le soleil est dans le Scorpion (du 22 octobre au 24 novembre), signe qui incite à la jalousie, aux rapports de force et au mauvais esprit. Je tiens l’information d’une astrologue qui fut faite docteur en sociologie à la Sorbonne, avec mention « très honorable ». L’année dernière elle avait prédit que Pâques tomberait un dimanche. Elle en avait eu d’abord la prémonition, puis l’intime conviction. Ses tarots avaient confirmé l’une et l’autre. Et la suite lui avait donné raison. Sachons donc que cette année encore, le Scorpion fera des siennes. Comment comprendre autrement que le prix des carburants augmente et que le niveau de l’enseignement ne fait que baisser ? Même à la Sorbonne !
Voyons d’abord les événements qui fendent le cœur ! Il y en a un qui remporte la palme. Ça se passe sur une île des Canaries, qui s’appelle justement « la Palma ». Elle est renommée pour ses touristes, ses bananes et surtout son volcan. Or celui-ci, dans le droit fil du Scorpion, s’est mis à gronder, à trembler et à gerber. En guise de venin, il envoie des panaches de feu et de cendres. Il bave de la lave incandescente, qui déferle vers les côtes et brûle tout sur son passage. Or mon astrologue préférée avait déjà prophétisé la catastrophe en disant : « Je vois pour bientôt des événements fâcheux qui ne plairont pas à tout le monde ! » Pouvait-on être plus clair ? Tout est dans le Scorpion, c’est l’évidence même ! Ne cherchons pas midi à quatorze heures !
Parmi les événements qui confondent l’esprit, il y a cette mise aux enchères d’une partie de la succession d’Al Capone en Californie. J’apprends par les journaux que ses petites-filles ont voulu s’en défaire par peur de la perdre dans les incendies de plus en plus fréquents là-bas. Mais aussi afin de restaurer l’honneur de leur grand-père si injustement calomnié. Car ce chef de la mafia n’aurait pas fait de mal à une mouche. (D’ailleurs, les mouches n’ont jamais porté plainte.) Selon sa descendance, le prétendu gangster fut un père de famille exemplaire, comme en témoigne une lettre affectueuse adressée à son fils, lettre qui faisait d’ailleurs partie des enchères. Vous objecterez que les commissaires-priseurs ont adjugé son Colt calibre 45 ? Et alors, où est le mal ? C’était un pistolet que ce papa-gâteau portait toujours sur lui, comme c’est prévu par le deuxième amendement de la Constitution. Ne disait-il pas qu’on peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver, qu’avec un mot gentil tout seul ? Or s’il n’était pas Scorpion lui-même (né un 17 janvier, donc plutôt Capricorne), il avait Jupiter en Scorpion, comme Louis XIV, Bonaparte et Alain Delon. (Sans parler du modeste Antoine Dupont, un Scorpion qui mériterait d’être plus connu.)
Il y a enfin des événements qui troublent l’âme. Ainsi à Atnapura, au Sri Lanka, un homme nommé Gamage faisait creuser un trou dans son jardin à la recherche d’une source. Quand tout à coup, la pelleteuse a mis au jour un amas de cailloux, qui se sont avérés des saphirs. Il y en avait une demi-tonne pour quelque 2,5 millions de carats équivalant à une valeur marchande de cent millions de dollars. L’homme fut pourtant très déçu de la découverte, comme on l’est toujours quand on cherche une source et qu’on tombe sur des cailloux. C’était la faute au Scorpion. Il y a aussi ce match de foot en Hollande où un attaquant reçoit une passe qui fait tomber le ballon derrière lui. Pour éviter qu’il ne soit perdu, le joueur parvient à l’attraper d’un coup de talon et l’envoie là où aucun défenseur ne l’attend, à savoir dans les filets du but. Or ce tour de passe-passe extraordinaire, on l’appelle comment dans le jargon du foot ? Le coup du scorpion ! Un « coup du scorpion » sous le signe du Scorpion, réussi par un joueur qui est lui-même Scorpion, qui dit mieux ?
Toujours selon mon astrologue préférée, les natifs de ce signe n’auront pas peur des dangers. Ils aimeront défier les interdits et tester leurs limites. Ils seront fidèles en amitié, volontaires et travailleurs, mais aussi susceptibles et parfois rancuniers. Pour se venger, ils aimeront lancer des piques à la fin d’un discours ou d’un repas arrosé. Comme disaient les Romains en parlant du scorpion, in cauda venenum, le venin se trouve dans la queue. Ils ressembleront à Alexandre Nevski, à Madame des Grassins de Balzac et à Odilon le Caverneux. Parfois même à Georges Brassens, surtout par la pipe et la guitare. Car le Sétois est né il y a un siècle, le 22 octobre 1921, ce qui fit de lui un des premiers Scorpions de l’année. Et pour rester fidèle à son signe, il cassa sa pipe le 29 octobre 1981, soit soixante ans plus tard. Preuve qu’un Scorpion de grand talent peut disparaître comme il l’a dit lui-même de son pauvre Martin : « pour ne pas déranger les gens ».
0 notes
Photo

Françoise-Marie de Bourbon, legitimated, known as Mlle de Blois in wedding dress. Daughter of Louis XIV and Mme de Montespan, she married Philippe d'Orléans, duc de Chartres and died in 1749.
#Françoise-Marie de Bourbon#royaume de france#maison de bourbon#royal bastards#full length portrait#mademoiselle de blois#bourbon orleans#maison d'orléans#fils et filles de louis xiv#légitimée de france#légitimés et légitimées de france
11 notes
·
View notes
Text
L'immigration italienne a beaucoup apporté à la France... dont l'inverse actuellement ou l'invasion de crétins ruine la culture française...
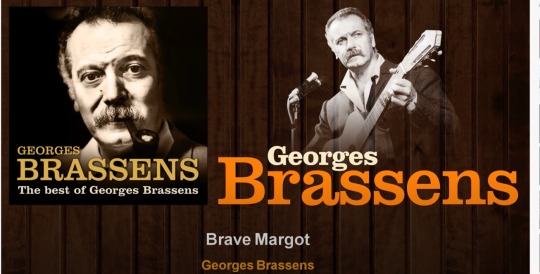
VIDÉO. GEORGES BRASSENS LE MÉDITERRANÉEN, FILS DE "L'ITALIENNE"
Par Le360 (AFP) le 29/08/2021 à 12h27
Les portraits du chanteur français Georges Brassens sur le caveau familial du cimetière de Sète, dans le sud de la France, le 11 juin 2021. Le chanteur, poète et musicien a vécu avec la communauté italienne à Sète, où un tiers des habitants sont d'origine italienne.© Copyright : Pascal GUYOT / AFP
Monument de la chanson française, né il y a un siècle à Sète, sur les rives de la Méditerranée, Georges Brassens a baigné grâce à sa mère Elvira Dagrosa, qu'il appelait "l'Italienne", dans la culture des immigrés italiens du port héraultais.
"Parce que son ascendance italienne s'est transmise par la branche maternelle, Georges Brassens est longtemps resté inaperçu en tant qu'+enfant+ d'Italiens. Le détail de cette origine échappe aujourd'hui encore à bon nombre de ses admirateurs, même parmi les plus fervents", écrit la chercheuse et professeure de l'université Paul Valéry de Montpellier Isabelle Felici dans "Brassens et autres 'enfants' d'Italiens".
Présentée par certains biographes ou même parfois par Brassens lui-même comme étant "napolitaine", Elvira Dagrosa était en réalité née à Sète de parents venus du sud de l'Italie, et plus précisément de Marsico Nuovo, en Basilicate, vers 1880. Mais son père Michele, journalier dans l'agriculture et le bâtiment, l'enregistre à l'Etat civil italien dans son village d'origine: elle a donc la nationalité italienne.
Brassens ne connaîtra pas ce grand-père mort en 1916 mais il se rappelle bien de sa grand-mère Maria-Augusta (1862-1926). Il racontera notamment qu'elle rusait pour l'emmener à l'école qu'il avait pris en horreur après une punition. Le garnement se précipitait aussi dans les jupes de l'aïeule pour échapper aux foudres de sa mère quand il avait fait une bêtise.
Vidéo. Le chanteur Tonton David n’est plus
Veuve de guerre, mère d'une fille (Simone, la demi-soeur aînée de Georges), Elvira n'ira pas très loin pour trouver son second mari Jean-Louis Brassens: les deux familles étaient voisines, dans le quartier "Révolution".
Georges Brassens, s'il n'a visiblement jamais parlé couramment l'italien, baigne quotidiennement dans une famille et un milieu italiens dans lequel les dialectes venus de la péninsule se mélangent à l'occitan local et dans lequel la chanson dite "napolitaine", c'est-à-dire du sud de l'Italie, est omniprésente.
"Elle chantait d'abord des chansons italiennes, elle était napolitaine ma mère. J'avais ce répertoire des chansons italiennes. Et en ce temps-là, tout le monde chantait", dira Brassens dans un entretien à France Culture en 1979.
Il cite généralement "O Sole Mio" et "Santa Lucia" -qu'il chantera plus tard avec Tino Rossi- comme les chansons italiennes qu'il a le plus entendues dans son enfance. Mais il entend probablement dans sa famille maternelle des berceuses et tarentelles du village natal de ses grands-parents. Et certains retrouveront dans le rythme "sautillant" et "entêtant" de certaines chansons de Brassens -comme "la femme d'Hector"- la cadence de la tarentelle typique du sud de l'Italie.
Vidéo. Italie: décès de la chanteuse Milva, alias "la panthère de Goro"
"L'Italienne", repasseuse et très pieuse, "adorait la musique" mais "ne voulait pas du tout voir son fils devenir musicien", déplore Brassens dans le même entretien.
L'auteur-compositeur, que ses parents ne viendront jamais voir en concert, se produira en Italie, notamment à Rome en 1958, quittera un temps François Villon pour se passionner pour la Divine Comédie de Dante, aura de nombreux amis d'ascendance italienne à Sète (l'écrivain Mario Poletti, l'athlète Eric Battista...) ou à Paris (Lino Ventura), avouera un amour immodéré pour les pâtes, notamment les canelloni blancs de sa mère.
On sait aussi qu'il a beaucoup aimé "Les Ritals" de François Cavanna, qui a sans doute raconté une expérience voisine de la sienne, à une époque où il ne faisait pas nécessairement bon d'avoir une ascendance italienne.
Son univers "se teinte de couleurs italiennes: des bribes de langues et de dialecte, des plats qui rappellent l'enfance, des amitiés et une immense affection pour celle qui transmet et représente cette part d'altérité: sa mère", note Isabelle Felici. Mais "la seule Italie avec laquelle Brassens ait vraiment été en contact est l'Italie immigrée à Sète", conclut-elle.
Le chanteur Marilyn Manson visé par plusieurs accusations de harcèlement et de viol
Dans le port du Golfe du Lion, née au XVIIe siècle par la volonté de Louis XIV, la ville compte selon la municipalité un tiers d'habitants d'origine italienne. Venus par vagues successives, principalement du Sud, de nombreux migrants ont bâti la ville, y ont fait du commerce ou y ont pratiqué la pêche.
Dans les années 1860, de nombreuses familles de pêcheurs sont arrivées de Cetara (Campanie) et Gaeta (Latium). Installés initialement dans le Quartier Haut, sous la protection de la Madone de l'église Saint-Louis, ils ont notamment apporté la macaronade et la tielle (tourte de poulpe), devenues des spécialités sétoises. https://www.youtube.com/embed/df8SYHs4X94?rel=0&showinfo=0&wmode=transparent&enablejsapi=1
Par Le360 (AFP)
https://youtu.be/df8SYHs4X94
Read the full article
0 notes
Text
Oslo, 27 juillet
Mardi après-midi, tout juste descendue du train, je m'installe dans l'une des auberges de jeunesse hyper-centrale d'Oslo. Malgré le fait qu'il diffuse en permanence une insupportable musique d'ascenseur ibizien dans les pièces communes, l'établissement est accueillant, et, détail qui a son importance, propose un buffet de petit-déjeuner gargantuesque.
Réouverture d'une parenthèse "obsession nourriture". J'avais déjà été impressionnée par le buffet de l'auberge de Trondheim (l'hôtel nazi), époustouflée par celui de celle d'Ålesund (avec ses harengs marinés et son salami d'agneau). À Oslo, c'est petit-déjeuner continental, et par continental on entend toute l'Europe d'avant Brexit : baked-beans, müsli, concombre, fromage et confitures me donnent des forces pour les longues balades prévues. Clôture de la parenthèse.
Je profite de cette première demi-journée pour constater qu'Oslo, c'est avant tout un plan orthogonal ("cool", dit le pigeon voyageur bredzingue qui niche dans ma tête), plein de styles architecturaux réjouissants et à chaque coin de rue des surprises.
Mes premiers pas dans la capitale me portent ainsi par hasard devant le sobre et émouvant mémorial des attentats qui ont fait 77 victimes dans le centre politique d'Oslo et sur l'île d'Utøya il y a 7 ans.
Mercredi, je découvre les quais très graphiques d'Aker Brygge, côté est, qui mènent en un gracieux grand-écart temporel et politique de l'hôtel de ville à la forteresse d'Akerhus, longtemps siège de la royauté. Ici pas de chichi à la Louis XIV : ce château qui a traversé le second millénaire de notre ère est sobre et fonctionnel. La suite de mes promenades me fera comprendre que c'est la marque de fabrique d'Oslo.
En suivant les conseils souvent drôles et décalés du petit guide "Use it", qui décortique à l'usage de visiteurs me ressemblant les petits secrets des villes d'Europe (je n'aime pourtant pas trop la version chtimie du guide, trop vieuxlillocentrée à mon goût), j'entame un circuit dans les quartiers ouest de la ville, les plus chics.
Passage obligé par le palais royal, résidence arborée des coupeurs de rubans Harald & Sonja, puis à travers les rues cossues jusqu'au parc Vigeland où le sculpteur éponyme a disposé plus de 200 statues de bronze ou de granit représentant le spectre des émotions humaines. On oscille entre le touchant et le grotesque, et ma préférence va clairement aux ferronneries des portails plutôt qu'à la statuaire.
Je grignote quelques framboises cueillies près de l'ambassade de France et m'accorde une IPA plus que légère - mais amère à souhait - à l'Oslo Mikrobryggeri, plus vieille brasserie osloïte.
Un peu de verdure et de prise de hauteur ensuite à travers le parc St Hanshaugen puis le cimetière Vår Frelser où parmi quantité d'anonymes sont enterrés Ibsen, Munch et d'autres célébrités norvégiennes.
Je termine mon cheminement du jour en passant devant St Lukas (half-ugly church) et St Olav (chrétienté whaouh) avant de me poser à l'ombre de l'église de la Trinité, lieu idoine où finir le livre qui occupe depuis presque un mois mes soirées et mon esprit sain : Le Royaume, d'Emmanuel Carrère.
Jeudi matin, je commence mes déambulations sous un soleil déjà au taquet, en direction de l'opéra (& ballet). Le bâtiment, œuvre en 2008 du cabinet local Snøhetta, est déconcertant de simplicité, et son toit pentu offre une vue à 360° sur la ville, les collines alentours, l'Oslofjorden et ses îles.
Je mets ensuite le cap vers le levant, direction cette fois les quartiers populaires, pour une promenade au rythme sinusoïdal.
Régal d'animation, de couleurs et de graffitis du côté de Grønland, pause à l'ombre dans le parc de la prison, puis balade au calme entre les petites maisons de bois du quartier de Kampen.
Suit le brouhaha des rues de Tøyen qui fourmillent de vie, puis la quiétude moite des serres du jardin botanique (environnement idéal par 30°C), et les boutiques très "Plateau" du quartier hipster de Løkka.
J'arrive alors près de l'Akerselva, la rivièrette qui coupe Oslo entre ouest posh et est popu. L'Eventyrbroen ("pont des contes de fées") et ses statues oniriques laissent la place en un coup de baguette magique à des façades entièrement peinturlurées au voisinage de l'école d'art Strykejernet et d'Hausmania, squat d'activistes et scène alternative. Au fil de l'eau, je me retrouve dans le nouveau quartier de Vulkan, et file à Mathallen, les splendides halles début XXe, où j'engloutis pour le goûter le plus délicieux des sandwiches au canard (là aussi particulièrement adapté à la météo).
Après l'expo photo du centre Nobel pour la paix, sur le thème de la maison chez les réfugiés, je termine cette chaude journée sur les quais - ouest cette fois - d'Aker Brygge, quartier portuaire reconverti en secteur tendance avec restos, bars et marina, et aussi une plage et de nombreuses jetées en bois qui m'amènent ici. Pour la seconde fois après Copenhague, j'ai le plaisir de pouvoir me baigner dans une capitale. Je ne suis évidemment pas la seule à avoir eu l'idée : des centaines d'Osloïtes viennent faire trempette à la sortie du travail ou d'une journée de glande (pour les post-adolescents).
Parenthèse partiellement dénudée. Je me suis familiarisée ces derniers jours avec la décontraction physique qui sévit ici - essentiellement chez les gravures de mode vingtenaires, mais pas que. Alors qu'au sortir de l'hiver, jusqu'au 30 juin donc, tout ce petit monde était probablement blanc comme un cul (sauf des cheveux, fréquemment teints en vert, bleu ou rose comme le faisaient les jeunes Allemands dans les années 1990), les mecs profitent de juillet pour se balader torse-poil et les filles sont en bikini dans tous les parcs, y compris les jardins du palais royal, à côté de la tombe d'Henrik Ibsen ou dans le parc de la prison. Fin de la parenthèse.
Aker Brygge héberge surtout le musée d'art contemporain Astrup Fearnley, sorti en 2012 du carton à dessin de Renzo Piano, et dont je me réserve la visite de l'expo "I Still Believe In Miracles" ce vendredi. Je passe vite devant les œuvres de Damian Hirst (choquez-moi, choquez-moi) mais m'attarde devant les toiles de Catherine Opie, Rob Pruitt et Takashi Murakami, les photos de Diane Arbus et Walker Evans, et les installations popement subversives de Dan Colen.
En préparant mes sacoches cet après-midi, j'essaye d'emmener avec moi un peu de la vie d'Oslo.
Je traverse cette nuit l'Oslofjorden et le Skagerrak pour rejoindre Frederikshavn au Danemark, puis je descendrai la côte ouest du Jutland (conseil d'Eva & Sergio), l'estuaire de la Schlei (recommandation de Max) et traverserai le Mecklembourg et le Brandebourg pour rallier Berlin (autosuggestion).
1 note
·
View note
Photo

Le Triomphe d'Amphitrite (1780) de Jean-Hugues Taraval (1729-1785) LES LUMIÈRES DE VERSAILLES #leslumièresdeversailles "- Vous aurez beau faire, Monsieur, dit la jolie Marquise, vous n'aurez jamais mon cœur. - Je ne visais pas si haut. " MOLIÈRE UNE MUSIQUE D'UN BONHEUR CONTAGIEUX Marin Marais -〈Alcyone〉 Marche pour les Matelots & Airs des Matelots I - II - III https://youtu.be/W--OjtoAV0w Marin Marais (31 mai 1656-15 août 1728) était un violiste ou gambiste (musicien jouant de la viole de gambe) et compositeur français de la période baroque. Après la mort de Jean-Baptiste Lully, qui donne aux compositeurs une plus grande liberté pour faire jouer leurs ouvres, Marais écrit Alcide (livret de Jean-Galbert de Campistron), en collaboration avec Louis Lully (fils aîné de Jean-Baptiste) qui sera représenté en 1693 avec un grand succès. Il se produit parallèlement comme violiste avec d'autres musiciens de la cour auprès de Louis XIV mais aussi de son entourage (duc de Bourgogne, Madame de Montespan ; Mme de Maintenon, etc.). C'est dans ces termes que Madame de Sévigné rendait compte à sa fille dans une lettre de 1696 d'une telle séance de musique: « Les jeunes gens, pour s'amuser dansèrent aux chansons, ce qui est présentement fort en usage à la Cour. Joua qui voulut, et qui voulut aussi prêta l'oreille au joli concert de Vizé, Marais, Descoteaux et Philibert. Après cela on attrapa minuit et le mariage fut célébré dans la chapelle de l'hôtel de Créquy. » Un livre publié en 1692, Pièces en trio pour les flûtes, violons et dessus de viole, montre le répertoire utilisé par Marais pour ces concerts à la cour. https://www.facebook.com/groups/716146568740323/?ref=share_group_link https://www.instagram.com/p/CebgOFxq8Y1/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text
The French Royal Family: Titles and Customs
Petit-Fils, Petite-Fille de France
“In the 1630s, a lower rank was created, namely petit-fils, petite-fille de France, for the children of the younger sons of a sovereign. This was designed for Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchess of Montpensier, daughter of Gaston d'Orléans, at a time when the king Louis XIII had no children and his brother Gaston (heir presumptive) had only one daughter. The petits-enfants de France ranked after the enfants de France but before all other princes of the blood.
Collectively, the enfants de France and petits-enfants de France formed the Royal family.”
Princes du Sang
“In France, aside from a few exceptions, prince was not a title, but a rank that denoted dynasts, i.e., individuals with an eventual succession right to the throne. The word, and its connotation of sovereignty, was felt to be their preserve. Collectively known as the Princes du Sang (less often princes du sang de France, princes des lys) they were, in theory, all descendents in legitimate male line of a French sovereign outside of the royal family itself. The term dates from the 14th century. The princes of the blood all had a seat at the Conseil du Roi, or Royal Council, and at the Paris Parlement.
In the 17th and 18th centuries it became customary to restrict the term of prince du sang to those dynasts who were not members of the Royal family, i.e. children or grandchildren in male line of the sovereign, since those became known as the enfants and petits-enfants de France.
Kings were somewhat selective in their choice of who was treated as prince of the blood.”
Premier Prince du Sang
“Ranking among the princes du sang was by order of succession rights. The closest to the throne (excluding any fils de France) was called Premier Prince du Sang. In practice, it was not always clear who was entitled to the rank, and it often took a specific act of the king to make the determination.
As the first two were members of the Royal Family and thus outranked other princes of the blood, it was felt that the rank would not honor them enough, and the deceased's son Louis de Bourbon-Condé took the rank, although the duc de Chartres drew the pension (the source for this is Sainctot, cited in Rousset de Missy).
On the death of Louis de Bourbon-Condé in 1709 the title would have passed to the duc d'Orléans, nephew of Louis XIV, but he did not use it (he did, however, call himself first prince of the blood on occasion.) After the duc d'Orléans's death in December 1723, his son officially received the title. It remained to the head of the Orléans family until 1830. However, at the death of the duc d'Orléans in 1785, it was decided that, once again, the duc d'Angoulême, son of the king's brother, ranked too high for the title, and it was granted to the new duc d'Orléans (letters patent of 27 Nov 1785); but Louis XVI decided that the duc d'Orléans would hold the title until the duc d'Angoulême had a son who could bear it.
The rank of "premier prince du sang" was not purely a court title or a precedence. It carried with it legal privileges, notably the right to have a household (maison), such as the king, the queen, and the enfants de France each did. A household was a collection of officers and employees, paid for out of the State's revenues, and constituted a miniature version of the royal administration, with military and civil officers, a council with a chancelor and secretaries, gentlemen-in-waiting, equerries, falconers, barbers and surgeons, a chapel, etc.”
Styles and Precedence of the Princes du Sang
Precedence
“Until the 15th century, precedence among princes of the blood, or even between them and other lords, depended on the title... [A]n edict of 1576 set that princes of the blood would have precedence over all lords, and between them by order in the line of succession rather than by their titles.
Precedence was set according to the following rules (Guyot, loc. cit., vol. 2, p. 382; he is in fact citing Rousset de Missy, who is himself citing Sainctot Sr., who was introducteur des ambassadeurs under Louis XIV).
All princes of the blood were divided into:
children of the current sovereign and children of his eldest son,
children of the previous sovereign and children of his eldest son,
all others.
The first two categories formed the royal family (Guyot says children and grandchildren, but I [original author] interpret his words strictly).
Precedence was set:
by category (i.e., anyone of category 1 outranked anyone of category 2)
within category:
between males, according to the order in the line of succession,
between males and females, according to the right of succession (that is, males before females),
between females, according to the degree of kinship with the king.
Thus the son of the Dauphin outranked the king's brother or younger son, but the daughter of a Dauphin was outranked by the king's daughter; the king's daughter in turn outranked the king's brother or sister. Wives took the rank of their husbands, so a Dauphin outranked a king's sister.
Another illustration of these rules is found in the listing of French princes and princesses in the Almanach Royal of 1789, a semi-official directory of the French state (see p. 33 and p. 34). The order is:
the king and the queen
the king's two sons (group 1, males)
the king's daughter (group 1, females)
the king's brothers and their wives (group 2, males)
the king's sisters (group 2, females)
the king's aunts (group 2, females)
the children of the king's younger brother (group 3)
the Orléans branch, males followed by females
the Bourbon-Condé branch, males followed by females
the Bourbon-Conti branch, males followed by females
Formal Styles
The following styles were highly formal and used only in the most official documents, such as treaties, contracts, tombstones, and the like, according to a règlement of 1688 cited by Guyot (Traité des droits, vol. 2, p. 371):
The heir apparent, titled Dauphin de Viennois (and not "du Viennois" as sometimes written) or more commonly Dauphin, was called très haut, très puissant et excellent Prince
The eldest brother of the King and the Premier Prince du Sang was très haut et très puissant Prince (e.g., Bossuet's Oraison funèbre de Louis de Bourbon, where the deceased is named très haut et très puissant prince Louis De Bourbon, prince De Condé, premier prince du sang; Oeuvres Oratoires, 1922, vol. 5, p. 425).
The other Princes of the Blood were très haut et puissant Prince.
Foreign princes at the Court were haut et puissant Prince.
The enfants and petits-enfants de France were entitled to the style of Royal Highness (Altesse Royale) since the 17th century (thus, the duc d'Orléans, Regent from 1715 to 1723, is styled SAR in the Almanach Royal of 1717). Other princes of the blood were only entitled to Most Serene Highness (Altesse Sérénissime) from 1651 to 1824, when they received the style of Royal Highness. Princes of the blood were the only ones in France entitled to the style of "Highness", according to an arrêt of the Parlement of Paris of 14 Dec 1754 which forbade the bishop of Metz to use that style (Guyot, Traité des droits, vol. 2, p. 371).”
Titles
“A younger son was usually given a title fairly early, although for some reason the French royal family developed the habit of baptizing royal children at a late age. The child received a private baptism at birth (ondoiement) and would be known by his title, which was announced by the king immediately after the birth. When a younger son reached maturity, he was usually given an apanage: whereas the title might not carry any actual possession of lands and fiefs with it, an apanage would. The rule on apanages was that they would return to the crown after extinction of the male line, although any other property acquired by the apanagiste could pass on to a daughter. The custom of the apanage was adopted on a systematic basis in the early 13th c. Usually, the most recently acquired domains were given out as apanages. Among the lands used as apanages are Artois, Anjou, Maine, Poitiers, Valois, Alençon, Blois, Chartres, Clermont, Bourbon, Evreux, Orléans, Touraine, Berry, Auvergne, Bourgogne, Guyenne, Angoulême, Provence.
In the 16th and 17th c., the titles of Orléans, Anjou, and Berry became customary for younger sons. The brother of Louis XIV was given Orléans as apanage and his line continued, so the title became unavailable. Every duc d'Anjou, on the other hand, seemed to die without posterity or accede to some throne: the title was thus used repeatedly. When Louis XV's eldest son had a second son, the king was set against using Anjou, apparently because of the bad luck associated with it (duc de Luynes, Mémoires, 13:49; see also Journal de Barbier, 5:416), and used Aquitaine instead, a title unused since the Middle Ages.”
Family Names and Titles of Younger Sons
“A son of France was born de France: all his descendants, however, had his main title (whether an apanage or a courtesy title) as their family or last name. Thus the son of Philippe de France (1640-1701), duke of Orléans, was born Philippe d'Orléans, even though he was also petit-fils de France (see, for example, the text of his renunciation to his rights to the crown of Spain in 1712: the renunciation begins "Philippe, petit-fils de France, duc d'Orléans" but he signs "Philippe d'Orléans"; his cousin the duc de Berry signs his renunciation "Charles").
Although the king of France had no family name, and his children were born "de France", there was a sense in which a certain house was on the throne. The legitimized children of kings took as family name the name of the house: for example, the son of Charles IX, was known as Charles de Valois, duke of Angoulême (the name of the house was officially Valois because François I had been made duc de Valois in 1498 before ascending the throne). The legitimized children of Henri IV and Louis XIV all had Bourbon as family name.”
Men
“In general, a titled person was called Monsieur le duc de Villeroy, or Monsieur le comte d'Alaincourt and addressed as Monsieur le duc, Monsieur le comte; the same went for members of the royal family, until the 16th century, when a certain number of forms of address came into use. Starting under Henri III, the eldest brother of the king was called Monsieur (frère du Roi), his wife was Madame (See Brantôme). These usages only became established with Gaston, younger brother of Louis XIII. The king's younger brother retained this style after the death of his brother, so that, from 1643 to 1660 there were two Monsieurs, the brother of the deceased Louis XIII and the brother of the reigning Louis XIV (they were called le Grand Monsieur and le petit Monsieur). The style was later used for the count of Provence, brother of Louis XVI, and later for the count of Artois when Louis XVIII reigned.
The Dauphin, son of Louis XIV, was known simply as Monseigneur, although that seemed to be peculiar to Louis XIV's son: the usage originated with Louis XIV, perhaps as a jest, and no other Dauphin was ever known as Monseigneur (they were called Monsieur le Dauphin). The grandsons of Louis XIV were also called Monseigneur: Monseigneur duc de Bourgogne, Monseigneur duc d'Anjou, Monseigneur duc de Berry (Almanach Royal, 1706), or more formally, Monseigneur Fils de France duc de *** (Almanach Royal, 1713). Similarly, in the 1789 Almanach Royal one sees "Monseigneur comte d'Artois" and his wife "Madame comtesse d'Artois".”
Women
“At the Bourbon court, all the daughters of the king and of the dauphin were called "Madame" and collectively known as "Mesdames de France", and for all but the eldest one the given name was added. Thus, the daughters of Louis XV were known as Madame [Adélaïde], Madame Victoire, Madame Sophie, Madame Louise; before their baptism, they were known as "Madame [de France] première/Aînée", "Madame [de France] seconde", etc (see the Almanach Royal, 1738). Note, however, that at their birth in 1727 the twin daughters of Louis XV were called "Madame de France" and "Madame de Navarre". The first three (surviving) daughters were baptized the same day, on Apr. 27, 1737 (Louise Elisabeth, Henriette Anne, and Marie Adélaîde).
The eldest of the "dames de France" was either known as "Madame de France" (e.g., Elizabeth, eldest daughter of Henri IV and later queen of Spain), "Madame", or, if that title was used by the wife of Monsieur, brother of the king, as "Madame Royale". Thus Louis Louise-Elisabeth (1727-59), eldest daughter of Louis XV (who had no brother), was known as Madame from her baptism in 1737 until her marriage to the Infante Felipe of Spain in 1739, when she became Madame Infante (and later Madame Infante Duchesse de Parme). Adélaïde, daughter of Louis XV, was called Madame from 1752 until 1771 when she became Madame Adélaïde. The daughter of Louis XVI (who had a married brother) was known as Madame Royale until her marriage to her cousin the duc d'Angoulême.”
Until 1700 or so, the title of "Madame Royale" seemed to be used for princesses of collateral branches. Here are some examples:
Christine (or Chrétienne), {\it second\/} daughter of Henri IV, wife of the duke of Savoie, is called (after her marriage) "Madame Royale Chrétienne de France, Duchesse Régente de Savoie" in a 1645 treaty.
Henriette-Marie, third daughter of Henri IV, is said to have invented the English style of "Princess Royal" for her eldest daughter.
Anne Marie d'Orléans (1669-1728), second daughter of Monsieur (but at the time the most senior unmarried princess) is called "Madame Royale" by Dangeau in 1684 (Journal, 1:6, 1854 ed.); that year, she married the duke of Savoy, but Dangeau still referred to her as "Madame Royale" after her marriage: "On eut nouvelles que madame royale étoit accouchée d' une fille ; M De Savoie en envoya ici porter la nouvelle"; and even decades later, he calls her "Madame Royale de Savoie" (19 May 1716), "Madame la duchesse Royale de Savoie" (17 May 1718) or "Madame la duchesse royale" (28 Aug 1719).
Elizabeth Charlotte d'Orléans (1676-1744), third and last daughter of Monsieur (again the most senior unmarried princess at the court) is called "Madame Royale" by Dangeau in 1698 (ibid.,, 7:74) just before and after her marriage to the duke of Lorraine: "M Le Duc De Chartres devoit partir mercredi pour aller en Lorraine voir Madame Royale, sa soeur".
Mme de Sévigné's Correspondance, Jul 1676 (2:352, 1974 edition), Dec 1679 (2:770) uses it for Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, wife (and after 1675 widow) of the duke of Savoy: "Vous savez que Madame Royale ne souhaite rien tant au monde que l' accomplissement du mariage de son fils avec l'infante de Portugal".
The first three examples have in common that the French princess married "beneath her", and retention of the style "Madame Royale" may have been intended to to recall the royal rank that the person held by birth, a rank deemed superior to that of her husband at a time when neither Savoy nor Lorraine enjoyed the style of Royal Highness.
In the junior branches, starting with the children of the king's brother, the daughters were called "Mademoiselle" either followed by the given name, or by a name recalling the titles of the family: thus Gaston's eldest daughter was known as Mademoiselle, but his other daughters were Mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle d'Alençon, Mademoiselle de Valois, Mademoiselle de Chartres. This is probably due to the fact that baptisms took place quite late: Louise-Diane d'Orléans (1716-36) was baptised three days before her marriage in 1732. In 1720, Louise-Élisabeth d'Orléans (1709-42), daughter of the duc d'Orléans and called Mademoiselle de Montpensier, received the title of "Mademoiselle" after the marriage of her elder sister to the duke of Modena (Jean Buvat: Journal de la Régence, Paris 1875, 2:29). She was then the eldest unmarried French princess, excepting the abbess of Challes. She became queen of Spain in 1722, but was widowed in 1724 and returned to France where she was known as "la reine douairière d'Espagne" (dowager queen of Spain). In 1726 the duc de Bourbon (then prime minister) secured by brevet the style of Mademoiselle for his sister Louise-Anne, who was the only unmarried princess.”
all from https://www.heraldica.org/topics/france/frroyal.htm
1 note
·
View note
Text
5 choses à savoir sur la Louisiane
Ça faisait bientôt un an et demi que je n’avais pas fait d’article dans la catégorie « 5 choses à savoir » qui est pourtant une rubrique que j’adore écrire ! Vous pouvez découvrir ou retrouver ceux sur Hawaii, l’Île de Vancouver et le Vermont, et on s’attaque désormais à la Louisiane !

L’Amérique française
Vous n’êtes pas sans savoir que la Louisiane a un lien fort avec la France. Lorsque l’explorateur français René-Robert Cavelier de La Salle a pris possession du delta du Mississippi en 1682, il a nommé cette région en l’honneur du roi Louis XIV. Mais la Louisiane de l’époque n’avait pas les mêmes limites géographiques que l’État actuel, elle était bien plus étendue, prenant un tiers du pays allant du Sud de l’Alberta (Canada) jusqu’à l’Alabama ! Ce territoire reste français jusqu’en 1762, où il est cédé à l’Espagne par le traité de Fontainebleau, puis est rendu à la France en 1800 dans le cadre du traité de San Ildefonso. Cette restitution sera de courte durée puisque 3 ans plus tard Napoléon Bonaparte vend la Louisiane aux Etats-Unis pour 15 millions de dollars.

Source
La Louisiane a gardé des traces de ces décennies d’occupation française. 7% de la population de l’État est aujourd’hui francophone, plus que dans les provinces anglophones du Canada (4%) ! Ils parlent le français métropolitain, le français cadien/cajun ou le créole louisianais. Et ce malgré l’abandon de la langue par les francophones blancs esclavagistes après la guerre de Sécession, et l’interdiction d’utiliser le français dans les écoles, promulguée en 1916. En 1968, au contraire, l’enseignement du français comme deuxième langue devient obligatoire, permettant à la Louisiane de renouer avec son passé. En 2000, 12% des Louisianais s’identifiaient comme étant d’origine française. Une région en particulier, l’Acadiane, est fortement francophone, peuplée par les Cadiens, eux-mêmes descendants des Acadiens (francophones des provinces maritimes du Canada).
Et en dehors de la langue, d’autres références à la France subsistent en Louisiane : la célébration de Mardi Gras (avec ses traditionnels beignets), mais également du 14 juillet (Bastille Day) dans certains endroits, le nom de nombreuses villes (dont les plus connues La Nouvelle-Orléans, Lafayette et Bâton-Rouge), l’emblème de l’État (une fleur de lys), l’andouille et le boudin, le code civil calqué sur le Code Napoléon, certaines expressions populaires utilisées dans la langue de Molière même par les anglophones (comme « Laissons les bons temps rouler »), etc.

Des interdits loufoques
Comme dans chaque l’État, on trouve en Louisiane des lois assez cocasses. Par exemple, si vous commandez une pizza à un ami en lui faisant la surprise, vous risquez 500 dollars d’amende ! Si l’envie vous prenait de mordre quelqu’un, sachez que si vous le faites avec vos dents naturelles cela sera considéré comme une agression simple alors que si vous le faites avec votre dentier, ce sera une agression grave ! Et si vous faites une fausse promesse à quelqu’un, vous risquez un an de prison, mieux vaut donc s’abstenir... Un dernier pour la route, interdiction d’attacher des alligators à des bouches d’incendie, prière donc de les attacher ailleurs quand vous rentrez dans un magasin.

Des capitales mondiales
La Louisiane regorge de capitales mondiales : la ville de Breaux Bridge est la capitale des écrevisses, Rayne celle des grenouilles, Mamou celle de la musique cajun, Gueydan celle des canards, et Crowley celle du riz (mais fun fact, une ville d’Arkansas, Stuttgart, se proclame également capitale mondiale des canards et du riz). On trouve aussi la capitale des poissons chats, celle des fraises, celle du Jambalaya (une spécialité locale), et tant d’autres.

Source
L’État des prisons
Si certaines de ses villes sont des capitales mondiales, la Louisiane, elle, détient un triste record, celui de l’État américain qui emprisonne le plus. Mais cette performance n’est pas que nationale, elle est mondiale. La Louisiane détient par exemples 10 fois plus de prisonniers que dans toute l’Allemagne, et 3 fois plus que dans tout l’Iran. Ce curieux exploit viendrait du fait que la majeure partie des prisons louisianaises sont privées et gérées par des shérifs. C’est un véritable business, les prisons engrangent 24 dollars par jour et par prisonnier, elles ont donc tout intérêt à faire salle comble. De ce fait, des dortoirs prévus pour 200 personnes accueillent parfois 1 500 prisonniers, dans des conditions évidemment déplorables et avec un personnel en trop petit nombre.

Source Wikipédia
L’une des prisons louisianaises est d’ailleurs tristement célèbre. Le pénitencier d’Angola, qui s’étend sur 73 km² (la surface de Manhattan), est connu pour n’abriter que des détenus à perpétuité (la durée moyenne de la sentence est de 88 ans) ou condamnés à mort. 5 000 détenus y vivent, et quand ils y viennent ils savent également que c’est là qu’ils mourront. Quant à s’évader ? Impossible avec les barbelés en fils de rasoirs, les courants rapides du Mississippi, les alligators, les serpents, les ours, et le loup employé par la prison pour pourchasser les fuyards.
La prêtresse Vaudou de La Nouvelle-Orléans
L’une des figures les plus emblématiques de la Louisiane est Marie Laveau. Vivant au XIXe siècle dans le quartier du French Quarter à La Nouvelle-Orléans, Marie Laveau était une prêtresse vaudou créole. Spécialiste de la divination, de l’occultisme, de la voyance et de la magie, elle utilisait ses pouvoirs pour guérir, effrayer et hypnotiser, et avait pour animal de compagnie un serpent long de 3 mètres nommé Zombi. Femme d’affaires, elle possédait également une maison close, vendait des talismans et des philtres d’amour, et était même coiffeuse à domicile (chez de riches clients dont elle écoutait tous les potins). Elle était également connue pour ses talents de guérisseuse et pour avoir sauvé des centaines de vie. Après sa mort, nombreux sont ceux persuadés d’avoir vu son fantôme. Ce serait en réalité sa fille, qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau, qui aurait pris la relève en se faisant passer pour elle. À moins que Marie Laveau et sa fille n’étaient en fait qu’une seule et même personne...

Source Wikipédia
Flo
1 note
·
View note