#exécution provisoire jugement
Text
Comment échapper à🟥l’exécution provisoire d’un jugement ?
Comment échapper à🟥l’exécution provisoire d’un jugement ?

View On WordPress
#conséquences manifestement excessives exécution provisoire#exécution provisoire#exécution provisoire appel#exécution provisoire appel irrecevable#exécution provisoire arrêt cour d&039;appel#exécution provisoire article 700#exécution provisoire code de procédure civile#exécution provisoire cph#exécution provisoire de droit#exécution provisoire de droit et appel#exécution provisoire de droit prud&039;hommes#exécution provisoire de plein droit#exécution provisoire et appel#exécution provisoire et signification#exécution provisoire jugement#exécution provisoire non exécutée#exécution provisoire prud&039;hommes#exécution provisoire risques et périls#l exécution provisoire#référé premier président suspension exécution provisoire#suspension exécution provisoire
0 notes
Text
SNCM : massacre à la tronçonneuse
L’actuelle Délégation de Service Public (DSP) a-t-elle une chance de perdurer ? C’est loin d’être certain si l’on en croit les positions de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) et du Tribunal Administratif (TA) de Bastia.
Ces deux autorités estiment, à leur manière, que la DSP actuelle ne saurait être poursuivie très longtemps.
Le Rapporteur public du TA devrait proposer l’annulation de la DSP.
Le Président de l’Exécutif de Corse propose de stopper, le 31 Mars, la subvention versée à la SNCM dans le cadre de la DSP.
Avant de voir les différentes positions dans le détail, il faut comprendre une chose : si l’actuel contrat (DSP) venait à être rompu, il est plus que probable que cela mettrait fin à la procédure de redressement judiciaire actuellement en cours.
En effet, aucun des trois candidats à la reprise de la SNCM (voir l’article de ce blog Naufrage de la SNCM : le mensonge jusqu’au bout) ne serait intéressé par la reprise de la compagnie sans son principal actif : les subventions de la DSP.
Une fois de plus on aurait baladé tout le monde. Depuis plusieurs mois j’écris ici que l’objectif recherché par les « coalisés » de la première heure est la liquidation. Dans ce cas, on s’acheminerait vers une liquidation judiciaire. Celle-ci serait suivie d’un découpage, par morceaux, de la compagnie. Pour découper, on semble avoir choisi la tronçonneuse.
L’actuelle DSP annulée par le TA ?
Le TA de Bastia étudie un recours de la Corsica Ferries France SA (CFF) qui demande « l’annulation de la convention de DSP relative à la desserte maritime de la Corse entre le Port de Marseille et les ports de Corse conclue le 24 Septembre 2013 entre la CTC et le groupement SNCM-CMN ». Dossier 13938.
De sources concordantes, le Rapporteur Public du Tribunal Administratif de Bastia pourrait demander l’annulation de l’actuelle Délégation de Service Publique Marseille-Corse.
Le contrat de DSP a débuté en Janvier 2014 pour dix ans. Les deux délégataires sont la CMN (La Méridionale) et la SNCM.
Sur le fond, cela voudrait dire que les deux compagnies ne pourraient plus bénéficier des subventions liées au contrat.
Il est de tradition de dire que le Tribunal Administratif suit, généralement, les conclusions du Rapporteur public.
La décision du TA sera mise en délibéré, les délais peuvent varier. Ils se situent, la plus part du temps, entre une quinzaine de jours et six semaines. Un éventuel appel n’est pas suspensif.
Mais ce n’est donc pas seulement la décision qui va peser dans ce dossier. C’est aussi le calendrier.
La saison touristique approche et un arrêt brutal de la DSP pourrait poser un certain nombre de problèmes.
Il y a de fortes chances que les conclusions du Rapporteur public et le jugement du TA soient particulièrement subtils.
On pourrait y trouver une annulation, in fine, de la DSP, mais avec une espèce de calendrier rendant la décision effective après la saison estivale.
Mourir après l’été ou avant, c’est une subtilité que les personnels apprécieront surement.
L’Exécutif de Corse exécute la DSP
Le 5 Mars dernier, le Président du Conseil Exécutif de Corse, Paul Giacobbi écrit aux deux administrateurs provisoires de la SNCM. Il fait allusion à la jurisprudence Deggendorf (voir article précédent sur ce blog La suite devant les tribunaux.
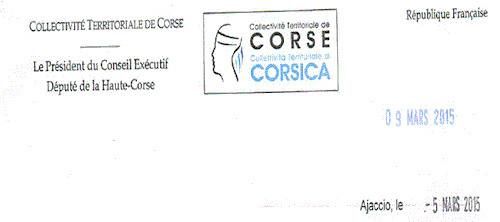
Paul Giacobbi dit avoir « adressé un courrier à Mme Margrethe Vestager, commissaire européenne (chargée de la Concurrence, DG Concurrence NDLR), le 15 Janvier”.
La lettre du Pdt de l’Exécutif parle d’une réponse de la Commissaire « le 13 Février ».
Suite à la réponse de Mme Vestager, Paul Giacobbi estime « plus sage « (…) pour la préservation des intérêts de la CTC d’envisager la cessation, après le 31 Mars 2015, du versement de la rémunération mensuelle prévue par le contrat de DSP, jusqu’à concurrence du remboursement des aides illégales ».
On peut lire la conclusion du Pdt de l’Exécutif, si dessous.

La réponse des deux administrateurs arrive, par mail, le 16 Mars.
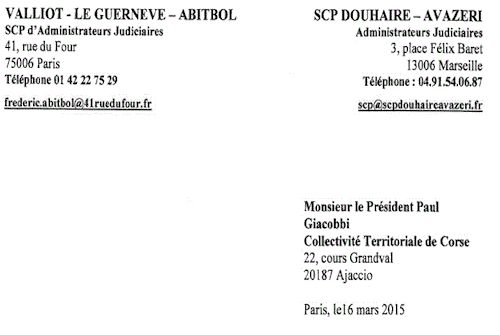
Les deux administrateurs judiciaires se montrent sévères sur la position de Paul Giacobbi.
Ils notent d’entrée que la décision du Pdt de l’Exécutif consiste à faire payer « la créance antérieure » (les 220 millions du « service complémentaire » qui seraient dû à la CTC par la SNCM dans le cadre de la précédente DSP) par les retenues sur l’actuelle DSP.
Les administrateurs estiment que cette méthode est juridiquement inapplicable.
Les deux administrateurs démontent, point par point, les arguments du PDT de l’Exécutif de Corse. Leur courrier peut-être lu ici.
On retiendra particulièrement ce chapitre : « (…) le juge des référés du Tribunal Administratif de Bastia a confirmé le 14 Janvier dernier que l’OTC ne pouvait, en l’état de la situation de redressement judiciaire de la SNCM, recouvrer ni directement, ni par compensation, les sommes mises à la charge de celle-ci par les titres de recette n°27/2014 et n°28/2014 ». (Page2 du courrier).
Cette incapacité de l’OTC à « ponctionner » la DSP avait été signalée dans un article sur le site de France 3 Corse Via Stella.
Le courrier en réponse à Paul Giacobbi, a été transmis en copie à plusieurs autorités ministérielles.
Si malgré les remarques des administrateurs la CTC retenait le versement des subventions, cela poserait rapidement un problème de trésorerie à la SNCM. C’est ce qu’ont confié les administrateurs au journal Le Marin le 18 Mars
.Cela est rendu public le jour même où le rapport des Administrateurs Judiciaires est étudié par le tribunal de commerce de Marseille. Dans ce rapport on peut lire que la trésorerie permet de continuer la période de redressement. Mais les administrateurs, après avoir pris connaissance du courrier de Paul Giacobbi notent que “(…) l’interruption du paiement des compensations dues par l’OTC (…) pourrait conduire à une impasse de trésorerie dès le mois de juin 2015″
En d’autres termes cela accélérerait un processus menant à la liquidation judiciaire. Le projet de SEM avancé par la CTC prendrait alors forme. Plus d’un observateur estime que ceci explique cela.
On notera qu’une éventuelle annulation de la DSP par le TA concernerait les deux compagnies délégataires.
En revanche, la suspension du paiement de la subvention par la CTC ne vise que la SNCM.
Des contrats rompus unilatéralement
C’est la deuxième fois que l’on fait le même coup à cette entreprise. La technique commence à être rodée: la SNCM et la CTC signent un contrat (la DSP), la compagnie réalise des investissements pour effectuer le service, puis on lui demande de rembourser et on lui retient les subventions d’un service pourtant fait (2009-2013). Voila que cela recommence pour l’actuelle DSP.
Une fois de plus la SNCM est prise dans un étau. Les deux bras (la CTC et le TA) donnent l’impression de vouloir serrer en même temps.
Une fois de plus, tous les propos antérieurs des différents pouvoirs publics ne semblent avoir été que des écrans de fumée.
Alain VERDI le 18 Mars 2015
0 notes
Photo

Mark Karpelès, l'incroyable épopée d'un baron français du bitcoin, jugé au Japon/ Upbit,HitBTC,BitForex,FxPro,,poloniex,taux de change,Marge de change
Bitseven.com - Né en Bourgogne, passionné d'informatique, devenu un baron du bitcoin, suspecté de fraude et incarcéré au Japon, Mark Karpelès, 33 ans, a connu une trajectoire chaotique, et un brin fascinante. Vendredi, il connaîtra le jugement que lui réserve la justice nippone.
Génie ou escroc? Simple geek flambeur ou pionnier du net? L'histoire de Mark Karpelès a de quoi intriguer.
Né en Côte-d'Or, il était au départ un garçon de Bourgogne vissé à son ordinateur et à ses jeux vidéos. Un passionné d'informatique, en somme, qui ne sortait pas beaucoup de chez lui. 3Enfant, il n’arrivait pas à trouver un copain qui puisse parler comme lui d’informatique, de physique quantique3, témoignait sa mère face caméra dans un documentaire de 2018.
Condamné en France, exilé au japon
Mark Karpelès commence sa carrière dans une entreprise française, Linux Cyberjoueur, qui s'aperçoit que le jeune homme trafique ses transactions de données. Des faits qui lui vaudront, en 2010, une condamnation à un an de prison avec sursis pour "accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données" et "modification frauduleuse de données".
Mais entre temps, Mark Karpelès a mis les voiles.
Il s'est envolé pour le Japon un an plus tôt. Il apprécie le pays pour sa qualité de vie et le fait qu’on s’y sente en sécurité. Il apprend le japonais et met la main sur une société, MtGox, qui lui vaudra sa notoriété et sa déchéance.
850 000 bitcoins égarés
L'entreprise est une plateforme d'échange de cartes "Magic", un jeu très prisé des "geeks". Il en fait une bourse de bitcoin.
Le succès est fulgurant: MtGox devient la plus importante plateforme d'échange de bitcoins. A son apogée, elle captait 80% des transactions.
Mais d'un jour à l'autre, MtGox égare pas moins de 850 000 bitcoins, pour une valeur de 48 milliards de yen, soit la somme colossale de 350 millions d'euros.
C'est à ce moment-là, début 2014, que Mark Karpelès sort de l'anonymat. Une caméra le filme, bien en chair et vêtu d’un simple T-Shirt, sous la neige avec un grand gobelet à la main, toisant un détenteur de bitcoin lésé, transi par le froid et flanqué d’un panneau "Mt Gox, où est notre argent ?"
Selon son patron, MtGox été victime d’une attaque informatique.
Un lit "king size" comme preuve
La justice japonaise n'a jamais pu prouver la réalité de cette attaque. Mais des enquêtes distinctes menées à l’étranger font porter les soupçons de piratage de MtGox sur un certain Alexander Vinnik, également poursuivi pour blanchiment d’argent.
La police japonaise finit par interpeller le jeune Français 1er août 2015.
Mark Karpelès est aujourd'hui mis en cause pour abus de confiance et détournement de fonds commerciaux pour une somme de 341 millions de yens (2,7 millions d’euros). Il est accusé de les avoir dépensés dans l’achat de droits de logiciels, mais aussi pour s’offrir un lit de luxe dans son appartement loué 1,4 million de yens (11 200 euros) par mois.
Symbole des achats de luxe qu'il se serait alors permis grâce à l'argent de son entreprise: un lit "king size" au coût exorbitant.
Une transformation physique
Il passera près d'un an en détention provisoire. A l'ouverture de son procès, en juillet 2017, Mark Karpelès apparaît transformé. Le garçon joufflu a laissé place à un jeune homme très aminci, propre sur lui, arborant une coupe de gendre idéal.
"Quasiment impossible d'être acquitté"
Jurant qu'il est innocent, Mark Karpelès, qui a retrouvé un emploi à Tokyo, ne s'attend toutefois pas à être relaxé: "Ailleurs qu'au Japon, j'aurais été reconnu innocent depuis longtemps. Mais ici, dès que vous êtes pris dans la machine judiciaire, il est quasiment impossible d'être acquitté", a-t-il déclaré cette semaine au quotidien Les Echos.
"J'espère juste ne pas retourner en prison ce vendredi soir", confie-t-i. Dix ans de prison ont été requis par le parquet à son encontre.
BitSEVEN | Echange mercantile de Bitcoin Echangez avec un maximum de 100x de profit
Echangez Bitcoin et autres cryptocurrences avec un maximum de 100x de profit Exécution rapide, frais bas, disponible seulement sur BitSEVEN
https://www.bitseven.com
#Binance#LBanque#TOPBTC#BitBanque#Layvecoin#BTCBOX#LATOKEN#negociecoins#bitbay#bitseven#coine xtchange
0 notes
Text
Le dictionnaire juridique : Tout savoir sur le vocabulaire juridique et administratif
New Post has been published on https://www.juristique.org/cours/dictionnaire-juridique
Le dictionnaire juridique : Tout savoir sur le vocabulaire juridique et administratif
Le vocabulaire juridique et administratif est indispensable de le maitriser pour comprendre une décision judiciaire et comprendre les rouages de la justice.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Ce vocabulaire peut être utilisé aussi bien dans la correspondance juridique, la note administrative, la note de service que dans les communiqués.
Ci-dessous la liste des principaux termes employés :
Le vocabulaire juridique et administratif
Abroger / Abrogation Annulation d’une disposition législative ou réglementaire (un texte ne peut être abrogé que par un texte ayant au moins la même valeur que le premier) Adopter Approuver par un vote.
Le projet de loi est adopté par la Chambre des députés
Affecter / Affectation Désignation d’un fonctionnaire à un emploi, une fonction.
Prononcer une affectation
Renoncer à une affectation Destiner à un usage déterminé.
Affecter une somme à telle dépense
Agrément Approbation donnée par l’autorité compétente.
Soumettre un dossier à l’agrément du ministre
Soumettre une demande à son agrément
Ajourner / Ajournement Renvoi d’une délibération, d’une décision, d’une affaire à une date ultérieure. Aménagement Adaptation destinée à faciliter l’application d’une mesure.
Procéder à des aménagements
Amendement Modification apportée à un projet de loi ou à une proposition de loi.
Le projet de loi a fait l’objet de nombreux amendements lors de son débat devant la Chambre des députés.
Ampliation L’ampliation est la copie authentique d’un document dont l’original est conservé par le service. S’emploie surtout pour les documents rédigés dans une forme « solennelle » (p. ex. les arrêtés).
Ampliation d’un arrêté de nomination
Annuler / Annulation Rendre, déclarer nul ou sans effet, supprimer. Application En application de… ou par application de… Autres formules courantes à utiliser dans le contexte d’une loi, d’un règlement : entrer en application, devenir effectif, prendre effet. Approuver / Approbation Acte par lequel l’autorité administrative compétente donne son accord sur une proposition et lui permet alors de prendre effet. Arrêté Décision écrite d’une autorité administrative.
L’arrêté ministériel
Attester / Attestation Certificat par lequel une autorité administrative se porte garante de l’authenticité d’un fait administratif. Avenant Acte par lequel les clauses d’un contrat en cours peuvent être modifiées. Circulaire Document d’ordre interne qui a pour objet de préciser les modalités pratiques d’application d’une réglementation et de faciliter ainsi l’action des services d’exécution. Elle n’a pas à être connue du public, elle ne lui est pas opposable. Compétence Aptitude reconnue légalement à une autorité d’effectuer certains actes.
Cette affaire est de la compétence du maire.
Contentieux Toute affaire qui peut être portée devant les tribunaux. Ensemble des litiges soumis aux tribunaux. Service qui s’occupe des affaires litigieuses. Déférer Porter devant une juridiction. Déroger / Dérogation Exception par rapport à ce qui est prévu par la réglementation.
Les dérogations à l’obligation scolaire sont exceptionnelles.
En aucun cas, il ne sera accordé de dérogation.
Dessaisir Enlever à une personne ou à un service une affaire qui lui avait été initialement confiée. Détacher / Détachement Position d’un fonctionnaire provisoirement placé hors du cadre de son administration ou service d’origine, pour remplir d’autres fonctions, en continuant de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite.
Solliciter son détachement
Prononcer un détachement
Dévolu Attribué, réservé.
En vertu des pouvoirs qui lui ont été dévolus…
Différer Même sens qu’ajourner. Disponibilité Position du fonctionnaire placé provisoirement sans traitement hors de ses fonctions, mais qui conserve son grade et son droit à la retraite.
Être en disponibilité
Solliciter sa mise en disponibilité
Disposition Chacun des points que règle une loi, un arrêté…
Les dispositions de l’article 3 du règlement
Se référer aux dispositions de la loi
Prendre des dispositions
Effet Effet d’une décision : conséquences, application de cette décision.
Avec effet au… (date d’application)
Prendre effet au… (devenir applicable à une certaine date)
Date d’effet… (date à laquelle une décision devient applicable)
Émaner Provenir de, découler de.
Les textes émanant de l’administration centrale…
Émarger / Émargement Apposition de sa signature en marge d’un compte, d’un état, d’un inventaire pour prouver qu’on a eu connaissance du document. Exécution Exécuter une décision, c’est la rendre effective. La formule pour exécution apparaît souvent dans les circulaires, après l’indication du destinataire, afin de préciser l’autorité administrative chargée d’appliquer la décision.
La formule pour information est utilisée lorsque les documents sont adressés à une autorité administrative qui n’est pas chargée d’appliquer la décision, mais qui doit être informée de celle-ci.
Exécutoire Qui doit être mis en exécution, qui donne pouvoir de procéder à une exécution.
Un arrêté ministériel pris en application des dispositions d’un règlement est exécutoire de plein droit.
Exemption Dispense d’une charge ou de l’obligation d’effectuer un service.
Exemption d’avoir à subir certaines épreuves d’examen
Forclos / Forclusion Personne qui a laissé prescrire un droit parce que le délai légal est expiré. Perte de la faculté de faire valoir un droit par l’expiration d’un délai.
Le recours qu’il a introduit devant le tribunal administratif était frappé de forclusion.
Gré Savoir gré de quelque chose à quelqu’un : être reconnaissant. Formule destinée à donner au style un ton courtois.
Je vous saurais gré de… (et non pas : je vous saurais gré si…) (savoir au conditionnel)
Habiliter / Habilitation Aptitude légale à accomplir un acte, prendre une décision, exercer une certaine activité administrative.
Service habilité à délivrer une attestation
Recevoir une habilitation
Instruction Prescription donnée par l’autorité supérieure relative à l’interprétation et à l’application d’une loi, d’un règlement.
Recherches et formalités nécessaires pour mettre une affaire soit civile, soit pénale, en état d’être jugée.
Mesure Acte qui découle d’une décision prise par une autorité administrative.
Faire l’objet de mesures disciplinaires
Minute Au sens juridique, la minute d’un jugement ou d’un acte notarié est l’original qui reste en demeure soit auprès du greffe du tribunal, soit à l’étude du notaire. Par extension, dans l’administration est appelée minute l’original d’un document annoté par les différents échelons hiérarchiques concernés. Notifier / Notification Porter à la connaissance d’une personne morale ou physique une mesure la concernant.
Notifier une décision Faire parvenir à quelqu’un, dans les formes légales, un document juridique.
Notification d’un jugement
Précité Que l’on vient de citer.
L’arrêté précité stipule en effet que…
Préjuger Préjuger une affaire : la juger par anticipation. Préjuger d’une affaire : se faire une opinion. Projet de loi Texte d’une future loi soumis par le gouvernement au vote de la Chambre des députés. Promulguer / Promulgation Acte par lequel le président atteste la teneur de la loi et en ordonne la publication et l’exécution. Proposition de loi Texte d’une future loi soumis par un ou plusieurs députés au vote de la Chambre des députés. Proroger / Prorogation Action de prolonger, pendant une période déterminée, les effets de dispositions limitées dans le temps. Publication Ce mot désigne surtout le fait, pour l’administration, de porter à la connaissance des administrés les textes officiels par insertion dans le Mémorial. Rapporter / Rapporteur Exposer les lignes générales d’un texte ou des travaux d’une commission. La personne qui assume cette charge est le rapporteur. Abroger, annuler.
Rapporter un décret, une nomination, une mesure
Réception Accuser réception : faire savoir que l’on a reçu. Accusé de réception : pièce que le destinataire d’un document adresse à son expéditeur pour l’assurer qu’il a bien reçu son envoi. Reconduire / Reconduction Renouvellement, prolongation, report.
Décider la reconduction d’une mesure, d’un budget
Référence Indication(s) du (des) document(s) au (x) quel(s) on se rapporte.
Par référence à l’arrêté du…
Règlement Décision administrative de portée générale. Relever Dépendre de.
Cette affaire ne relève pas de ma compétence. Mesure administrative à l’égard d’un fonctionnaire destinée à lui retirer ses fonctions.
Relever une personne de ses fonctions
Reporter / Report Renvoi à une date ultérieure. Réserve Restriction. Formuler des réserves, émettre des réserves : ne pas approuver entièrement.
Sous réserve de : à condition de. Sous toutes réserves : sans garantie.
Statuer Prendre une décision sur une affaire, un cas. — La commission est appelée à statuer sur une mutation. Surseoir Décision de ne pas mettre immédiatement en œuvre les dispositions d’un texte.
Surseoir à l’application d’un texte
Valider / Validation Action de donner à un document une valeur juridique, soit définitivement, soit pour une période déterminée.
Validation d’une carte de séjour pour un Étranger
Vigueur En vigueur : en application.
La réglementation en vigueur à cette date Entrer en vigueur : commencer par être appliqué.
Cet arrêté entrera en vigueur le mois prochain.
Visa Formule ou sceau accompagné d’une signature que l’on appose sur un acte pour le rendre régulier ou valable. Viser Viser un document : y apposer sa signature pour attester que l’on en a pris connaissance. C’est aussi se référer à un ou plusieurs textes lorsqu’on élabore un document pris en application de ceux-ci.
Apprendre le vocabulaire juridique et administratif
Les locutions administratives
Les locutions administratives ci-après peuvent être utilisées aussi bien dans la correspondance, la note administrative et la note de service que dans les communiqués et notes aux rédactions.
Addition De plus, par ailleurs, en outre, de surcroît, du reste, qui plus est, de même, mais aussi, mais encore, d’autre part Affirmation Assurément, bien entendu, bien sûr, certainement, certes, de toute évidence, évidemment, de toute façon But Afin de, afin que, à cette fin, à ces fins, à toutes fins utiles, à l’effet de, à cet effet, dans le but de, dans l’intention de, en vue de, aux fins de, ayant pour objet de, à titre de, avec l’objectif de, de façon que, de manière que, de sorte que, pour que Cause A la suite de, attendu que, du chef de, de ce chef, étant donné que, parce que, pour cette raison, pour la raison que, puisque, considérant que, en considération de, eu égard à, en raison de, compte tenu de, vu que, à partir de, puisque, du moment où, du moment que, d’après Concession Quoique, encore que, en admettant que, bien que, malgré que, quand bien même, quand même, certes Conclusion Dans ces conditions, aussi, en tout cas, en tout état de cause, en conclusion, en conséquence, par conséquent, en définitive, en résumé, en somme, ainsi, pour terminer, pour conclure, dès lors, finalement, donc Explication Autrement dit, ce qui revient à dire, ainsi, c’est-à-dire, en d’autres termes, à savoir, soit, aussi (+ inversion verbe-sujet), c’est pourquoi, de ce fait, en conséquence, par conséquent, pour toutes ces raisons Opposition Cependant, contrairement à, d’un côté/de l’autre, d’une part/d’autre part, en revanche, mais, néanmoins, par contre, pourtant, toutefois, à l’opposé, au contraire, alors que, malgré que, or Principe D’une façon générale, d’une manière générale, en général, en règle générale, en principe, en tout état de cause, en tout cas, dans tous les cas, à tous égards Référence Précité, susmentionné, susvisé, dont il est fait mention, visé en référence, cité en référence, ci-dessus référencé, dont il est question, en question, dont il s’agit Restriction / exclusion A l’exception de, excepté, en dépit de, pour autant que, sauf, sauf pour, sauf que, sauf si, sans que, sans préjudice de, sous réserve de, hormis, à l’exclusion de, cependant, néanmoins, toutefois, mis à part Temps / délai Tout d’abord, en premier lieu, en second lieu, ensuite, enfin, actuellement, à l’avenir, à votre meilleure convenance, aussitôt que possible, d’abord, dans l’immédiat, dans le meilleur délai possible, dès maintenant, désormais, dorénavant, d’ores et déjà, sans délai, sans tarder, dans un délai de, au fur et à mesure que, dès que les circonstances le permettront, le moment venu, entre-temps, une fois que, en attendant que, à compter de, à dater de Transition Au demeurant, d’ailleurs, par ailleurs, enfin, d’autre part, du reste, en attendant, en fait, pour ce qui est de, quant à, en ce qui concerne, en somme, or, alors, ensuite, du reste
0 notes
Text
L'autorité publique n'est habilitée à intervenir que pour entretenir les bâtiments ou le mobilier qui lui appartiennent, ou sur la base de ses pouvoirs de police lorsque l'ordre ou la sécurité publics sont menacés. Mais même ici, le ministre du culte reste chargé de la police intérieure de l'église aussi longtemps qu'il s'agit de préserver l'exercice du culte : ainsi, si des perturbateurs se sont introduits dans l'église, c'est à lui qu'il incombe en premier lieu de leur ordonner de sortir [3].
Il peut aussi réclamer l'intervention de l'autorité publique, qui pourra dresser procès-verbal des infractions commises, expulser ou arrêter les perturbateurs, sur le fondement de l'article 32 de la loi de 1905 qui punit de peines d'amende et d'emprisonnement toute personne qui aura empêché ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Puisqu'il s'agit de punir l'entrave à la liberté du culte, il semble logique que l'autorité publique ne puisse intervenir qu'à la demande du curé, ou tout au moins lorsque le délit d'entrave est sans aucun doute constitué, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsque, comme dans l'affaire qui nous intéresse, l'église est occupée avec son accord.
L'autorité de police — maire, préfet ou préfet de police — ne peut donc intervenir de son propre chef que dans l'intérêt de la sécurité publique : ainsi a été jugée légale la décision du maire, prise après avis des hommes de l'art, ordonnant la fermeture provisoire de l'église et en interdisant l'accès aux fidèles en raison du risque d'effondrement de l'édifice [4].
En résumé, sur ce premier point, l'autorité publique ne saurait intervenir pour faire évacuer une église occupée sans que son intervention ait été sollicitée par le curé affectataire. À moins que l'ordre public entendu au sens le plus strict, qui inclut exclusivement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, ne soit menacé.
Or, on ne peut prétendre que l'occupation pacifique d'une église, surtout si elle a lieu avec l'assentiment du curé affectataire, constitue une menace pour l'ordre public suffisamment caractérisée pour autoriser l'autorité publique à intervenir au nom de ses pouvoirs de police. Elle ne porte par elle-même atteinte ni à la sécurité, ni à la tranquillité publiques.
À supposer même — ce qui n'a pas été le cas — que des manifestations extérieures à l'église et liées à l'occupation auraient troublé l'ordre public, cela n'aurait pas justifié une intervention à l'intérieur de l'église. Tout au plus pourrait-on imaginer l'hypothèse où la dégradation des conditions d'hygiène à l'intérieur de l'église atteindrait un point tel qu'elle représenterait aux yeux de l'autorité de police une menace pour la salubrité publique justifiant qu'elle prenne des mesures pour parer à cette menace.
Mais même dans le cas où l'autorité publique est habilitée à agir, soit parce qu'elle y a été invitée par l'autorité ecclésiastique, soit parce que l'ordre public est immédiatement menacé, elle ne peut en principe utiliser la force.
L'autorité publique peut-elle
faire évacuer une église par la force ?
La réponse, là encore, est en principe négative, par simple application des règles générales qui régissent le recours à la force par l'administration.
L'administration dispose du privilège de la décision exécutoire : c'est-à-dire qu'elle peut imposer aux administrés des obligations, leur adresser des ordres auxquels ils sont tenus d'obéir. Ainsi, elle avait la possibilité, si les conditions de son intervention étaient remplies (soit parce qu'elle aurait été saisie d'une demande en ce sens, soit parce que l'ordre public était immédiatement menacé), d'ordonner aux occupants d'évacuer l'église.
Mais en cas de résistance des intéressés, si ceux-ci n'obéissent pas spontanément, l'administration n'a pas pour autant le droit de recourir à la force pour assurer l'exécution de ses décisions : elle doit s'adresser préalablement au juge, soit pour qu'il prononce une condamnation si les faits commis constituent une infraction pénalement réprimée (telle l'entrave à l'exercice du culte), soit pour qu'il l'autorise à utiliser la force publique.
Le recours à l'exécution forcée sans autorisation préalable du juge n'est possible que dans des hypothèses limitées. Les règles qui régissent cette exécution forcée ont été formulées dans l'arrêt du tribunal des conflits du 2 décembre 1902, Sté immobilière de Saint-Just. Le recours à la force est possible dans trois hypothèses :
1 lorsqu'il est expressément autorisé par la loi (ainsi, la reconduite à la frontière ou l'expulsion d'un étranger peuvent être exécutées par la force depuis que l'ordonnance de 1945 a été modifiée en ce sens par la loi Bonnet de 1980 puis par les lois ultérieures ;
2 lorsqu'il y a urgence ;
3 lorsqu'il n'existe aucune voie de droit, notamment judiciaire, permettant de sanctionner le comportement de l'administré récalcitrant, de sorte que l'administration n'a pas d'autre choix que le recours à la force pour assurer l'effectivité de ses décisions.
Dans le cas qui nous occupe, il n'existe évidemment aucune loi permettant de recourir à la force pour faire évacuer une église occupée.
Il existait en revanche plusieurs voies de droit permettant de sanctionner le comportement de ceux qui l'occupaient ou de les contraindre à évacuer les lieux : ainsi, l'autorité ecclésiastique pouvait saisir le juge civil pour faire ordonner l'évacuation de l'église occupée (il a été jugé qu'en cas d'occupation d'une église par des personnes en opposition avec le desservant ce dernier pouvait demander au juge des référés de prononcer l'expulsion des occupants, et c'est du reste ce qui s'est passé à Saint-Nicolas du Chardonnet, à ceci près que le jugement n'a jamais été exécuté) ; le maire, en tant que représentant de la commune propriétaire de l'église, pouvait saisir le tribunal administratif d'une action ayant le même objet s'il estimait l'occupation illégale ; et des poursuites pénales étaient possibles pour entrave à l'exercice du culte.
Seule l'urgence pouvait donc justifier le recours à la force pour faire évacuer l'église. L'urgence s'entend comme un péril immédiat pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques. La notion d'urgence inclut donc à la fois un élément temporel — la nécessité d'agir vite — et un élément de gravité — car s'il y a urgence à agir, c'est qu'il faut faire face à une situation grave.
Mais dans aucune des hypothèses où il y a eu évacuation par la force les conditions de l'urgence n'étaient réunies. La nécessité de rétablir rapidement le libre exercice du culte, à supposer qu'il ait été entravé, n'est certainement pas constitutive de l'urgence au sens où l'entend la jurisprudence.
En revanche, une menace imminente pour l'ordre public aurait pu justifier le recours à la force : des bagarres, un début d'incendie, etc. À supposer même que la salubrité ait été menacée, l'urgence n'était pas telle qu'il eût été impossible à l'administration de s'adresser préalablement au juge pour lui demander l'autorisation de faire évacuer l'église.
Telle est en effet la règle : dès lors qu'on ne se trouve pas dans l'une des trois hypothèses où le recours à la force est possible, l'administration ne peut y recourir qu'après avoir demandé l'autorisation au juge. Si elle estime qu'une intervention rapide est nécessaire, elle peut saisir le juge des référés (le président du tribunal administratif) qui statuera en urgence. Le référé est du reste une procédure couramment utilisée par l'administration lorsqu'elle veut faire expulser des occupants sans titre du domaine public : ce qui prouve bien que le recours à la force n'est pas possible dans cette hypothèse. L'évacuation par la force, dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence, est illégale. Et on peut estimer que dans aucune des trois hypothèses où il y a eu évacuation forcée ces conditions n'étaient réunies.
À Saint-Ambroise, on aurait pu demander au juge l'évacuation de l'église au nom de l'entrave à la liberté du culte, compte tenu de l'opposition du curé de la paroisse à l'occupation de l'église, mais rien ne justifiait l'exécution forcée ; dans le cas de Saint-Bernard, l'autorité publique aurait pu éventuellement fonder la demande d'évacuation de l'église sur des motifs de salubrité ou de santé publique dont il aurait appartenu au juge d'apprécier le bien fondé, mais il n'y avait certainement pas urgence à intervenir au point de permettre de se passer de l'autorisation du juge.
Dans le cas de Notre-Dame de Belleville, aucun motif ne justifiait l'intervention de l'autorité publique pour faire évacuer l'église, a fortiori sous la forme du recours à la force publique.
Il faut enfin rappeler que même dans le cas où le recours à la force est justifié — notamment par l'urgence— il faut une mise en demeure préalable des administrés, auxquels il faut laisser la possibilité d'exécuter volontairement l'ordre d'évacuation. Ni dans le cas de l'évacuation de Saint-Ambroise, ni dans le cas de l'évacuation de Saint-Bernard il n'y a eu une telle mise en demeure. Et l'usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire, ce qui de toute évidence n'a pas été le cas à Saint-Bernard
https://www.gisti.org/doc/plein-droit/38/sans-papiers.html
« LE VERBE EST PLUS FORT QUE LA RÉPRESSION »
#GiletsJaunes #France #ViveLaRépublique #FREXIT #CGT #FO #CFECGC #CFTC #CGTFO 🇫🇷🔵⚪️🔴 #Justice #Référendum #RéformedesRetraites #Constitution #UniContreLeSystème #LePeupleUni #Brexit #BlackRock #Démocratie #Ric
#CEMAT #CEMM #CEMAA #OIA #SPV #BSPP #BMPM #UIISC #ForMiSC
0 notes