#anacharsis cloots
Text
The Horizon Which One Beholds From the Summit of a Barricade
The situation of all in that fatal hour and that pitiless place, had as result and culminating point Enjolras’ supreme melancholy.
Enjolras bore within him the plenitude of the revolution; he was incomplete, however, so far as the absolute can be so; he had too much of Saint-Just about him, and not enough of Anacharsis Cloots; still, his mind, in the society of the Friends of the A B C, had ended by undergoing a certain polarization from Combeferre’s ideas; for some time past, he had been gradually emerging from the narrow form of dogma, and had allowed himself to incline to the broadening influence of progress, and he had come to accept, as a definitive and magnificent evolution, the transformation of the great French Republic, into the immense human republic. As far as the immediate means were concerned, a violent situation being given, he wished to be violent; on that point, he never varied; and he remained of that epic and redoubtable school which is summed up in the words: “EightyNinety-three.”
Enjolras was standing erect on the staircase of paving-stones, one elbow resting on the stock of his gun. He was engaged in thought; he quivered, as at the passage of prophetic breaths; places where death is have these effects of tripods. A sort of stifled fire darted from his eyes, which were filled with an inward look. All at once he threw back his head, his blond locks fell back like those of an angel on the sombre quadriga made of stars, they were like the mane of a startled lion in the flaming of an halo, and Enjolras cried:

“Citizens, do you picture the future to yourselves? The streets of cities inundated with light, green branches on the thresholds, nations sisters, men just, old men blessing children, the past loving the present, thinkers entirely at liberty, believers on terms of full equality, for religion heaven, God the direct priest, human conscience become an altar, no more hatreds, the fraternity of the workshop and the school, for sole penalty and recompense fame, work for all, right for all, peace over all, no more bloodshed, no more wars, happy mothers!

To conquer matter is the first step; to realize the ideal is the second. Reflect on what progress has already accomplished. Formerly, the first human races beheld with terror the hydra pass before their eyes, breathing on the waters, the dragon which vomited flame, the griffin who was the monster of the air, and who flew with the wings of an eagle and the talons of a tiger; fearful beasts which were above man. Man, nevertheless, spread his snares, consecrated by intelligence, and finally conquered these monsters. We have vanquished the hydra, and it is called the locomotive; we are on the point of vanquishing the griffin, we already grasp it, and it is called the balloon. On the day when this Promethean task shall be accomplished, and when man shall have definitely harnessed to his will the triple Chimæra of antiquity, the hydra, the dragon and the griffin, he will be the master of water, fire, and of air, and he will be for the rest of animated creation that which the ancient gods formerly were to him. Courage, and onward! Citizens, whither are we going? To science made government, to the force of things become the sole public force, to the natural law, having in itself its sanction and its penalty and promulgating itself by evidence, to a dawn of truth corresponding to a dawn of day. We are advancing to the union of peoples; we are advancing to the unity of man. No more fictions; no more parasites. The real governed by the true, that is the goal.

Civilization will hold its assizes at the summit of Europe, and, later on, at the centre of continents, in a grand parliament of the intelligence. Something similar has already been seen. The amphictyons had two sittings a year, one at Delphos the seat of the gods, the other at Thermopylæ, the place of heroes. Europe will have her amphictyons; the globe will have its amphictyons. France bears this sublime future in her breast. This is the gestation of the nineteenth century. That which Greece sketched out is worthy of being finished by France.

Listen to me, you, Feuilly, valiant artisan, man of the people. I revere you. Yes, you clearly behold the future, yes, you are right. You had neither father nor mother, Feuilly; you adopted humanity for your mother and right for your father. You are about to die, that is to say to triumph, here. Citizens, whatever happens to-day, through our defeat as well as through our victory, it is a revolution that we are about to create. As conflagrations light up a whole city, so revolutions illuminate the whole human race. And what is the revolution that we shall cause? I have just told you, the Revolution of the True.

From a political point of view, there is but a single principle; the sovereignty of man over himself. This sovereignty of myself over myself is called Liberty. Where two or three of these sovereignties are combined, the state begins. But in that association there is no abdication. Each sovereignty concedes a certain quantity of itself, for the purpose of forming the common right. This quantity is the same for all of us. This identity of concession which each makes to all, is called Equality. Common right is nothing else than the protection of all beaming on the right of each. This protection of all over each is called Fraternity. The point of intersection of all these assembled sovereignties is called society. This intersection being a junction, this point is a knot. Hence what is called the social bond. Some say social contract; which is the same thing, the word contract being etymologically formed with the idea of a bond. Let us come to an understanding about equality; for, if liberty is the summit, equality is the base. Equality, citizens, is not wholly a surface vegetation, a society of great blades of grass and tiny oaks; a proximity of jealousies which render each other null and void; legally speaking, it is all aptitudes possessed of the same opportunity; politically, it is all votes possessed of the same weight; religiously, it is all consciences possessed of the same right.

Equality has an organ: gratuitous and obligatory instruction. The right to the alphabet, that is where the beginning must be made. The primary school imposed on all, the secondary school offered to all, that is the law. From an identical school, an identical society will spring. Yes, instruction! light! light! everything comes from light, and to it everything returns. Citizens, the nineteenth century is great, but the twentieth century will be happy.

Then, there will be nothing more like the history of old, we shall no longer, as to-day, have to fear a conquest, an invasion, a usurpation, a rivalry of nations, arms in hand, an interruption of civilization depending on a marriage of kings, on a birth in hereditary tyrannies, a partition of peoples by a congress, a dismemberment because of the failure of a dynasty, a combat of two religions meeting face to face, like two bucks in the dark, on the bridge of the infinite; we shall no longer have to fear famine, farming out, prostitution arising from distress, misery from the failure of work and the scaffold and the sword, and battles and the ruffianism of chance in the forest of events. One might almost say: There will be no more events. We shall be happy. The human race will accomplish its law, as the terrestrial globe accomplishes its law; harmony will be re-established between the soul and the star; the soul will gravitate around the truth, as the planet around the light.

Friends, the present hour in which I am addressing you, is a gloomy hour; but these are terrible purchases of the future. A revolution is a toll. Oh! the human race will be delivered, raised up, consoled! We affirm it on this barrier. Whence should proceed that cry of love, if not from the heights of sacrifice? Oh my brothers, this is the point of junction, of those who think and of those who suffer; this barricade is not made of paving-stones, nor of joists, nor of bits of iron; it is made of two heaps, a heap of ideas, and a heap of woes. Here misery meets the ideal.

The day embraces the night, and says to it: ‘I am about to die, and thou shalt be born again with me.’ From the embrace of all desolations faith leaps forth. Sufferings bring hither their agony and ideas their immortality. This agony and this immortality are about to join and constitute our death. Brothers, he who dies here dies in the radiance of the future, and we are entering a tomb all flooded with the dawn.”

Enjolras paused rather than became silent; his lips continued to move silently, as though he were talking to himself, which caused them all to gaze attentively at him, in the endeavor to hear more. There was no applause; but they whispered together for a long time. Speech being a breath, the rustling of intelligences resembles the rustling of leaves.
19 notes
·
View notes
Note
I think Couthon said something similar about sodomy as Condorcet i.e. that it shouldn’t be encouraged but also was mostly neutral if done by consenting parties and shouldn’t be illegal. (Couthon seems really progressive when it comes to gender/sexuality stuff in general) Anacharsis Cloots (the world parliament “personal enemy of God” guy) is the only frev figure I know that actively defended it and thought sodomy could be a positive both legally and morally.
!!!!!!!! DUDE THANKS! i can't track the sources right now but im not surprised of Couthon being super based as always. I knew about Cloots, how could i forget about him!
10 notes
·
View notes
Text
Pío Baroja
(28 December 1872 – 30 October 1956)
"I have always been a liberal radical, an individualist and an anarchist. In the first place, I am an enemy of the Church; in the second place, I am an enemy of the State. When these great powers are in conflict I am a partisan of the State as against the Church, but on the day of the State's triumph, I shall become an enemy of the State. If I had lived during the French Revolution, I should have been an internationalist of the school of Anacharsis Cloots; during the struggle for liberty, I should have been one of the Carbonieri."
3 notes
·
View notes
Text

Under the Eyes of the Revolution: Les Miserables and the First Republic by Madeleine
Much like its role in Les Misérables, the French Revolution of 1789 was an incorporeal yet ever-present actor in the tumultuous world of nineteenth-century French politics. This presentation situates Les Amis within the context of this tumult. Designed to serve as an introduction to 1789, this presentation provides a brief summary of the Revolution and its impact on nineteenth-century political thought. It examines the political philosophies embodied by each of the Amis, comparing them to each other and to the philosophers and statesmen Hugo references. What does Hugo mean when he describes Enjolras as having “too much of Saint-Just about him, and not enough of Anacharsis Cloots,” and what can such allusions tell us about Hugo’s interpretation of the French Revolution and its legacy?
Make sure to get your tickets before the 12th July deadline!
Scholarships covering the complete cost of admission are still available - just email [email protected] to request one!
If you’re interested in volunteering as a discord or zoom moderator for the con, please fill out this form and join our planning discord.
2 notes
·
View notes
Text
That Prussian guy in the French Revolution, Augustus Gloop
4 notes
·
View notes
Photo

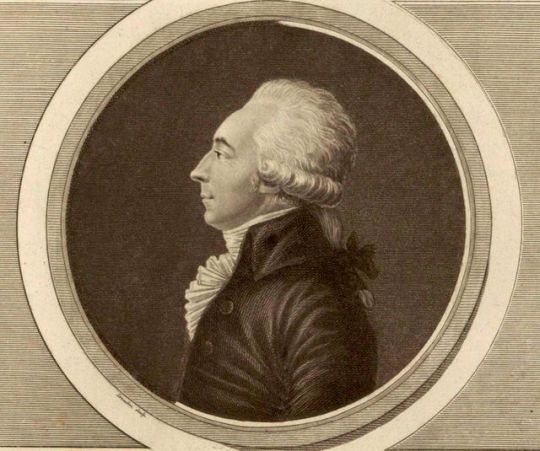
Robespierre against Cloots (22 Frimaire, Year II)
Following the exclusion of Duhem from the Jacobin Club, Anacharsis Cloots, representative of Oise, was summoned for a scrutin épuratoire. When asked about his country of origin, he responded: « I am from Prussia, future department of the French Republic ». Cloots then was requested to explain his relations with the bankers Vandenyver, who had been condemned to death by the Tribunal on 17 Frimaire, Year II. Robespierre took the floor, attacking Cloots for his role in the movement of dechristianization and in the establishment of the "Cult of Reason". He closed his speech by demanding the exclusion of all bankers, foreigners and former noblemen from the Jacobin Club ; this proposal was adopted and applied to Cloots, who was a foreigner and nobleman.
Robespierre. Can we regard a German baron as a patriot? Can we regard a man who has more than ten thousand livres of income as a sans-culotte? Can we believe that a man who lives only with bankers, the counter-revolutionary enemies of France, is a republican? No, Citizens, let us be cautious towards foreigners who want to appear more patriotic than the French themselves. Cloots, you spend your life with our enemies, with the agents and the spies of the foreign powers; like them, you are a traitor who has to be monitored. Citizens, Cloots just explained everything to you; he knows the Vandenyvers, and knew that they are counter-revolutionaries. He assures you that he has ceased to see them, but even this is a trickery of the Prussian. Thus, why, Cloots, if you knew that the Vandenyvers are counter-revolutionaries, did you come to request their release at the Committee of General Security: speak, what do you have to respond?
But these charges are insignificant when dealing with M. Cloots. His treasons stem from a system [that is] hatched better. Citizens, you have at times seen him at the feet of the tyrant and of the Court, at times kneeling before the people... When a liberticidal faction dominated in our midst, when all the leaders held the reigns of the government, Cloots embraced the party of Brissot and Dumoriez. When they served the foreign powers, and made us declare war, the Prussian Cloots frantically supported their opinions; he made patriotic donations, extolled the generals, and wanted us to attack the Universe... His conduct attracted the scorn of the faction nonetheless. His amour-propre made him publish a pamphlet titled « Ni Marat ni Roland ». Therein, he clouted the latter, but he clouted the Montagne even more.
I accuse Cloots of having increased the number of the partisans of federalism. His extravagant opinions, his obstinacy to speak of a Universal Republic, to inspire the rage of conquests, could produce the same effect as the seditious declamations and writings of Brissot and Lanjuinais. And how could M. Cloots take an interest in the unity of the Republic, in the interests of France: scorning the title of French citizen, he only wanted the one of citizen of the World. Ah! if he had been a good Frenchman, would he have wanted us to attempt the conquest of the Universe?... And would he have wanted us to make a French department out of Mutapa? Would he have wanted us to declare war on the Earth and on all elements? Could these allegedly philosophical ideas enter the head of a sensible man, or the one of a good man?
There is a third crisis that M. Cloots will be able to boast about, but it will only be before imbeciles or rascals... I do not want to speak of the movement against religion, a movement which, ripened by time and reason, could have become excellent, but whose violence could bring about the greatest misfortunes, and which have to be attributed to the calculations of the aristocracy... Gobel, whose entire political conduct you know, was among these priests who complained about the reduction of their salaries, and whose ambition wanted to revive the hydra of the ci-devant clergy... And nonetheless, we have seen this bishop suddenly changing his tone, language and clothes, appearing at the bar of the National Convention, and offering his lettres de prêtrise to us. Ah! Cloots, you know about your nocturnal visits and complots. We know that, covered by the shadows of the night, you have prepared this philosophical masquerade with the bishop Gobel. You anticipated the fatal consequences that such approaches can have; by this very fact, they only further pleased our enemies. Cloots undoubtedly believed that the true friends of the people had taken the bait and were fooled by these masquerades. He came to boast about this pleasant achievement at the Committee... « But, I told him, you have recently told us that it was necessary to enter the Netherlands, to give them independence, and to treat the inhabitants like brothers... So, why do you seek to alienate the Belgians from us by upsetting prejudices to which they are, as you know, strongly attached? ... – Oh! oh! he responded, the damage was already done... One has treated us like impious [non-believers] a thousand times. – Yes, but there were no events. » (Cloots grew pale, did not dare to respond and left.)
Citizens, will you regard as a patriot a foreigner who wants to be more democratic than the French and whom one sees in the Marais at times, at times above the Montagne? because Cloots was never in the Montagne; he was always above or below. He never was the defender of the French people, but the one of humankind. Alas! unfortunate patriots, what can we do, surrounded by enemies who fight amidst our ranks! They cover themselves with masks, they tear us apart, and we can feel the wounds without knowing where the murderous bolts are coming from. We can no longer do anything, our mission is completed. The wisest laws, by means of traitors who are spread in all Committees of the Assembly, in all administrations, in all offices, turn to the disadvantage of the Republic. Our enemies, risen even above the Montagne, take us from behind in order to deliver mortal blows to us. Let us stay awake, for the death of the patrie is not far away. Ah! no, the one of the patriots does not matter, they have to make this sacrifice. But, alas! the one of the patrie is inevitable, if the cowards are not recognised.
Citizens, I pray you to reflect: when we have decreed rigorous laws against the nobles, Cloots was excepted; when he have decreed the arrest of the foreigners, Cloots was been excepted; what do I say, excepted! in the same moment, Cloots was elected president of the Jacobins: thus, through an infallible consequence, the foreign party dominates amidst the Jacobins. Yes, the foreign powers have, amidst us, their spies, their ministers, treasurers and a police. But we, we have the people, which wants to be free and will be... The bankers conspire with impunity. They let our assignats au pair rise only in order to hoard our money; when they want crowds at the doors of bakers, they are besieged. They decide on the peace in this city; and the intrepid patriots, the friends of the Republic, are exposed to a thousand dangers... Paris is filled with intriguers, Englishmen and Austrians. They sit among us with the agents of Frederick... Cloots is a Prussian... I have traced the history of his political life for you... Decide.
Source: OMR, t. 10, p. 247 et seq.
#French Revolution#frev#robespierre#cloots#anacharsis cloots#year ii#translation#jacobins#jacobin club
38 notes
·
View notes
Note
@ Cloots anon, I’m glad you’re talking about him cause he was fucking weird
So this Cloots guy was a Prussian nobleman during the French Revolution. His full name (copied from Google) was Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, baron de Cloots
He was in favor of a “world state” (think the United Nations) and declared himself “a personal enemy of Jesus Christ”. He was labeled a “personal enemy of God” and was very in favor of overthrowing the government of France. He was basically an anarchist before anarchy became a thing in the mid 1800s. He was executed via guillotine, as most weirdos were at the time, but he was pretty chill with it all things considered.
I don’t know where the Anacharsis came from, but I’m assuming it came from some old word for ‘anarchist’. It does sound a lot like a Quackity name, though, and I do think Quackity would play a character that got guillotined just so he could make a “dude are you asking me to give you head?” joke before dying. (A.D.)
none of these words are in the bible
2 notes
·
View notes
Text

GIVE IT UP FOR ANACHARSIS CLOOTS EVERYONE. ANACHARSIS CLOOTS, “PERSONAL ENEMY OF GOD”
2 notes
·
View notes
Text
Cet article sur l'universalisme paru sur AOC est passionant, notamment pour penser le contexte actuel et les revendications anti-racistes.
______
Minuit à l’heure de l’universalisme
Par Thomas Branthôme | HISTORIEN DU DROIT ET DES IDÉES POLITIQUES
Les récentes manifestations antiracistes ne scandent pas « à bas l’universalisme », mais demandent un traitement égalitaire et une citoyenneté qui ne soit pas « à deux vitesses ». Mais cela peut-il encore se faire au nom d’un universalisme dont le terme est aujourd’hui pleinement contesté après avoir été trop dévoyé ? Pour s’atteler à cette question, il faut revenir sur l’histoire longue du nouage révolution-république-universalisme, sa contestation, et observer que la revendication d’un universalisme concret, qui ne se contente pas de déclarations de principe, a toujours existé. En d’autres termes, il est temps de revenir au minuit de l’idée d’universalisme pour enfin s’accorder sur les aiguilles.
Dans Les choses, publié en 1965, Georges Perec méditant sur la bascule qui faisait chavirer son époque écrivait : « La vie moderne excitait [le] malheur […] La tension était trop forte en ce monde qui promettait tant, qui ne donnait rien ». Perec parlait alors des « Trente glorieuses », de la société de consommation naissante et de ses chimères mais il aurait tout aussi pu parler de la modernité au sens historico-philosophique et d’un de ses corollaires majeurs : l’universalisme. Lui aussi promettait tant. Tant qu’il a déçu. Après avoir été une des valeurs « locomotive » de l’histoire occidentale pendant plusieurs siècles, l’universalisme est à présent en crise. Depuis une trentaine d’année, il appartient même à la catégorie des sujets les plus âprement débattus, traçant une ligne de fracture saillante entre les pro et les anti jusqu’à devenir un totem pour certains et la figure typique du mot repoussoir pour d’autres. Derrière cette opposition, on trouve deux traditions politiques. Pour la première, héritière d’une philosophie de l’Histoire qui s’étend de la Révolution française au marxisme, l’universalisme constitue un élément non-négociable de la théorie politique car il est inscrit dans « l’eschatologie » révolutionnaire visant à l’avènement d’un monde commun peuplé d’égaux et de semblables.
Pour la seconde, lassée des promesses non-tenues de l’universalisme, ce dernier est perçu comme un bandeau recouvrant les yeux de toute la tradition philosophique occidentale. Sous prétexte d’une affirmation d’indifférence à la couleur (color blind), il rendrait en vérité aveugle aux réalités des discriminations actuelles : néo-impérialisme, continuum colonial, domination par l’occident des « pays du sud », invisibilisation des femmes, marginalisation des « minorités », « gestion » répressive des quartiers populaires… Accessoire d’un gigantesque « déni » permettant de ne pas regarder « les problèmes en face », l’universalisme n’aurait par ailleurs guère de valeur historique, les grands hérauts de l’universel (l’Europe, les États-Unis) présentant un passé grevé de contradictions entre les déclarations et les faits (guerres, colonisation, impérialisme).
Mais ce n’est pas tout. Dans sa prétention même à nier le particulier au nom du grand tout, l’universalisme serait également un danger pour l’« Autre », pour le « différent » ; un moule unique et uniformisant taillé par et pour l’Occident. La France est particulièrement visée par cet examen critique car son modèle républicain s’est construit consubstantiellement avec l’idée d’universalisme. Comme le note en effet Jeremy Jenning dans le Dictionnaire critique de la République : « L’un des aspects les plus frappants de la Révolution de 1789 est que, dès le début, ses participants croyaient que leurs actions avaient une signification mondiale, et que l’enjeu renfermait des valeurs universelles ».
Au premier abord, ces deux positions semblent inconciliables. C’est en effet le cas si l’on se contente de rechercher une simple synthèse. Mais il peut en être autrement si l’on utilise plutôt la méthode dialectique. Dans notre cas d’espèce, cela signifie penser un universalisme à la lumière de sa critique. Essayons à cette fin de confronter les deux théories. Après tout, James Baldwin nous a appris que « rien ne peut changer tant qu’on ne l’affronte pas ».
Aux origines de l’universalisme
Pour saisir pleinement les enjeux de ce conflit intellectuel majeur, il convient d’abord de revenir aux origines de l’universalisme. Car l’universalisme est vieux de plus de vingt siècles. Du latin « unus » et « versus » (littéralement « tourné en un »), il désigne durant l’Antiquité sous le nom d’universalis la notion de totalité, d’entièreté et d’unité. L’universalis recouvre donc à la fois l’univers (universus), le général, ce qui s’étend à tous, à tout et partout. Dans les faits, il apparaît pour la première fois avec le christianisme « paulinien » et la phrase célèbre de Saint-Paul expliquant ce qu’être chrétien signifie : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme : vous êtes tous un en Jésus Christ » (Lettre aux Galates, 3. 28).
Cette affirmation est alors une rupture majeure avec la conception anthropologique dominante, puisque pour la pensée antique il n’existe que des hommes libres ou esclaves désignés comme tels par la Cité ou l’Empire auxquels ils sont rattachés. Mais cet universalis existe-t-il réellement ? N’est-il pas une simple perception de l’esprit ? Entre le XIIe et le XIVe siècle, les savants médiévistes s’affrontent sur le bienfondé de ce concept.
Puis, avec la modernité, l’universalisme passe des choses aux hommes. Les grandes découvertes du XVe et XVIe siècle qui entraînent la rencontre avec de nouvelles civilisations plongent l’Europe dans un tourbillon métaphysique dont la plus célèbre bourrasque est la « Controverse de Valladolid » (1550-1551). L’humanité des « Indiens » est débattue. Sont-ils des hommes ? Ont-ils une âme ? Peuvent-ils se prévaloir d’un droit et si oui, lequel ? On le sait, au cours de ce débat fondamental, Las Casas l’emporte sur Sepúlveda en s’appuyant notamment sur les principes du théologien Francesco de Vitoria.
L’École du droit naturel peut alors prendre son essor. Des grands juristes comme Grotius, Althusius, Pufendorf défendent l’idée d’un droit commun (jus commune) à tous les hommes. Locke, Rousseau et les Lumières s’en font les héritiers. La conception ancienne du droit rattaché à une cité ou à un empire est pourfendue. Il existe des droits de l’Homme, affirment les Lumières. Des révolutions éclatent pour les faire reconnaître : en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, en France.
Universalisme et droits de l’homme s’épousent. Dans l’hexagone, on l’a dit en introduction, la République pousse sur ces deux rameaux. Elle les exalte, elle en tire le sens profond de son projet révolutionnaire : une émancipation pour toutes et tous. Là où sur terre règnent la tyrannie, l’esclavage et l’arbitraire, il y a un combat à mener. Robespierre déclare à ce titre : « Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves […] devienne le modèle des nations, l’effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l’ornement de l’Univers, et qu’en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l’aurore de la félicité universelle ».
Le socialisme naissant du XIXe siècle lui emboîte le pas. Il parle d’internationalisme, il évoque la « République universelle » reprenant l’expression du révolutionnaire Anacharsis Cloots. Parce qu’il n’existe pas de races, dit le socialisme républicain, parce qu’il n’y a qu’un « genre humain ». Le marxisme se fait le légataire de cette vocation universelle de l’émancipation révolutionnaire. C’est aux prolétaires de tous les pays qu’il lance son appel au soulèvement général.
Le mot sera entendu par les combattants marxistes, socialistes, ouvriéristes mais aussi par les anticolonialistes qui se libéreront du joug colonial au nom du désir d’autonomie, d’émancipation et d’égalité portés par l’universalisme. Au XXe siècle, Léopold Sédar Senghor, passeur de témoin et premier président de la République du Sénégal (1960-1980) après avoir été ministre en France, défendra dans son œuvre littéraire et politique une « civilisation de l’universel ». Et Hô Chi Minh, Che Guevara, Thomas Sankara, Nelson Mandela conjugueront la langue de leurs combats à l’impératif universaliste.
L’universalisme en accusation
Mais, nous l’avons dit en introduction, le nouage révolution-république-universalisme, parce qu’il est un produit d’une certaine philosophie de l’Histoire, ne fonctionne que s’il peut s’appuyer sur l’idée de « progrès » ; en d’autres termes, que s’il peut garantir que demain sera mieux qu’hier. Et cela, désormais, l’universalisme le peut de plus en plus difficilement. Car le train de l’Histoire occidentale a déraillé. Au XIXe siècle, la justification du colonialisme de la IIIe République au nom d’une mission dite « civilisatrice » a souillé du sang des colonisés le corpus du républicanisme. Puis les catastrophes du XXe siècle ont plongé le monde occidental dans une crise de conscience sans précédent en questionnant la teneur même de son mouvement historique.
Entre le XVIIe et le XXe siècle, à la suite des écrits de Fontenelle, des Lumières ou de Condorcet, l’Occident s’enorgueillissait d’avancer en suivant la « boussole du progrès ». Mais peut-on toujours dire après « 14-18 » que les armes chimiques sont un progrès, après 1944 que la bombe nucléaire est un progrès ? Peut-on même continuer à se prévaloir de cette idée de progrès quand on sait le rôle joué par la « rationalisation », le machinisme et la science dans la colonisation et la Shoah ? Au cours des dernières décennies, le surgissement de la « question écologique » (réchauffement climatique, destruction de l’écosystème planétaire) a achevé de discréditer cette « foi », fragilisant un peu plus encore le nœud universalisme-progrès. Depuis, un grand voile de discrédit s’abat sur l’Occident entraînant la remise en cause de sa science et de sa méthodologie sur lesquelles reposait tout en partie le prestige de l’universalisme.
Fort de ce coup d’arrêt, de nouvelles disciplines ont émergé tout au long du XXe siècle appelant à un regard « décentré ». Souleymane Bachir Diagne et Jean-Loup Amselle dans une discussion croisée ont tracé la généalogie de ce nouveau regard : il y eut au commencement les « non alignés » de la conférence de Bandung (1955), puis le mouvement de la « négritude » (1956), l’«orientalisme » (1978) d’Edward Saïd, la « bibliothèque coloniale » mise à l’index par Valentin Mudimbe (1988). Tous ont appelé à une résistance contre ce qu’ils considéraient comme une forma mentis unique et unidimensionnelle de l’Occident.
Cette contestation s’est poursuivie en empruntant les chemins de la philosophie déconstructiviste et a gagné en virulence à partir des années 1980 du fait de l’émergence des Subaltern studies (du nom d’une revue indienne), des Post-colonial studies et des études décoloniales[1]. Une offensive théorique de grande ampleur a alors vu le jour, venant d’Asie mais aussi d’Amérique latine (avec le philosophe Enrique Dussel, l’anthropologue Arturo Escobar, les sociologues Ramón Grosfoguel et Anibal Quijano ou le sémiologue Walter Mignolo), avant d’être relayée dans les universités américaines puis européennes[2].
Trois critiques principales ressortent de ces différents champs d’étude :
1- L’universalisme ne serait que le faux nez d’un eurocentrisme impérialiste. Né en Europe, il constituerait un concept pour l’Europe, une sorte de cheval de Troie servant à répandre ses valeurs et de sa vision du monde. Un universalisme hypocrite en somme.
2- Cet universalisme serait d’autant plus difficile à remettre en cause qu’il aurait construit un « récit autoréférentiel de la modernité », « eurocentrique » et l’aurait injecté de façon hégémonique dans l’ensemble des savoirs.
3- Cet universalisme serait uniformisant et donc dangereux pour l’ensemble des cultures non-occidentales qu’il asphyxierait et empêcherait de croître. Fort de cette dimension dite « totalisante » (Gayatri C. Spivak), l’universalisme occidental créerait ainsi une géopolitique mondiale déséquilibrée au sein de laquelle il placerait l’Occident au centre et le reste à la marge, relégué au rang de subalternes. Figure de proue de ce courant critique, Dipesh Chakrabarty instruit depuis quelque temps pareil procès au marxisme accusé par son « analyse globalisante » d’étouffer les « hétérogénéités et incommensurabilités » du local.
La continuelle querelle des universaux
En réalité, la négation de l’universalisme est aussi ancienne que le concept même. Dès le Moyen-Âge, l’opposition médiévale entre nominalistes et réalistes entraîne une disputatio qu’on nommera « la querelle des universaux »[3]. Mais ce débat relève surtout du questionnement philosophique et théologique. C’est à la Révolution française qu’éclate la grande polémique moderne sur l’universalisme. D’une part, jaillissent les premières critiques sur l’inefficience de cet universalisme révolutionnaire que traversent de trop nombreux manques (au sujet des femmes, des esclaves, des pauvres).
D’autre part, dans le sillage de ce qu’on nommera la « contre-révolution » (Burke, de Maistre et Bonald), survient une contestation radicale de l’existence même l’universalisme. Une citation célèbre de Joseph de Maistre résume alors l’opposition de vue : « J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu’on peut être Persan, mais quant à l’homme je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie »[4]. La contre-révolution refuse l’idée qu’il existe « l’Homme » en tant que catégorie abstraite. La justification est d’ordre religieuse et conservatrice. Penser l’Homme et ses droits en soi comme émanation de sa nature, c’est d’une part rompre avec l’idée des hommes conçus comme créatures divines et soumis aux lois de Dieu. D’autre part, envisager cet Homme in abstracto, détaché des lieux et du temps, c’est l’affranchir du continuum temporel qui divise depuis les siècles les hommes et les femmes en catégories bien étanches (ethnies, civilisations, ordres). C’est mettre tout l’ordre social de l’Ancien Régime sens dessus-dessous.
Cette peur de l’universalisme comme souffle révolutionnaire remettant en cause la tradition se retrouve chez certains adversaires actuels de l’universalisme[5]. Comme chez De Maistre ou plus tard chez Barrès (« la terre et les morts »), l’universalité est en effet contestée au nom d’un « désir d’appartenance » régional, tribal ou génétique, désir que l’universalité dans sa généralité abstraite ne peut combler. Ce n’est ainsi pas un hasard de voir que la poursuite de l’opposition contre-révolutionnaire à l’universalisme va s’approfondir en Allemagne, après la Révolution, entre les écrits de Fichte et ceux de Gentz, puis plus tard, de Carl Schmitt. Désignée par Blandine Kriegel[6] comme une « révolution conservatrice », cette ligne d’opposition allemande se voudra en effet aussi révolutionnaire et volontariste que le rousseauisme ou le jacobinisme mais elle considèrera que cette révolution ne peut s’inscrire dans un autre cadre que celui d’une nation fermée et par un autre acteur qu’un peuple bien défini.
On constate ainsi que les critiques actuels de l’universalisme sont déjà toute en partie en place dès la fin du XIXe siècle : sous la forme d’abord de la dénonciation d’un universalisme sécularisé susceptible de blesser l’universalisme catholique (l’adjectif « catholique » vient du grec καθολικός (katholikos) qui signifie « universel »)[7]. Par le refus, ensuite, de penser l’individu sous une forme philosophique et hors de ses racines géographiques et/ou ethniques. Le 3e point – le reproche de l’hypocrisie – est également déjà formulé, mais il émane d’une culture politique rivale : le marxisme. S’appuyant sur la conception dialectique et matérielle de l’histoire, le marxisme questionne les origines et les effets de l’universalisme à travers un examen serré des droits de l’Homme. Ces derniers ne sont-ils pas les expressions iconiques d’un moment historique « bourgeois » et donc particulier ? L’énonciation de libertés formelles et non réelles ?
Au XXe siècle, cette prétention « universelle » des Droits de l’Homme issue du bloc libéral, notamment dans la Déclaration de 1948, sera de ce fait contesté par le bloc soviétique, et spécifiquement en ce qui concerne « le droit naturel de propriété ». Mais le marxisme ne nie pas l’idée d’universalisme, il fustige son utilisation trompeuse par ceux qu’il considère comme de faux universalistes mus par des intérêts de classe. La critique marxiste offre une piste de réflexion d’autant plus intéressante que les études sociologiques de terrain donnent à entendre un sentiment similaire du côté des concernés[8] : les valeurs du triptyque républicain ou l’universalisme ne sont que très rarement rejetées. Ce qui anime le ressentiment contre elles – à raison –, c’est l’inapplication de ces principes et de ces valeurs au quotidien[9].
Les grandes manifestations antiracistes récentes ne scandent pas « à bas l’universalisme », ils demandent un universalisme concret à travers un traitement égalitaire et une citoyenneté qui ne soit pas « à deux vitesses », ils demandent l’expression la plus emblématique de l’idéal universel comme l’illustre le mode d’ordre du collectif « La vérité pour Adama » : la justice.
Combattre à l’intérieur de l’universalisme
Au fond, au lieu de poursuivre cette opposition qui par ailleurs, comme l’a bien indiqué le sociologue américain Vivek Chibber, affaiblit la lutte contre le capitalisme en désarmant l’appareil critique républicano-marxiste, il est peut-être temps de revenir au minuit de l’idée d’universalisme. Car c’est à cette heure que l’on peut s’accorder sur les aiguilles. Dénonçons avec les Subaltern studies et les Post-colonial studies cet universalisme d’apparat qui s’est servi du masque de la philanthropie pour mener à bien ses projets impérialistes et coloniaux au XIXe siècle et poursuivons-le encore et toujours lorsqu’il sert à justifier les ingérences des dits-civilisés dans les zones des « non-civilisés » pour raisons économiques (I. Wallerstein)[10].
Étudions la confusion possible et critiquable ayant eu lieu entre « l’universalisme abstrait et la mondialité concrète résultant de l’hégémonie de l’Europe comme centre » (Enrique Dussel[11]). Reconnaissons également avec ces études les « angles morts » (Norman Ajari) de l’universalisme historique et ses manquements aussi bien passés (le suffrage dit universel en 1848 alors qu’il excluait les femmes ; la mission dite « civilisatrice » de la colonisation, le code de l’indigénat de 1881 appliqué aux « départements » algériens ; les banlieues et les quartiers populaires laissés à l’abandon) que présent (les statistiques relatives à l’embauche, à l’accès au logement, aux contrôles policiers témoignent de discriminations lourdes).
Mais sachons dire dans le même temps que la dénonciation de cet « universalisme dévoyé » (Alain Policar) ne doit en aucun cas mener à l’ethno-différencialisme qui, comme l’a montré Nedjib Sidi Moussa est parjure au projet révolutionnaire. Sachons dire aussi qu’une racialisation et une ethnicisation à outrance des débats ne peut que renforcer la « fièvre identitaire » qui anime les xénophobes d’extrême-droite. Sachons dire enfin qu’il est temps de mettre fin au processus de décomposition de l’idée d’égalité qui frappe nos sociétés depuis trop longtemps et que l’universalisme peut-être une « arme pour la gauche » (Vivek Chibber) dans cette bataille.
L’exemple oublié de la lutte du républicanisme révolutionnaire contre le républicanisme conservateur
Pour ce faire, il faut d’abord se départir d’une conception unidimensionnelle et monolithique de l’universalisme et de son support, la République. L’avènement de la République en France n’a rien d’irénique, d’apaisé et de linéaire. Elle est le fruit d’une lutte interne au sein de ce qu’on appelait au XIXe siècle « le Parti républicain »[12], le résultat d’un conflit mettant en tension différentes sensibilités (libérale, conservatrice, jacobine, plébéienne) en prise pour le contrôle et l’orientation de l’idée républicaine, ainsi que nous l’avons montré dans nos travaux avec Jacques de Saint-Victor.
La question sociale, celle de la souveraineté, celle de la violence et de l’insurrection, celle de l’égalité, du rapport à la propriété, aux institutions : tout a été le fruit d’âpres débats. Et il en fut de même concernant l’universalisme. Il n’y a rien de plus faux que de croire que l’idée d’universel fut dans la praxis républicaine une facilité oratoire ou un propos de salon. Son énonciation et l’extension de son domaine se sont payées au prix du sang. Le républicanisme révolutionnaire s’est en effet battu constamment pour aiguiller le sens de l’universalisme vers un « universalisme intensif », pour reprendre la distinction d’Étienne Balibar, c’est-à-dire un universalisme de libération et d’émancipation, contre l’ « universalisme extensif » (i.e. l’universalisme d’expansion et de colonisation).
À ce titre, entre le XVIIIe et le XXe siècle, des républicains révolutionnaires, puis des socialistes ou des marxistes, se sont opposés à d’autres républicains, conservateurs pour dénoncer les entorses faites à la promesse révolutionnaire de l’universel. Dès le commencement de la Révolution, Condorcet et Olympe de Gouge plaident pour le droit de vote des femmes, injustement écartées de la citoyenneté. Au même moment, Robespierre fustige tout ce qui blesse le droit naturel. Il se prononce contre la loi martiale, contre la peine de mort, contre la distinction citoyen passif/citoyen actif. La représentation nationale s’honore à donner la citoyenneté aux comédiens, aux protestants, aux juifs, aux « hommes libres de couleur » mais rechigne à abolir l’esclavage du fait de la richesse que rapportent les colonies à certains Constituants. Robespierre s’en fait le pourfendeur et déclare « périssent nos colonies plutôt que nos principes »[13].
La République advenue, ces combats de Robespierre, de l’Abbé Grégoire et de la « Société des amis des noirs » associés aux luttes des esclaves dans les colonies, l’esclavage peut alors être aboli (4 février 1794). Et il en sera de même de chacune des promesses de l’universalisme. Bon nombre de ces promesses seront en effet trahies. Mais aucune de ces trahisons ne manquera d’être dénoncée par le camp républicain révolutionnaire. Les néojacobins combattront Napoléon pour avoir jugulé la démocratie ; les résistants de la « République souterraine » seront exécutés sous la Restauration (Les 4 sergents de la Rochelle), jetés en prison ou mourront lors des insurrections réprimées sous la Monarchie de Juillet pour avoir rappelé à Louis-Philippe et à l’extrême-centre leur « mensonge tricolore » ; les républicains « rouges » périront sous la mitraille de Cavaignac en juin 1848 et sous les décrets d’exil de Napoléon III après le 2 décembre 1851 ; tout comme les Communards en 1871 tombés pour « la république de la justice et du travail » (Jean-Baptiste Clément).
Et ils seront secondés par Marx puis Lénine qui flétriront les républiques toutes les fois où elles seront bourgeoises et non « démocratiques et sociales ». Lorsque la République, aux mains des conservateurs, prendra un tournant racial et colonisateur sous la IIIe, des voix comme celle du grand sociologue Marcel Mauss dénonceront l’erreur et l’horreur d’une telle bascule. Et le « premier » Clemenceau s’opposera farouchement à Jules Ferry pour contester son discours sur les « races inférieures ». Dans le même temps, sous l’égide de Jaurès, le républicanisme se fera tout aussi accusateur contre ses usurpateurs affairistes et tous ceux l’empêchant de parvenir à son terme. Et Jaurès dira que ce terme, c’est le socialisme. Jeanne Deroin, Louise Michel, les suffragettes et Rosa Luxembourg vitupéreront le virilisme, le préjugé masculiniste et l’égalité bafouée. De Marat à Aimé Césaire, on anathémisera les « chaînes de l’esclavage ». Et beaucoup de neg marrons entre 1794 et 1848 s’insurgeront, comme l’a relevé Silyane Larcher, en criant « Vive la liberté ! Vive la République ».
Est-ce à dire pour autant que la République est pure et immaculée ? Une telle essentialisation positive serait aussi inepte qu’une essentialisation totalement négative. Peut-on considérer que la République est immunisée contre toute tentation impérialiste et oppressive ? Aucunement, mais son idéal offre les armes pour combattre contre sa propre corruption.
Pour un universalisme latéral
Dans Histoire et conscience de classe (1923), Georg Lukacs affirme qu’en tout état de cause ce que la théorie critique devra toujours garder du marxisme, c’est sa méthode dialectique. Cette dernière s’oppose à la méthode traditionnelle « thèse/antithèse/synthèse ». Dans le cas de la dialectique, le mouvement est thèse/critique de cette thèse/dépassement (aufhebung) de la première thèse grâce à sa critique. Voilà ce que signifie penser un universalisme à la lumière de sa critique. Est-ce possible ou le mot est-il définitivement perdu à force de dévoiement ?
On peut le croire en s’appuyant, comme l’invite Souleymane Bachir Diagne, sur les travaux de Maurice Merleau-Ponty[14]. Il existe, écrit Merleau-Ponty, un universalisme qu’il faut combattre, c’est « l’universalisme de surplomb », c’est celui de la colonisation et de l’impérialisme. Puis il en est un autre, non-hiérarchisé, qui appelle à lui l’ensemble des hommes dans leurs origines diverses pour tisser un universalisme de rencontre provocant ainsi une « incessante mise à l’épreuve de soi par l’autre et de l’autre par soi » : c’est « l’universalisme latéral ». C’est celui qu’il convient de construire[15]. Car comme l’écrivait Henri Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion (1932), l’universel n’est jamais donné. Et, c’est ce sur quoi il faut conclure.
L’universalisme, pas plus que la République, le socialisme ou le marxisme, n’est une notion performative qui saurait se suffire à elle-même du simple fait de son énoncé. Sans les hommes et les femmes – de Spinoza à Edouard Glissant en passant par Robespierre, Clara Zetkin, Gisèle Halimi et mille autres – qui veulent en porter l’étendard, il est une voile de navire sans attache. Mais il est justement dans le pouvoir – et le devoir – des hommes et des femmes de lui donner son effectivité, de lutter pour accroitre son périmètre, de mettre en demeure en son nom tous ceux qui s’en réclament mais le trahisse constamment, d’intégrer le particulier dans l’universel avec ce que cela implique de « conflits »[16] ; de combattre pour que le calque de l’idée épouse enfin les faits.
La misère, les exclusions et les discriminations qui perdurent ne sont pas les accusateurs de l’universalisme, ils sont la mauvaise conscience des universalistes. Ce qui compte comme disait Karl Korsch au sujet du rapport du marxisme à la philosophie[17], ce n’est pas de dépasser l’universalisme, c’est de le réaliser.
[1] Notons qu’il existe des nuances importantes entre ces trois courants qu’il est hélas impossible de détailler faute de place. On pourra se reporter, pour avoir un premier panorama, à l’article de Roland Pfefferkorn, Abdelhafid Hammouche et Gilbert Meynier, « Colonial, post-colonial, décolonial : introduction », in la revue Raison présente, 2016/3, n°199, p. 3-8.
[2] Voir sur la question de l’arrivée tardive de ces études dans le champ académique français Didier Fassin et Éric Fassin, De la question sociale à la question raciale, Paris, La Découverte, 2009. Sur le débat présent, Capucine Boidin, « Études décoloniales et postcoloniales dans les débats français », in Cahiers des Amériques latines, 2009, 62, p. 129-140.
[3] Sur cette question, voir Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2003, p. 223-229.
[4] Joseph De Maistre, Considérations sur la France (1796), Londres, 1797, seconde édition, p. 102.
[5] Voir par exemple Houria Bouteldja qui écrit dans un de ses ouvrages : « J’appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l’Algérie, à l’islam » in Houria Bouteldja, Les Blancs, les Juifs et nous, Paris, La Fabrique, 2016, p. 72.
[6] Blandine Kriegel, Philosophie de la République, Paris, Plon, 1998, introduction, p. 19, et p. 157-165.
[7] Ce phénomène est également transposable à la religion musulmane, ce que Bernard Lewis souligne dans ses analyses sur l’Islam et l’Occident lorsqu’il évoque la rencontre de « deux universalismes », v. Bernard Lewis, « L’Europe et l’Islam » in Le Débat, 2008/3, n°150, p. 16-29.
[8] Voir par exemple les œuvres de Salika Amara et de sa compagnie « Filles et fils de la République », que ce soit dans le recueil Un pays, ça veut dire, Paris, F.F.R, 2010, qui regroupe deux cents petits textes écrits à partir de la formule « un pays, ça veut dire » ; ou de sa pièce de théâtre, « La République c’est nous… aussi », 2020.
[9] En ce sens Sophie Béroud, Paul Bouffartigue, Henri Eckert et Denis Merklen écrivent « les formes de la mobilisation collective au sein des quartiers se font entièrement à l’intérieur des frontières de la citoyenneté », ces classes populaires revendiquent l’application de leurs droits, et pour se faire « se mobilisent et s’organisent autour des demandes de rénovation urbaine, de désenclavement, d’amélioration du cadre de vie, de réparation des ascenseurs, de transports rendant meilleure la communication avec la ville, mais aussi de plus d’équipements collectives, sportifs, culturels, sociaux ou éducatifs, etc », in Sophie Béroud, Paul Bouffartigue, Henri Eckert, Denis Merklen, En quête des classes populaires Un essai politique, Paris, La Dispute, 2016, notamment le chapitre VIII « Les banlieues : territorialisation et localisation », p. 155-181. Voir également dans le même ordre d’idée
Loic Wacquant, « Pour en finir avec le mythe des “cités-ghettos” », Les Annales de la recherche urbaine, 1992, 54 : 21-30 ; ou le concept de « citoyenneté urbaine » chez Jacques Donzelot, in Jacques Donzelot, « Le temps de la citoyenneté urbaine », in Tous urbains, 2017, vol. 17, no. 1, p. 4-5.
[10] Voir en ce sens Immanuel Wallerstein qui dénonce les faux universalismes (notamment celui de la théorie huntingtonienne) pour en promouvoir un authentique, in Immanuel Wallerstein, L’universalisme européen. De la colonisation au droit d’ingérence, New-York, Demopolis, 2006.
[11] Enrique Dussel, « Europa, modernidad y eurocentrismo », in Edgardo Lander (ed.), La colonialidad del saber : eurocentrisme y ciencias sociales, Perpectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000, p. 48.
[12] G. Weill, Histoire du Parti républicain en France de 1814 à 1870, Paris, Félix Alcan, 1900.
[13] Du moins, c’est ce que la tradition a retenu car sa phrase exacte est : « Périssent nos colonies ! Car je ne serais pas sans crainte qu’avec elles, ne périssent nos richesses & les forces nécessaires pour maintenir notre liberté », in F. Gauthier (dir.), Périssent les colonies plutôt qu’un principe. Contributions à l’histoire de l’abolition de l’esclavage. 1789-1804, Paris, Société des études robespierristes, 2002.
[14] Maurice Merleau-Ponty, « Rapport de Maurice Merleau-Ponty pour la création d’une chaire d’Anthropologie sociale », in La Lettre du Collège de France, 2008, Hors-Série, 2 : 49-53 et dans Maurice Merleau-Ponty, « De Mauss à Claude Lévi-Strauss », in Œuvres, Paris, Gallimard, 2010, p. 1409-1421.
[15] Merleau-Ponty ajoute : « Il s’agit de construire un système de référence général où puisse trouver place le point de vue de l’indigène, le point de vue du civilisé, et les erreurs de l’un sur l’autre, de constituer une expérience élargie qui devienne en principe accessible à des hommes d’un autre pays et d’un autre temps. », Ibid.
[16] Étienne Balibar, Des universels. Essais et conférences, Paris, Galilée, 2016. Pour un commentaire de ce livre et de sa confrontation avec d’autres pensées de l’universel, Patrice Maniglier, « L’universel contrarié », in Critique, 2016/10, n°833, p. 772-788.
[17] K. Korsch, Marxisme et philosophie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1964.
6 notes
·
View notes
Photo

24 August 1792. Two weeks earlier the monarchy had been overthrown. Within the last week, General Lafayette had defected, the Prussians had invaded, and the fortress town of Longwy had just fallen, though Paris did not yet know. In the midst of this ferment, the playwright Marie-Joseph Chénier led a delegation of Parisian citizens to the bar of the Assembly, petition in hand. He urged the deputies to offer full French citizenship to a list of “courageous philosophers who have sapped the foundations of tyranny.” The Legislative Assembly [...] took time for a hot debate of Chénier’s proposal. Two days later, eighteen foreigners – ranging from British abolitionist Thomas Clarkson to writer of the United States Constitution James Madison – were pronounced French citizens, with full political rights.
Certainly, this act was meant to play on the cosmopolitan stage of the Enlightened public sphere of Europe. But this granting of citizenship was not purely performative of honorary. Three of the adopted citizens – Tom Paine, the Prussian Anacharsis Cloots, and the Englishman Joseph Priestley – were soon elected as deputies to the new Convention, though only the first two would serve. The decree’s supporters made the politics clear: if the republic was to be universal, it must be a global creation from the outset; the National Convention would be, in Chénier’s words, “a congress of the whole world.” This idea immediately provoked the resistance and anxiety of some deputies. “You are delivering the Convention to foreigners!” exclaimed the deputy Claude Basire at one point mid-debate. And invasion by outsiders was not the only threat. Lasource warned that the Assembly should not give away this glorious title of French citizenship so lightly. To build a republic was a fragile and controversial act. “If you set about giving this tile to those who have not asked for it, wouldn’t you risk suffering the humiliation of refusal?” [...]
On one level, the events of 24-26 August 1792 – tied to a particular political moment – show how issues of foreigners and foreign policy became entangled with domestic policy [...]. One another, broader level, this event performs crucial ideological work for the new republic. [...] Historians have largely situated the origins of republican universalism in the Enlightenment discourse of natural rights. For the French revolutionaries, “universalism” meant that the legitimacy of the nation – the very sovereignty of the nation itself – rested on the defense of universal human rights and on guaranteeing equality before the law. While some scholars have stressed the exclusionary contradictions of this ideology, others have emphasized that it also enabled various groups of people to demand rights. Republican universalism had both exclusionary and liberationist potential, and the issue of inclusion/exclusion is clearly pivotal.
Foreigners, Cosmopolitanism, and French Revolutionary Universalism (S. Desan), in: The French Revolution in Global Perspective (edited by S. Desan, L. Hunt, W. M. Nelson).
51 notes
·
View notes
Link
Boy, a high quality AO3 update brought to you by 1am, @sathinfection back in 2014 and @thiswaitingheart posting about Cloots.
5 notes
·
View notes
Photo

Lorsque l’on se penche sérieusement sur la Révolution de 1789 et que l’on s’aventure dans les zones obscures de son histoire, l’on découvre la marque discrète du judaïsme, une marque qui a échappé à l’attention de l’écrasante majorité des historiens — Bahlouli Hadj Lakhdar A LA RÉPUBLIQUE ET LA KABBALE, UNE HISTOIRE OCCULTÉE Lorsque l’on se penche sérieusement sur la Révolution de 1789 et que l’on s’aventure dans les zones obscures de son histoire, l’on découvre la marque discrète du judaïsme, une marque qui a échappé à l’attention de l’écrasante majorité des historiensLe penseur et révolutionnaire Anacharsis Cloots (1755-1794), […]
0 notes
Photo

“Nothing is antiphysical in the physical world.”
Anacharsis Cloots (1755-1794), arguing that same-sex sexuality isn’t unnatural by utilizing Diderot’s materialistic argument that all that exists cannot be outside of or against nature. Those who denounced same-sex passions often used the argument that it was an unnatural practice. Even the word ‘antiphysique’ was used to refer to unnatural passions/acts/attractions, including same-sex attractions. Here, Cloots turns that argument against them.
52 notes
·
View notes
Quote
J'aimerois mieux lui laisser le sobriquet de /dauphin/, d'autant plus que le vulgaire ne voit là-dedans qu'un poisson monstrueux, dévorant, ingrat, qui rend de l'eau claire par les narines.
Anacharsis Cloots sur la proposition du comité de révision de donner à l'héritier du trône le titre de "prince royal" dans la constitution de 1791, cité dans le PF, n° 738, du 17 août 1791.
Euh, Cloots, les dauphins =/= des poissons.
9 notes
·
View notes
Note
Unrelated to anything but I’m reading a book and there’s a guy names Anacharsis Cloots in it and that gives me major ‘weird homoerotic Tales from the SMP character’ vibes
CLOOTS?
1 note
·
View note
Quote
People speak often about nature without knowing her, they fix her limits arbitrarily; they do not know or pretend not to know that is impossible to act contrary to it.
Anacharsis Cloots, The Spokesman for the Human Race (L'Orateur du genre humain), 1791
1 note
·
View note