#l’hôtel des roches noires
Text
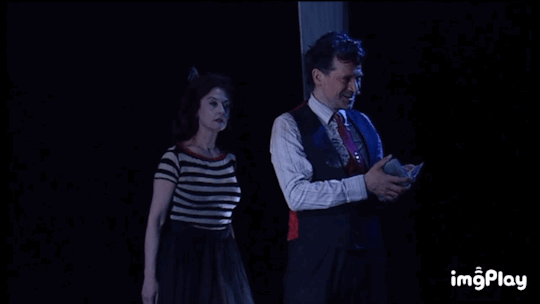
Olivier Breitman as Jules in L’Hôtel des Roches Noires
2012
[source video recording of the play]
1 note
·
View note
Photo

VIVEZ AU SOLEIL, AU BORD D'UN GOLF & LAGON SUN, GOLF & LAGOON LIFESTYLE ROCHES NOIRES (ILE MAURICE - MAURITIUS) Accessible aux mauriciens & étrangers / Accessible to mauritians & foreigners Pour y vivre ou investir / For living or investment • Villas, appartements, penthouses & terrains / Villas, apartments, penthouses & lands • 2, 3, 4 & 5 chambres / 2, 3, 4 & 5 bedrooms • Terrains à vendre / Lands for sale 1 000 m² • SPA, Sauna, Hamma… • Restaurants • Accès direct plage / Direct beach access • Parking & gestion bateaux / Parking & boat management • Accès à l’hôtel Radisson Blu / Radisson Blu hotel access • Proche Golf Azuri / Close Azuri Golf • … A partir de / As from Rs 11 500 000 - € 255 000 - $ 258 000 Contactez-nous pour plus d’informations ou une visite Contact us for more details or a visit. www.dreamimmoproperties.com #dreamimmo #dreamimmoproperties #immobilier #insta #instagram #instahome #vuemer #foryou #picoftheday #post #refollow #Repost #post (à Île Maurice) https://www.instagram.com/p/CjGZVEvtviv/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#dreamimmo#dreamimmoproperties#immobilier#insta#instagram#instahome#vuemer#foryou#picoftheday#post#refollow#repost
1 note
·
View note
Photo

En 1963, Marguerite Duras acquiert l’appartement 105, au premier étage de l’hôtel des Roches noires où Proust a séjourné soixante-dix ans plus tôt, dans l’appartement 110.
1 note
·
View note
Photo










" Le penthouse vénitien de Rick Owens" via admagazine.fr, 2019, 1/11
Connu pour son approche transgressive de la mode et ses meubles massifs, comme venus de la préhistoire, le créateur Rick Owens s’est créé, face à la plage du Lido, un espace qui répond à son mode de vie. Minimal et radical.
« J'ai toujours adoré le Lido, son côté provincial, proche de Venise mais sans les inconvénients, raconte le créateur de mode. C’est aussi à deux heures de l’usine qui fabrique mes vêtements et j’ai pris l’habitude de venir travailler ici. J’y passe au moins une semaine par mois et, souvent, presque tout l’été. Pendant des années, j’ai habité à l’hôtel Excelsior, mais je n’en pouvais plus de vivre dans un décor qui n’était pas le mien. » C’est à quelques centaines de mètres de l’hôtel mythique qui accueillait les stars pendant la Mostra de Venise qu’il achète les deux derniers étages du condominium Miramar, un bâtiment des années 1950 avec vue sur la plage.
« Le décor était incroyablement kitsch, une débauche de couleurs ! Shabby, mais pas chic ! » ajoute-t-il en souriant. Avec l’aide de l’architecte Anna Tumaini qui réalise toutes ses boutiques, il imagine au dernier étage un lieu parfaitement conçu pour répondre à un mode de vie réglé comme du papier à musique : travail et lecture, plage, musculation et incontournable sieste l’après-midi. L’étage inférieur est transformé en studio de travail pour ses collaborateurs. « Mon modèle, c’était le cabanon de Le Corbusier, mais en version moderniste. Fonctionnel et efficace ! explique-t-il. Je voulais quelque chose d’austère, de presque froid, qui associe le raffinement de Jean-Michel Frank à la sévérité de l’architecture mussolinienne. »
Le plan de l’appartement a été repensé pour répondre à cette vision et se partage entre trois espaces : un salon-bureau, une chambre-salle de bains et une salle de musculation où le créateur s’exerce plus d’une heure par jour. Pas de cuisine à proprement parler, les repas sont pris à l’extérieur. C’est une cellule de vie en version minimale.
Un mobilier réduit à l’essentiel
Le choix d’un matériau unique, une pierre de Sardaigne blonde utilisée pour les sols à l’intérieur comme à l’extérieur, les garde-corps, les estrades et le piètement des assises, donne à l’ensemble une belle unité. Toutes les huisseries des portes ouvrant sur le balcon terrasse, qui prolonge l’appartement sur ses trois côtés, sont redessinées et réalisées en Inox pour donner un cadre lumineux à la vue sur la mer.
Le mobilier aussi est réduit à sa plus simple expression : des banquettes, une table en bois et quelques tabourets. « Avec l’âge, je ressens le besoin d’une plus grande simplicité, avoue le créateur. J’ai besoin d’éliminer le désordre, toutes les choses inutiles qui m’empêchent de me concentrer sur l’essentiel. L’espace autour de moi doit être comme un écran vierge sur lequel je peux projeter mes idées. Je ne suis que trop humain, pour pouvoir travailler, il me faut une discipline ! »
Seules exceptions à cette règle de dépouillement quasi monacal, quelques sièges d’Eliel Saarinen – son designer favori – appartenant à une rare série créée en 1907, des livres qui s’empilent sur le sol et les étagères de la bibliothèque, une collection de vases en bronze signés Hugo Elmquist et les sculptures futuristes de Thayaht ou de Renato Bertelli qui témoignent de sa fascination pour cette période de la création italienne marquée par l’ascension de Mussolini.
Un crâne posé sur le bureau, des revolvers hérités de son père, grand collectionneur d’armes – qui font naître chez lui un sentiment ambivalent où se mêlent attirance devant la beauté de leur forme et répulsion devant l’horreur de ce qu’ils représentent – lui servent aussi de memento mori. « Nous rêvons tous d’être immortels, reconnaît-il. La mort, c’est “le” problème auquel doivent se confronter tous les artistes. »
--
1. Rick Owens, sur le balcon terrasse de son appartement, au cinquième étage d’un immeuble des années 1950. Au premier plan, Kneeling Boy, un bronze de George Minne.
2. La partie bains se compose d’une douche et d’un lavabo en pierre. Sur le banc qui sert de desserte, deux vases en bronze de Hugo Elmquist et une coupe en métal de Rick Owens. Au premier plan, Profilo continuo del Duce, sculpture de Renato Bertelli.
3. La cuisine, réduite à sa plus simple expression (machine à café, micro-onde et lave-vaisselle), est dissimulée derrière les portes d’un placard en miroir dans la salle de musculation. À côté de l’évier, des coupes en cristal de roche et des couverts en os et argent dessinés par Rick Owens. Au sol, des feuilles de jasmin, cueillies sur la terrasse et dispersées chaque jour sur le sol dans tout l’appartement, apportent une touche végétale et remplacent les fleurs que le créateur n’aime pas.
4. La chambre et la salle de bain partagent un même espace dallé de pierre de Sardaigne. Le lit est installé sur une estrade, dans une alcôve habillée d’une couverture militaire comme celles qui sont utilisées comme des tapis sur le sol, vissées à même la pierre. Sur l’écran de télévision, une image de Salomé de Charles Bryant et Alla Nazimova, un des films préférés de Rick Owens. Au premier plan, Dux, une sculpture de Thayaht. Draps de lit teints à la couleur (D. Porthault).
5. Sur le bureau, un memento mori arrangé par Rick Owens autour de deux vases en bronze de Hugo Elmquist. Le Luger, comme les autres revolvers posés à côté du lit ou du canapé, appartenait à son père, grand collectionneur d’armes à feu.
6. Devant le bureau en bois brut dessiné par Rick Owens, un fauteuil de Eliel Saarinen, modèle très rare d’un ensemble créé en 1907 dont on retrouve d’autres pièces dans chacun des appartements du créateur. Au fond, sur une stèle en bois brut, une tête en bronze Ritratto di Filippo Tommaso Marinetti de Thayaht.
7. Les livres occupent une place prééminente dans la vie de Rick Owens. Systématiquement débarrassés de leur jaquette, ils le suivent à la plage, débordent de la bibliothèque et s’empilent sur le sol et les meubles.
8. La partie salon ouvre sur le balcon terrasse par des portes-fenêtres dont les huisseries ont été remplacées par des modèles en Inox surmontés de bandeaux boulonnés, dans un esprit Wiener Werkstätte. Le canapé est une grande banquette réalisée dans la même pierre que le sol, agrémentée de matelas et de traversins en grosse toile. À côté de la sculpture de Thayaht, une des chaises d’Eliel Saarinen. Au fond, un tabouret en bois brut dessiné par Rick Owens.
9. Un équipement de sport professionnel, haltères, poids, appareil de musculation… occupe la dernière pièce de l’appartement. Au premier plan, un sarcophage égyptien en bois datant du IXe siècle avant J.C.
10. Le cabinet de toilette adjacent à la salle de sport et ses murs en marbre noir comme les toilettes, un modèle cylindrique réalisé sur mesure que l’on retrouve dans tous les appartements de Rick Owens.
11. Vue de la terrasse sur la plage du Lido et ses rangées de cabines en bois peint.
--
Text by Marie Kalt
Image by Jean-François Jaussaud
7 notes
·
View notes
Text
Le hollandais volant

Peu de gens se souviennent à quand remontait un brouillard aussi épais. On voyait à peine devant ses pieds. La purée de pois me rappelait la victoire de Stephen Roche durant une étape du tour de France. On ne voyait rien à la télévision et il apparut soudain, une victoire en solitaire. Le commentateur eut du mal à le reconnaitre et ne pensait pas qu’il était si près. Comme tout le monde j’avançais péniblement pour rejoindre mon bureau. Puis, des cris, des hurlements raisonnèrent au loin, accompagnant un étrange bruit de cordages et de drapeaux flottant dans le vent. Les piétons s’arrêtèrent de marcher se demandant s’il ne s’agissait pas d’une attaque apocalyptique, car l’humain s’attend bien souvent au Mal en premier. Je stoppai aussi ma marche, contaminé par l’inquiétude des autres. Je regardai au loin, il n’y avait rien. Une étudiante filma les cris ainsi que ces fracas mystérieux de draps. J’imaginai une attaque de fantômes, voltigeant en effrayant les gens ou possédant quelques objets électriques pour donner des cauchemars à leurs proies. Mais en fait, quand je le vis enfin, je n’y croyais pas !
Au lieu de naviguer en pleine mer, le vaisseau flottait sur un nuage. Il avançait grâce à un vent fantôme, glissant dans l’air au son de ses voiles blanches et noires. Le bois des mats craquaient à chaque mouvement. Je reconnus une flûte hollandaise, un navire marchand et équipé pour se défendre pendant leurs voyages en mer. Ces navires transportaient du tabac, du coton ou du café et même parfois des esclaves. Il passa juste au-dessus de ma tête, ombrageant mon ciel d’un noir sans équivoque. Je me crus à minuit avec un ciel sans étoile. Quelques personnes utilisèrent leur téléphone pour le filmer en vain, le bateau n’apparaissait pas sur leur écran. J’entendis des cris dans une langue étrangère certainement du néerlandais ou du flamand, les marins travaillaient hardiment, ils semblaient paniquer, hors de leur trajectoire. Soudain le vaisseau dériva emporté par une bourrasque invisible. Il tourna à bâbord et cogna le toit de l’hôtel de ville. Cet édifice historique, ancienne capitainerie, la tour la plus imposante des remparts quand il y en avait, s’effrita à son sommet. Quelques briques s’écrasèrent sur des voitures garées devant le bâtiment, heureusement sans blesser personne.
L’équipage réussit à reprendre le contrôle du navire qui continua à voguer sur cette mer de brume et de nuages. Il passa emportant en même temps ce brouillard dense, laissant apparaitre enfin un soleil radieux.
Je regardai au loin le vacarme assourdissant de cette tornade s’éloigner et continuer son chemin au milieu des terres. Au bureau, ce fut le principal sujet de conversation pendant toute la journée.
Alex@r60 – août 2019
Photo trouvé sur le blog de @jjwild-1
26 notes
·
View notes
Text
Islande 2018
Cette île aura été l’un des voyages les plus déroutants jusqu’ici.
Je m’attendais aux grands espaces, aux paysages, au froid. Je ne m’attendais pas à désirer la solitude aussi fort, ni à ce que la désolation me ferait ressentir.
Lorsque l’on sort de l’aéroport, le plus frappant, c’est le vide. C’est comme si le site avait été déposé là, au milieu de nulle part. Le paysage est fait de terre noire et d’herbe jaune. Je n’ai remarqué que le plat, alors qu’à présent, je sais, pour les avoir vues, qu’il y avait des montagnes, à l’horizon.

Nous sommes arrivées en milieu d’après-midi, ou plutôt en fin d’après-midi pour l’Islande, car à 16 heures, les soleil décline déjà et à 17 heures 30, il fait nuit noire. Lorsque nous avons récupéré notre véhicule de location, la nuit n’a pas tardé à tomber.
Finalement, nous avons roulé jusqu’à Selfoss, de nuit, sans rien voir de l’Islande. Mais nous y étions ! J’y étais. Après tant d’années à en rêver.
Il ne nous aura fallu que quelques minutes de jour pour apercevoir ce que nous étions venues chercher : les grands espaces. La route s’est étendue devant nous, au cœur d’une large plaine, coincée entre les volcans et l’infinie plage de sable noir. J’ai allumé mon appareil photos, préparé les deux batteries de secours, ouvert grand les yeux et le cœur et je me suis lancée sur cette route, dans ce décors fait pour moi.
L’Islande ne m’a rien épargné en terme de froid, de brouillard, de pluie, de vent et de grêle. Il faut la mériter, l’Islande, l’apprivoiser, car elle est faussement paisible. Elle boue, elle s’agite, elle se déplace, elle frissonne. J’avais aimé l’Irlande, et l’Ecosse, plus encore, mais l’Islande m’a envoûtée.
RN1 - GEYSIR - GULLFOSS - SKOGAFOSS - SOLHEIMASANDUR
Le premier jour fut riche en paysages et en émotions. Tout d’abord, nous sommes allées rire près de geysers, nous amuser de leur surprenante activité, de notre incapacité à nous réchauffer alors que partout autour de nous, bouillait de l’eau. Je ne dirais pas que le geyser explose sans prévenir. Il y a, peu avant le spectacle,une accalmie dans l’ébullition. Puis, son ventre d’eau se gonfle en une bulle plutôt lisse. Et, soudain, le mot geyser prend tout son sens.
Le ton était donné ! De surprises en paysages, de silences en fous rires, d’espoirs en ravissements.
Chaque jour a porté son lot d’éblouissement. Je pense aux grandes étendues du sud, bordant cette route solitaire, à cette terre si noire, si stérile, où, pourtant, apparaît la vie. Je pense à cette épave d’avion, perdue au bout de quatre kilomètres de plage, au milieu de nulle part, fouettée par le vent. Il s’agissait sûrement d’un caprice résultant d’un gros cliché, mais il fallait que je la vois. Quelle ne fût pas ma déception, en y trouvant une dizaine de touristes... Puis, finalement, l’enfant capricieuse en moi s’est mise à jouer de son appareil photos. Je souligne ici la patience d’Audrey, face à ma détermination à obtenir la photo que j’étais venue chercher. Une fois obtenue, et après avoir pris le temps de savourer la vue de cette immense plage noire, j’ai savouré chaque mètre de ces quatre kilomètres de retour, battues par les éléments, accrochées l’une à l’autre, le vent pour bande son de nos confidences.

Nous avons également vu nos premières chutes. Difficile de dire laquelle des deux j’ai préféré ; l’immense, bruyante et bordée de glace ? Ou bien la cascade idyllique derrière laquelle l’on peut s’aventurer, et s’y faire mouiller par la même occasion ? Qu’elle était chouette cette journée...

Comme je regrette de n’avoir pas tenu de carnet de voyage. Je le regrette au retour de chaque voyage à vrai dire...
RN1 - CANYON FJADRARGLJUFUR - FOSS A SIOU - JOKULSARLON - HOFFELLJOKULL
La route du lendemain fut rythmée par les beautés de glace mariant le blanc et le noir. Ainsi, mon premier glacier m’a coupé le souffle. Il était là, sorti de nulle part, simplement comme s’il y avait été déposé. Comme j’aurais aimé y grimper. Mais il fallait un guide, du matériel, et une réservation. Finalement, ma rencontre avec la glace allait se faire un peu plus loin...

Lorsque je pensais à un iceberg, je visualisais cette immense masse blanche, seule, au milieu de l’océan, avec cet aspect un peu poudré. A présent, je pense à des dizaines e glaçons translucides, déposés sur une plage de sable noir.
Cet endroit est si inspirant que le champs des possibles des jeux que l’on peut y faire est infini. Quel gosse ne jubilerait pas à l’idée de toucher tant de glace, d’y grimper, d’y explorer ? Pourtant, côté glacier, l’ambiance est toute différente. Car si l’on se plaît à admirer les icebergs flottant dans ce bras de mer où la lumière aime à jouer de mystérieux reflets, l’on n’oublie pas que c’est le signe du glacier qui se meurt, et que nous sommes tous fautifs.

Une fois de plus, mon appareil photos a été rentabilisé. J’aime l’effet qu’il me procure, d’à travers l’objectif, ne voir que ce que je veux voir.
Route 862 - ROUTE DES FJORDS - DETIFOSS - KRAFLA
Puis ce fut la route de l’Est et ses fjords. Au gré des recherches d’auberges de jeunesses, elle nous est tombée dessus... l’aurore boréale. Le ciel est devenu vert au dessus de nous, comme un drap nous voilant de couleur, resté suspendu quelques instants. Ce fut une surprise, une expérience unique, que nous n’avons pas eu la chance de revivre.
La route de l’Est nous fit sillonner de charmants paysages jusqu’au Nord, où un autre monde nous attendait. Je garde un souvenir précis de ma première vision de ce paysage lunaire, en noir et blanc. Monter, toujours monter, plus haut, plus froid. Cette roche noire partout autour de nous, recouverte de neige immaculée, la lumière venant timidement s’y refléter, le tout bercé par le bruit fracassant de cette incroyable chute d’eau.

Je crois que c’est l’endroit que j’ai préféré, tant il était indomptable.
PENINSULES DE VATNSNES ET DE SNAEFELLSNES - STYKKISHOLMUR
Puis nous avons roulé plein Ouest, jusqu’à rejoindre une première péninsule, dont on nous avait vanté les paysages, lesquels étaient à la hauteur de nos attentes. Cratères volcaniques en bord de route, points de vue et sources d’eau chaudes. C’est ce jour-là que nous avons décidé de sacrifier Reykjavik et de lui préférer la péninsule de Snaefellsnes. Et nous avons été bien inspirées.

Quelle claque, quels paysages. Arrivées dans l’après-midi, nous avons fait escale à Oflavik, à la pointe, pour y passer la nuit après avoir savouré le coucher un coucher de soleil magnifique, sans un nuage. Nous nous sommes, pour fêter ça, offert notre premier restaurant ! Il faut dire que se nourrir coûte un bras en Islande, alors, nous avons dégusté nos langoustines, notre dodlukaka (dessert au chocolat et à la cannelle) et notre bière Einstok, bien évidemment !
La ville était déserte, mais elle valait le détour pour cette charmante église à l’architecture improbable.
Lorsque nous avons repris la route au matin, pas trop tôt, pour que le jour ait le temps de se lever, nous n’avions, je crois, pas imaginé les paysages qui allaient nous entourer.
La route longe l’océan Atlantique. Le soleil s’y est levé timidement vers 10 heures. à notre droite, les flots, à l’air glacial, offrant un horizon sans fin. A notre gauche, les montagnes magnifiques, des volcans verts et noir, aux pointes enneigées. Voir le soleil les colorer de ses reflets rose-orangés était bouleversant.

Il faisait bon ce jour-là, le soleil était timide mais bien présent. Alors, lorsque nous avons découvert cette étendue de mousse en bord de route, nous n’avons pas résisté. Nous sommes allées marcher sur cette épaisse couche verte recouvrant les pierres volcaniques. Le lieu était tellement apaisant que nous nous sommes allongées, pour profiter, du soleil, du silence, du moelleux de notre tapis vert, des couleurs sur la montagne... J’aurais voulu ne jamais repartir...
Mais, paraît-il, un avion nous attendait le lendemain... A contre coeur, nous sommes remontée dans notre petit 4x4 qui n’en avait que le nom et avons roulé jusqu’à Pingvellir, sur la route 36. Haut lieu de tourisme proche de Reykjiavik, il a abrité, si l’on en croit l’histoire, le tout premier parlement de l’humanité. Nulle ruine, nulle construction. Simplement une gorge naturelle où les premiers islandais se réunissaient pour prendre les décisions pour le peuple. Ce lieu, chargé d’histoire, nous rappela que l’Islande n’était pas déserte, malgré le silence et les espaces vides que nous avons parcourus durant la semaine. Je crois que si nous avions pu, nous aurions sauté dans la voiture pour les retrouver.
Mais il a fallu rejoindre l’hôtel, proche de l’aéroport, en profitant tout de même du reste de lumière de la journée pour visiter la péninsule de Reykjanes et ses lacs.

L’Islande m’aura marquée à jamais. Je voudrais retrouver ses paysages et sa quiétude, en prendre plein la vue et me sentir infiniment petite, mais infiniment à l’écoute. Je voudrais pouvoir me réfugier encore sur ce matelas de mousse au soleil, au pied d’un volcan enneigé en bord de fjord.
L’Islande m’appelle.
1 note
·
View note
Text
Jour 34, 35 - 22, 23 Février Kampot et Kep : Du sel, du poivre et du crabe nom de Dieu...
Après un réveil bien trop tôt, et un petit-déjeuner bien trop médiocre (ce moment d’angoisse où tu vois deux cafards sortir du grille pain où tu viens d’enfourner ton pain…) la navette pour rejoindre notre bus passe nous prendre à l’hôtel. C’est reparti pour un trajet de 5h environ où nous sommes installés au premier rang, ce qui immédiatement me rappellera les bons conseils de notre ami Bjoern : “Ne t’assois jamais dans les 3 premiers rangs, statistiquement ce sont ceux qui subissent le plus de dommages en cas d’accident !”. Joie. Je relativise cependant quand je vois l’accompagnatrice du chauffeur déplier une chaise de camping pour s’asseoir dans l’allée centrale, à quelques centimètres du pare-brise.
Le trajet, sportif, mais nous avons dorénavant l’habitude, se déroule plutôt bien, et nous parvenons à notre destination en milieu d’après-midi : la Green House, charmante propriété où nous logerons dans un bungalow de paille et de bambou avec Marion et Florian. Très sympa visuellement, moins en terme d’intimité (je n’entrerai toujours pas dans les détails, mais mon petit estomac sensible maudit encore ces parois avec des trous d’un pouce ou plus)... Profitant des derniers rayons de soleil, nous nous dirigeons vers la petite plage privée et piquons une tête dans la rivière où l’eau est à la même température que l’air ambiant avant d’essayer le restaurant de la Green House. Les plats sont très chers, mais se révéleront exceptionnels. Personnellement impressionné par la cuisson de la longe de porc, j’oublie rapidement l’addition salée qui accompagne ma boule de glace au poivre rouge de Kampot. Nous rentrons donc au bungalow, fatigués, comme après chaque journée de transit, avec l’objectif de nous écrouler rapidement dans notre lit couronné d’une moustiquaire. Sauf qu’au moment de passer sous la douche, Florian revient dans la pièce principale en nous expliquant que non, ce soir il ne prendra pas de douche car un gecko de 30cm a élu domicile à proximité directe de la cabine… Après un rapide coup d’oeil, il s’avère qu’il a raison, le reptile est considérablement plus gros que ceux rencontrés jusqu’à présent, ne dépassant que rarement la dizaine de centimètres. Nous élaborons alors un stratagème, incluant un balais et une petite dose de courage, avant que Marion ne nous arrête dans notre élan : une rapide recherche Google lui aurait suggéré qu’un gecko stressé propulse autour de lui une substance toxique afin de venir à bout de ses prédateurs. Okay. Nous décidons donc d’un accord tacite de nous réfugier sous nos moustiquaires, en espérant qu’elles soient également des geckoaires, et de fermer les yeux jusqu’au lendemain matin en maintenant nos doigts croisés pour que le vil lézard ait quitté notre salle de bain.
Le lendemain matin, notre ennuyeux porteur d’écailles est toujours là, et il a convié une amie à le rejoindre : une énorme araignée, de la taille de ma paume de main (et je tiens à préciser que je n’ai pas des mimines d’enfant), se trouve maintenant à ses côtés. Surpris que le gecko ne soit pas plus intéressé par un casse-dalle de cette dimension, nous nous rappelons alors avec joie qu’aujourd’hui nous changeons de bungalow : en effet, au moment de la réservation celui-ci n’était disponible que pour une nuit, et nous avons dû booker celui se trouvant juste à côté, un poil plus cher mais aussi un poil plus grand.
Aujourd’hui, nous avons prévu de passer la journée à Kampot, pour découvrir une plantation du poivre local très renommé, avec quelques arrêts sur la route pour découvrir différents lieux de la région, puis d’aller à Kep, la ville voisine connue pour son marché aux crabes. Nous avions réservé la veille deux tuk tuk pour la journée (45$ chacun, ce qui est énorme, surtout quand on sait que le salaire mensuel régional est de 90$...), mais malheur, ce matin Yann ne se sent pas bien et ne se lèvera pas. Lucie, en bonne conjointe, décide de rester à son chevet pour le veiller (note de Cha : je vais discuter avec Arthur de sa notion de bonne conjointe ….). Nous tentons donc de négocier pour annuler le deuxième tuk tuk, qui n’est plus nécessaire depuis que la troupe de 6 est passée à une équipe de 4, mais il nous sera malgré tout demandé 10$ pour le déplacement, le tuk tuk étant déjà arrivé. Un peu cher, mais nous aurons fait un heureux…
Nous rejoignons notre amène automédon, dont la prospérité est dorénavant assurée, et nous embarquons dans notre frêle fardier pour rejoindre l’ocre poussière des routes khmers. (Arthur, futur prix Goncourt, pour vous servir.)
Premier arrêt :
Les marais salants exploités par les Cham, une communauté de musulmans locale. Nous nous baladons rapidement le long des précieux cristaux blancs exposés au soleil tout en observant un petit groupe de personnes occupées à préparer les prochains bassins destinés à recevoir l’eau salée, appelée à s’évaporer, et en écoutant les explications de notre chauffeur sur les procédés de conception et de stockage du sel.
Deuxième arrêt :
Un temple caché dans une grotte. C’est, de ce que l’on nous a dit, le plus beau temple du coin, et il date du 7ème siècle : à voir donc ! En arrivant sur place, notre guide nous présente un jeune homme, et nous explique c’est un type super qui connait très bien le coin, et que pour seulement 2$ il nous emmènera jusqu’au temple caché. Pourquoi pas, ce n’est pas si cher et ça peut être intéressant d’avoir quelques infos complémentaires sur le lieu ! Nous suivons donc notre guide, et croisons plein d’enfants très souriants sur la route, ravis de nous envoyer des “C’est parti mon kiki !” et des “Roule ma poule !” pour montrer qu’ils savent parler français. Marrant !
Nous arrivons au pied d’un escalier, et le guide nous explique qu’il faut monter environ 250 marches, puis redescendre de l’autre côté pour s’enfoncer dans la grotte. Okay ! Aucun souci durant cette courte ascension, même si on ressent bien la chaleur dès la 50 ou 60ème marche. La vue sur la vallée est imprenable et on apprécie s’arrêter cinq minutes pour prendre des photos et reprendre notre souffle. Nous arrivons finalement dans la fameuse grotte, où nous découvrons le temple. Enfin temple… Il s’agit plutôt d’un autel, car il n’est pas bien grand : 4 ou 5 mètres carrés tout au plus. Ce n’est pas grave, l’endroit est sympa comme tout, et notre guide du moment nous montre différentes roches baptisées par des noms d’animaux à cause de leurs formes (le rocher de l’éléphant, le rocher du crocodile, etc…). Le jeune khmer veut ensuite nous emmener dans les profondeurs de la grotte, mais là, nous déchantons rapidement : il faut descendre à pic, entre diverses formations rocheuses et sans beaucoup d’accroches, pour ressortir en bas de la montagne, là où commençait l’escalier. Charlotte n’est pas partante du tout, normal pour quelqu’un qui n’aime les endroits confinés, mais aucun membre de notre groupe de joyeux lurons ne l’est réellement : nous ne sommes pas vraiment équipés pour ce genre d’escalade, et le chemin semble VRAIMENT étroit. Ne voulant pas rater une expérience qui ne se reproduira pas de si tôt, j’hésite et jette malgré tout un oeil dans la crevasse qui s’enfonce dans les entrailles de la montagne. Le guide m’éclaire le chemin avec sa lampe torche (ah oui, j’ai oublié de préciser qu’il faut descendre dans le noir complet), et me montre comment descendre les 2-3 premiers mètres. Donc, non. Malgré l’aisance dont fait preuve ce gamin du coin, je ne me sens pas capable de le suivre : la roche est lisse et j’ai un doute quant au fait que mes fesses puissent passer à certains endroits. Nous lui expliquons donc que nous préférerions repartir par le chemin d’où nous sommes venus, et malgré sa surprise et sa déception (il avait l’air vraiment content de nous faire découvrir ce chemin caché) nous rebroussons chemin. (note de Cha : il nous a montré là où nous aurions dû ressortir et je pense pas que mon corps passait par le “trou” de la sortie… J’aurai bien aimé voir s’il y avait vraiment des touristes qui faisaient cette petite escapade)
Arrivés au tuktuk, nous devons payer notre guide, et surprise (ou mauvaise compréhension…) il s’agissait en fait de 2$ par personne. La visite n’ayant vraiment pas duré longtemps, et l’accompagnement d’un guide n’étant, après tout, pas si indispensable que cela, nous nous permettons de négocier un peu et payons 4$ pour 4 personnes. Cela nous semble malgré tout un bon prix pour le laps de temps qu’il nous a consacré, et nous voyons arrivé d’autres touristes derrière nous, il y a fort à parier qu’il a de nombreux clients tous les jours. Nous reprenons notre route !
Troisième arrêt :
Nos fesses commencent déjà à nous faire mal. (note de Cha : personnellement ça allait mais il est possible que mon fessier soit plus moelleux que celui des autres). Nous sommes arrêtés au niveau du Secret Lake. Qu’est-ce donc que ce lieu ? Si sa localisation n’est aujourd’hui plus un secret, ce lac gigantesque a été creusé à la main par des esclaves du régime des Khmers Rouges afin de servir de charnier à ciel ouvert pour les opposants du régime, qui comme nous l’avons découvert au musée S-21 ne sont finalement pas souvent des opposants avérés mais plutôt des malchanceux s’étant trouvé au mauvais moment au mauvais endroit… Il semblerait donc que le fond soit recouvert des ossements de ces malheureux. Depuis, le charnier a été recouvert d’eau, tant pour masquer l’abominable histoire que pour servir de réservoir d’eau aux cultures agricoles locales. Il est très difficile d’avoir des informations sur ce lieu, pratiquement rien sur internet et dans les guides, il a fallu recouper diverses informations glanées ça et là auprès de locaux. Il est possible que la version que je vous retranscris ici soit partiellement erronée, certaines variantes semblent expliquer que les corps reposant au fond de l’eau sont ceux des esclaves morts durant l’énorme chantier que représentait l’excavation du lac, qui était déjà prévu à des fins agricoles dès son élaboration. Nous n’en aurons sûrement jamais le coeur net… Il est en tout cas assez incroyable de constater qu’aujourd’hui, quand on tape “Secret Lake Kampot” sur un moteur de recherche, ce dernier préfère mettre en avant les commentaires TripAdvisor de touristes vantant le plaisir de se baigner dans le lac (certainement la dernière chose à laquelle nous aurions pensé nous même) plutôt que sa triste histoire. En remontant dans notre tuk tuk, nous ne pouvons nous empêcher de constater encore une fois, avec candeur, la quantité de malheurs qui s’est abattue sur le Cambodge.
Quatrième arrêt :
La Plantation. C’est l’arrêt que j’attendais le plus ! Une plantation de poivre (et de plein d’autres choses en fait : mangue, fruits du dragon, piments…) qui s’appelle La Plantation (original) avec visite gratuite, en français et dégustation des différents poivres produits sur place. Le top quand on est comme moi à la recherche de saveurs du monde. L’endroit est beau, mais presque un peu trop : on sent qu’il y a un aspect marketing très poussé et que nous ne sommes pas dans la petite plantation locale. C’est ce que nous avait dit notre “conseiller” à la Green House : La Plantation a été créée par un riche couple Franco-Belge il y a seulement 5 ans, et via des opérations de communication massives auprès des tour-operator, des hôtels et même des tuktuk, La Plantation est rapidement devenue “the place to be” dès que l’on parle de poivre de Kampot. Cependant, nous sommes très bien accueillis, et nous partons rapidement découvrir la production de poivre accompagnés d’un groupe de français et de notre guide, Merlin (enchanté !).
Merlin est souriant, intéressant et connaît son sujet malgré qu’il ne soit arrivé sur ce site qu’il y a quelques mois. Il nous fait découvrir, sous un soleil de plomb, tous les angles de la production, de la récolte du poivre et de plusieurs autres aspects qui entoure cette culture : l’aspect permaculture (planter d’autres choses que du piments pour que les plantes interagissent entre elle, comme le piment qui repousse les nuisibles, ou certaines fleurs plus sensibles qui permettent détecter de les maladies ou les champignons avant que ceux-ci ne s’en prennent au poivre…), l’aspect social (La Plantation, de ce qui nous est dit, choisi de doubler le salaire mensuel des locaux qui viennent travailler sur place) ou encore l’aspect économique avec la démarche de créer un label pour contrôler l’origine et la conception du poivre de Kampot.
Je ne pourrai pas vous relater toutes les informations que nous apprendrons durant cette visite, ou alors il nous faudrait créer un blog sur cet unique sujet si vaste.
Viens l’heure de la dégustation !
Poivre vert, noir, blanc ou rouge, nous goûtons entre quinze et vingt déclinaisons de poivre, toute produit à partir de la même graine (le poivre vert n’est pas arrivé à maturité, le poivre noir est un poivre vert séché au soleil, le poivre rouge est un poivre vert arrivé à maturité, et le poivre blanc est un poivre rouge un peu “moche” qui sera épluché et qui perdra au passage sa couleur). J’ai un coup de coeur durant cette dégustation : le cuir de poivre long. Il s’agit à priori de lamelles de poivre long séchées au soleil après une longue maturité sur pied, qui suite à ce procédé développent des notes incroyables : chocolat/caramel/spéculoos/beurre, au moment même où je l’ai goûté j’ai tout de suite vu des dizaines d’applications possibles en cuisine (je suis persuadé qu’un Kouign-Amann serait sublimé par l’utilisation de ce cuir de poivre, ne me demandez pas pourquoi).
C’est la bouche en feu et les sinus débouchés (oui la dégustation était ponctuée de nombreux éternuements) que nous remettons sur notre tuktuk : il est désormais l’heure de manger, alors direction Kep pour découvrir son marché aux crabes qui fait sa renommée.
Après près d’une heure de tuktuk (aïe… aïe… AÏE !), nous arrivons directement au fameux marché. L’heure est un peu avancée, il est donc possible qu’une partie de l’activité soit déjà terminée, mais qu’est-ce que ça bouillonne ! Nous nous enfonçons sous les toits de bâches et de taules qui recouvrent les dizaines d’étals. Certains pêchent, d’autres négocient les prix, tous cuisinent des crabes et autres crustacés. Nous tentons de négocier le prix, assez élevé, qui nous est proposé pour les différentes composantes de notre futur repas, mais nous comprenons rapidement que d’un stand à l’autre, un prix “touriste” a été déterminé en amont. Pas grave, c’est le jeu. Nous achetons donc un petit crabe chacun, ainsi qu’un calamar, qu’un monsieur va nous cuisiner avec une sauce au poivre vert de Kampot. Top. Nous patientons attablés entre tous ces étals, l’air encore un peu plus réchauffé par la fumée des dizaines de barbecues en action autour de nous. La pitance arrive, et nous ne laissons aucune chance à ces délicieux crabes épicés : aucune miette ne sera perdue.
Le ventre plein, et la nuque rouge, nous profitons d’une dernière vue sur la mer puis décidons de rentrer à notre petit bungalow où, nous l’espérons, il n’y aura pas de gecko dans la douche.
Finalement, pas de gecko, mais de nombreuses petites crottes sur la lunette des toilettes (notez l’effort de politesse) qui attestent du passage d’un rat ou d’une souris.
Arthur
1 note
·
View note
Text
Absurdité.Lanzarote, l’île espagnole aux “hôtels illégaux”
Absurdité.Lanzarote, l’île espagnole aux “hôtels illégaux”
“Aucune portion de littoral en Espagne ne compte autant d’hôtels illégaux que sur l’île canarienne de Lanzarote, notamment dans la petite commune de Yaiza. Là, au milieu d’un spectaculaire paysage volcanique de roche noire, se dresse l’hôtel Sandos Papagayo […], une masse blanche en bord de mer. Outre le fait qu’il n’a plus de permis de construire depuis son annulation en 2007 par le Tribunal…

View On WordPress
0 notes
Photo

Un inoubliable dîner de gala multi-étoilé au @casinosmontecarlo pour clôturer en apothéose la première édition du Festival des Étoilés @montecarlosbm , qui s’est déroulé entre mai et novembre 2021. C’est en présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, accompagné de ses neveux Louis et Marie Ducruet, que samedi dernier, le 27 novembre a eu lieu, dans le prestigieux salon de jeu - la Salle Médecin - du Casino de Monte-Carlo, le dîner de clôture du Festival. Un menu en cinq services exécuté par les six chefs étoilés - @yannickalleno Franck Cerutti, @alainducasse, @manonfleury__ , @dominiquelory, @marcelravin - qui ont fait le show depuis le gigantesque passe-plat, « Pass Live », placé en salle, entourés de leurs équipes des restaurants @lelouisxvmonaco Alain Ducasse à @hoteldeparismc , Le Grill, Yannick Alléno à @hotelhermitagemc, Elsa , le Blue Bay @montecarlobay , mais également des talentueuses brigades du Resort. Les chefs ont livré leur plus belle création, leur plat Signature, accompagné d’un parfait accord met-vin, travaillé avec les sommeliers de la société et les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo : les ‘Gamberoni de San Remo et sa fine gelée de poisson de roche, caviar’ des Chefs Alain Ducasse et Dominique Lory, suivi de l‘Œuf de Monte-Carlo, truffe blanche, manioc et maracudja’ du Chef Marcel Ravin, puis de la ‘Dentelle de courges et agrumes, crème à l’eau de fleur d’oranger’ de la Cheffe Manon Fleury, suivie du ‘Veau fermier aux truffes noires et ses champignons sylvestres’ du Chef Franck Cerutti, avant la surprenante ‘Extraction de sapin en gelée glacée au café, éclats de cristallines épicés et crème chaude onctueuse au chocolat’. Un véritable voyage dans la galaxie étoilée du Resort SBM et du Grand Art de Vivre de Monte-Carlo. Rendez-vous en automne 2022 pour la 2ème édition du Festival des Étoilés qui promet de belles surprises et qui démontre une nouvelle fois le dynamisme et l’extraordinaire place de la Principauté et du groupe Monte-Carlo SBM au firmament de la scène Gastronomie à l’international. #festivaldesétoilés #mymontecarlo #montecarlosbm #monaco #gastronomie #chefetoile #visitmonaco #cotedazurfrance ©️montecarlosbm (à Casino Monte Carlo) https://www.instagram.com/p/CW-mFhnNPKH/?utm_medium=tumblr
#festivaldesétoilés#mymontecarlo#montecarlosbm#monaco#gastronomie#chefetoile#visitmonaco#cotedazurfrance
0 notes
Photo

LA PLAGE DE DEAUVILLE VUE DU PORT DE TROUVILLE par Jean-Baptiste Camille COROT. La première visite de Marcel Proust dans le Calvados fut à Trouville-sur-Mer en 1885, à l’occasion d’un séjour avec sa grand-mère à l’hôtel des Roches Noires. La plage de Trouville, avec ses villas, lui inspirera la propriété de La Raspelière dans son roman « À la recherche du temps perdu ». "Pour en donner une idée... Il faudrait vaincre le temps comme un obstacle, le conquérir comme une amitié. sans laisser de côté ces mystères... Et dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n'ont eu le temps que d'être esquissées et qui sans doute ne seront ont jamais finies,... Combien de grandes cathédrales restent inachevées !" Marcel PROUST. ("À la recherche du temps perdu") LEONARD COHEN "On that day" https://youtu.be/ff7FkN-wKxs #culturejaiflash https://www.instagram.com/p/CKyHavflLke/?igshid=1gtz61w42jcpa
0 notes
Text
Noël aux Galàpagos

Si on nous avait dit un jour qu'on irait aux Galàpagos, on ne vous aurait peut-être pas cru. Ces archipels volcaniques préservés fascinent autant qu'ils attirent avec leur faune terrestre et marine extraordinaire. Tortues géantes, lions de mer, iguanes, fous à pattes bleu, frégates, pingouins, requins marteaux, raies... Pour Noël, il nous fallait quelque chose d'unique. Pour Noël, on s'est offert les Galàpagos.
L’île Santa Cruz

On quitte Santiago au Chili pour rejoindre Guayaquil en Equateur. C'est d'ici que l'on prend l'avion pour les Galàpagos ! On est tout excités et pressés de découvrir ces îles mystérieuses échouées dans le Pacifique. En quelques heures à peine, on arrive à Baltra, une toute petite île qui accueille l'aéroport et rien d'autre. On prend un car, puis un bateau puis un taxi pour rejoindre Santa Cruz, l'île principale et la plus peuplée des Galàpagos. L'air est chaud et iodé. On s'y sent déjà vraiment bien.

Tortuga bay
A peine a-t-on posé les sacs à l’hôtel qu'on part à l'aventure. On enfourche nos vélos et on traverse la ville jusqu'à l'entrée de Tortuga bay, la plus belle plage de l'île. Cette plage est très préservée. Le sentier qui nous y conduit se parcourt en 40 minutes de marche et il faut respecter certains horaires de visite afin de ne pas troubler la vie des animaux. Nos tongs claquent sur nos talons au rythme de nos pas, pressés de découvrir cette première merveille. Lorsque l'on arrive enfin sur la côte, la vue est splendide et le sable doux et blanc. La mer est agitée et forme de gros rouleaux qui font le paradis des surfeurs. On longe cette magnifique plage pour rejoindre une crique où l'on peut se baigner. En chemin, on croise nos premiers iguanes qui se dorent la pilule. Ils ne sont pas si facile à voir au premier coup d’œil car ils se confondent avec la couleur des roches. A certains endroits, ils sont même tellement nombreux sur le sable qu'on doit les enjamber. On arrive sur une petite plage paisible, protégée par les courants. Un pélican se repose tranquillement, les pieds dans le sable. Une petite raie nage en sortant ses ailes à la surface de l'eau. Sur le chemin du retour, on croise un lion de mer qui fait la sieste sur le sable. On vient d'arriver et c'est déjà incroyablement beau.

Plongée avec les requins à Gordon Rocks
Les îles Galàpagos sont aussi réputées pour la richesse de leur faune marine. Requins marteaux, requins des Galàpagos, tortues marines, lions de mer, raies, mola mola... Il ne nous en faut pas plus pour convaincre les mordus de plongée que nous sommes ! L'un des meilleurs sites est Gordon Rocks, un cratère volcanique enseveli à quelques heures de bateau qui abrite de nombreux requins marteaux. On n'en a encore jamais vu et ça nous fait frissonner d'avance.

On embarque de bon matin sur notre bateau de plongée. Des frégates viennent voler juste au dessus de nos têtes. Avec leurs ailes déployées, on dirait des reptiles volants du temps des dinosaures. Lorsque l'on approche du site de plongée, ça donne déjà le ton. Deux blocs de pierre à chaque extrémité du cratère dépassent de l'eau et forment une gueule béante prête à nous accueillir dans ses profondeurs. On s'équipe et on se jette à l'eau. Comme ça fait 2 ans qu'on n'a pas plongé, ça nous fait tout bizarre d'en retrouver les sensations. On s'enfonce à une vingtaine de mètres dans une eau un peu trouble et plutôt froide.

On croise un premier banc de barracudas avec leurs écailles qui scintillent à la lumière. On aperçoit de loin un mola mola. Ce poisson-lune est assez étrange, d'autant plus qu'il peut atteindre 3 mètres d'envergure. Quelques tortues marines font leur apparition puis on croise un magnifique banc de raies qui nagent à l'unisson. Et les requins ? On les attendait. Les voilà qui débarquent. Des requins marteaux surgissent de l'eau trouble par dizaines, accompagnés de requins des Galàpagos. C'est impressionnant (et flippant). On ne s'attendait pas à en voir autant. Je m'accroche au bras d'Antoine pour ne pas avoir l'impression d'être seule au milieu d'eux. On les regarde nager tout autour de nous, complètement ébahis.




Centre Darwin et tortues géantes
On ne peut pas aller aux Galàpagos sans rencontrer le spécimen qui en fait sa plus grande notoriété : la tortue géante ! Le centre Darwin en recueille une grande partie et plusieurs espèces de tailles différentes. Elles se déplacent comme des petits vieux épuisés par le poids de (leur carapace) la vie. Lorsqu'on leur apporte le déjeuner, elles relèvent leur cou ridé et se précipitent (à un rythme de tortue effréné) pour aller croquer les feuilles. Les plus grosses tortues chassent les plus petites à coup de tête. C'est la loi de la carapace ici.


Après 3 jours sur l'île Santa Cruz, il est temps pour nous d'aller s'isoler un peu plus dans la richesse des Galàpagos. On prend un bateau pour rejoindre l'île Isabela, la plus grande en terme de superficie, mais surtout la plus sauvage.
L’île Isabella
Lorsque l'on arrive dans le petit port de Puerto Villamil, on est accueilli par des lions de mer qui plongent dans l'eau ou font la sieste sur le ponton. Encore une fois, on est étonné par la proximité naturelle avec les animaux. Puerto Villamil est une toute petite ville paisible avec des rues encore en terre. Il ne nous en fallait pas plus pour nous sentir véritablement dépaysé.

Balade à vélo
Pour notre première journée sur l'île, on décide de découvrir à vélo les points d'intérêts à proximité. On emprunte un sentier qui longe la laguna Salinas où barbotent des flamands rose. On rejoint par une petite forêt un centre de reproduction de tortues géantes. Un panneau nous explique avec une illustration très réaliste que "Para las tortugas gigantes, no es fàcil copular !" On a la chance de voir des bébés tortues trop mignons qu'on ramènerait bien à la maison (faudrait juste s'en occuper pendant 150 ans quoi).

On se dirige ensuite sur une route de sable qui longe la côte à l'ouest de la ville. La plage est beaucoup plus longue que Tortuga bay et presque plus jolie encore. On arrive à la Playa del amor, une plage de roches volcaniques... couvertes d'iguanes agglutinés les uns sur les autres. Si ça c'est pas de l'amour !


On fait ensuite un petit stop bronzette à la Playita, une petite plage secrète encerclée par des arbres. C'est pas plutôt celle-là la playa del amor ? On partage ce petit bout de plage avec des voisins de serviette immobiles, les iguanes toujours.

A côté du port de Puerto Villamil se cache un sentier qui mène à Concha de Perla, une petite baie dédiée au snorkelling. On emprunte une passerelle en bois qui passe au dessus des mangroves lorsque l'on croise des lions de mer assoupis. Ils ronflent comme des bienheureux. On les enjambe pour continuer notre route jusqu'au ponton de Concha de Perla.

Masque et tuba en place, on s'engouffre dans l'eau gelée. Même avec une faible profondeur et près du port, on croise de beaux spécimens avec une raie, un lion de mer et une tortue.

La journée se termine avec un incroyable coucher de soleil. En passant sous la masse de nuages, les derniers rayons du soleil sont d'une telle intensité qu'on dirait une nébuleuse qui s'embrase. Magique.
Excursion à Los Tuneles

L'île Isabela possède 6 volcans qui ont marqué le paysage et les côtes de leurs irruptions passées. Les coulées de lave ont formées des tunnels et ponts naturels creusés par l'eau de mer dans lesquels s'aventurent de multiples bestioles. Cette excursion est la plus réputée de l'île, on ne pouvait pas la manquer.

On monte à bord du bateau de bon matin pour longer la côte pendant quelques heures. Le capitaine bifurque vers les terres lorsque l'on aperçoit au loin la roche noire volcanique. Il entame un sprint maritime pour dompter la puissance des rouleaux. On est secoués dans tous les sens jusqu'au moment où tout s'apaise : nous voilà arrivés aux Tuneles. L'eau est bleu turquoise et complètement transparente. Les roches noires donnent au paysage un relief tourmenté mais étonnamment hospitalier. On rencontre notre premier pingouin des Galàpagos, posé fièrement sur son petit rocher.


On s'engouffre de plus en plus dans ce labyrinthe de roche puis on s’amarre pour aller marcher sur les ponts naturels. En quelques minutes à peine, on aperçoit des tortues marines qui s'aventurent dans les alcôves formées par les roches. Puis, clou du spectacle animalier : le fou à pattes bleu !

Ce bel oiseau endémique a la particularité d'avoir les pattes toutes bleues. En plus, on peut les approcher de très près. L'un des fous entame une danse de séduction pour copuler avec la femelle d'à côté. Il lève simultanément chacune de ses pattes pour les poser au sol avec rythme et précision. Il déploie ses ailes, approche son bec du bec de la femelle. Mais la tentative de bécot échoue, la femelle s'enfuit.




On rejoint le bateau pour la deuxième partie de l'excursion : 1h de snorkeling au milieu des tortues géantes et requins de récif. A peine avons-nous plongé dans l'eau qu'on n'est pas déçus. Avec si peu de profondeur, on voit déjà des dizaines de tortues nager tout autour de nous. C'est limite s'il ne faut pas surveiller là où l'on bat des palmes.


Et puis d'un coup, on assiste à un gang bang de tortues. Deux sont en train de copuler et nagent enlacées. Deux autres tortues mâles les suivent avec envie et tentent de mordre les pattes du vainqueur pour le remplacer. On ne sait malheureusement pas comment ce quatuor amoureux s'est terminé, car les tortues se sentant un peu trop observées, se sont enfuies pour retrouver leur tranquillité. Les coquines.

On explore ensuite les grottes à la recherche des requins de récif. Ils ne mesurent qu'1 mètre et se cachent sous les rochers. On en approche quelques uns, tapis dans l'ombre.
Le Réveillon chez l'habitant
La journée du 24 est placée sous le signe du chill. On se balade sur la plage et on bronze avec les iguanes.



Pour le Réveillon, on est invité chez le gérant de l'hôtel où on séjourne. Il est absolument adorable et ça nous permet de tester un Noël local, chez l'habitant. Sa femme nous a préparé du porc et du poulet que l'on déguste avec une salade de riz aux légumes. On est très loin du Champagne, foie gras, saumon fumé et compagnie qui nous fait saliver rien que d'y penser, mais c'est Noël, et on est sur les Galàpagos !


PS : une petite pensée émue pour nos familles qui nous manquent !
3 notes
·
View notes
Text
La force du bois, son cœur battant de sève m’appelle, dong dong dong, comme bat un clocher pour le crépuscule, pour l’arrivée du noir. La gueule ouverte du bois, les gencives sombres d’où poignent quinze cents échardes, la langue d’eau, les yeux jaune pâle des chouettes. Je quitte la caverne. Dehors tout est magie, poignard, vis. Tout est plaie, machine, rire. Les atomes du bois, la force magnétique qui les tient ensemble. Les écorces vibrant à blanc, dans l’air nu remué. On s’ouvre. Les aisselles, les cuisses, les orifices du nez et des yeux s’ouvrent : la salive reflue, du tube dans le ventre à la bouche et au sol. La bouche qui s’imprègne d’épines. On goûte l’amertume par le filet glué à la terre, jusqu’au foie. On se tient là mangée, aussi courbée qu’une chose fondue, presque enterrée et partout s’étendant par les racines qui furent des jambes, par les branches qui furent des bras, la peau couverte de larves et têtards, les épaules cassées joignant les angles de la terre, la colonne des vertèbres suintant son suint couleur de roche, les oiseaux par les arbres échangés comme murmures et grognements picorant nos dernières choses charnelles, les restes, les rogatons du derme, le calcaire des os, la lueur frémissante des membranes.
Mille malheurs.
Je sors de ces forêts premières, traverse des pays, piétine des sols de boue, mes pieds s’enfoncent dans une vase grumeleuse pleine de fibres, de copeaux, tout est obscur et bas. Les hommes d’ici ont des faces mauvaises, rongées de rage tordue, on aperçoit le soir des îlots pailletés d’un or pâle, peut-être des villes, je ne m’approche pas, marche droit, marche et encore marche, la terre sèche, se couvre de pousses maigres, effilochées, puis ce sont des vallées d’herbe tendre, une confrérie de montagnes s’écrase sous des ciels lourds, on retrouve des arbres, pommiers aux fruits très denses et petits que j’entends cogner dans mes poches, les montagnes s’allongent, leur étirement vient à moi, je dois grimper, plaquer les pieds contre le granit et pousser, sentir l’air fuir, le froid faire cisaille, des nuages en forme de couteaux bataillent au-dessus de mon crâne, lame contre lame, se brisent, mes mollets raidissent, enflent, partout sous la taille me poussent des muscles nouveaux, je marche encore.
À l’origine : c’était les débuts du mouvement. J’étais à peine arrivée devant le commissariat central. Ce jour-là n’était pas un bon jour. Je voulais pas venir, je voulais rester chez moi, manger, manger tout, manger n’importe quoi, ce qui traînait, les yaourts moisis au fond du frigo, les araignées aux coins des murs, le pain dur, des bougies, du plâtre, tout, n’importe quoi, j’avais pas envie de venir, je m’étais forcée.
C’était pas un bon jour pour aider le mouvement. Ça se voyait. Aussitôt je pensais repartir. Pas à cause des flics.
Pas non plus une question de pisse. Ce n’était pas le problème. Je maîtrise parfaitement côté pisse. Quoi qu’on en dise – surtout les hommes : côté Leibowitz. Surtout le vieux tonton Leibowitz qui a dans le regard comme un éclat de diamant répugnant ou de rubis sale, à voir, faut-l’avoir vu pour le voir le vieux Leibowitz frère de la grand-mère Leibowitz.
Qui m’a toujours appelée La petite pisseuse, lui, l’oncle Leibowitz, affectueusement mais avec sa pierre mal lavée dans l’éclat de l’œil, et après ça comment voulez-vous ne pas devenir la petite pisseuse, échapper au destin, à la construction par la remarque mille fois répétée accompagnée du regard mille fois répété du grand-oncle côté Leibowitz : c’est simple, vous ne pouvez pas, ne serez – jamais rien d’autre pour lui – qu’une petite pisseuse, et ensuite pour soi, pour soi, c’est très long, faut se remettre, devenir autre chose.
Une question de tripes en vérité, dès l’arrivée devant le commissariat robuste, central, pas un commissariat simple mais un hôtel de police, imposant, sacrée bâtisse, les architectes avaient mouillé le maillot, c’était élégant, mais sobre, sans fioriture, mais monumental. Trois étoiles l’hôtel de police, j’ai trouvé. Et les policiers pas mal, armures–revolver–grenades, une petite douzaine, les gens rassemblés là criant Libérez nos camarades et puis des malins Regardez celui qu’a une belle moustache hé matez-moi la belle moustache, alors slogan : ça c’est d’la moustache ça c’est d’la moustache ça c’est d’la moustache.
Je ne trouvais pas le slogan top, moi, je n’avais qu’un rêve c’était de plutôt crier La moustache avec nous La moustache avec nous et que le gars bel homme soit convaincu et rompe les rangs et nous rejoigne et me prenne dans les bras cybernétiques de son armure robot et m’emmène sur une île grecque, tranquilles, tous les deux en amoureux le moustachu et moi, là sur l’île au milieu des maisons blanches des Grecs et au milieu des pâtres grecs je lui dévore la moustache d’un coup de crocs secs à mon flic et on n’en parle plus, ça l’anéantit car sa moustache c’est comme pour Samson, je reviens, n’ai plus mal au ventre, les camarades sont libérés, sortent du commissariat trois étoiles sous les vivats, pour une fois j’ai fait quelque chose d’utile à la cause, au mouvement.
Mon bide gargouille sa plainte de bête blessée.
Ne pensais plus aux flics, toute à mon bide, toute à la Grèce, mais voilà, ils se casquent, mais voilà la BAC est arrivée, têtes des mecs de la BAC, têtes de types qui n’attendaient qu’une chose c’est d’avoir les ordres et ils les ont eus, avec du renfort – en plus de la BAC et des CRS : les maîtres-chiens, sortons les chiens, la race canine est nécessaire.
Oui nous avions besoin de la race canine, sinon on n’aurait pas compris.
Que la race canine nous aboie dessus : là on comprend mieux.
On le sent, les CRS et la BAC vont nous charger, malgré tous leurs efforts et leur déploiement discipliné menaçant on n’a pas encore compris qu’il faut partir, se disperser, on voulait pas, on restait là alors qu’il fallait y aller, qu’est-ce qu’on était stupides nous les manifestants de soutien aux manifestants interpellés à cause du mouvement, c’était pas dieu possible d’être pareillement stupides, on était vraiment idiots, ils vont charger.
Les chiens se tendent.
Les maîtres-chiens retiennent les chiens.
Les chiens aboient.
Les CRS et la BAC chargent. Interpellation d’un camarade – moi je ne vois rien je suis derrière un arbre, je pense à Boyau crispe crispation comprime compression resserre – je resserre, tout est fini, le camarade pris, relâché deux minutes plus tard, donc tant mieux, donc pourquoi, et tergiversation, qu’est-ce qu’on fait, est-ce qu’on reste ou est-ce qu’on reste pas nous les manifestants de soutien.
Ne pense qu’à mon bide, n’en peux plus, fuis, pars en direction du tramway, sur un miracle je trouve une chose-restaurant-snack nommée Worldburger, j’entre, demande Un burger les toilettes ? à la fille du comptoir, file aux toilettes, me défais, suis sur le trône, pense Soulagement, pense Solitude, pense Seule – Seule enfin Seule avec mon ventre.
Avant tout ça.
Avant le mouvement : Marthe me tend un petit pois.
–– Qu’est-ce que c’est que cette merde de petit pois ?
Elle sourit, se met le petit pois sur la langue.
Une grosse langue bien foncée elle a Marthe : avec ce petit furoncle vert au bout.
Elle sort de sa poche une boîte en fer pleine de petits pois, m’en propose un autre.
–– J’en veux pas.
–– T’as peur de la drogue.
Je regarde sa chose verte en train de fondre sur sa langue qu’elle continue de tirer dans un effort honnêtement dérisoire pour me faire envie avec son approximation de petit pois.
–– J’en veux pas.
Elle insiste.
–– J’ai pas besoin de drogue.
Elle insiste encore.
–– J’ai déjà ma maladie.
Marthe avale. Quelque chose se passe dans ses yeux juste après pour montrer que ça lui fait de l’effet les petit pois, boum, elle mange un petit pois et tout de suite sent mieux les courants ondulatoires de la musique et n’a plus faim et se trouve en pleine forme et capacité de brûler la piste et liquéfier les danseurs et baiser avec le premier venu qui sera sûrement quasi le même premier venu que la dernière fois puisqu’on va toujours dans la même boîte de nuit excrémentielle.
–– Depuis quand t’as une maladie Lola ?
–– J’ai toujours eu une maladie.
La maladie dans ma tête.
Tu sais bien.
Je t’ai expliqué.
Marthe a repéré un nouveau venu à l’air fraîchement débarqué, c’est bon, c’est pas le nouveau venu de la semaine dernière, c’est un autre, avec un autre corps une autre odeur, avec un autre chibre il faut le dire c’est ça qui intéresse aussi Marthe, le chibre, le cœur, l’os, l’os du cœur, l’os du chibre, le chibre du cœur planté jusqu’à l’os, voilà pour quoi elle roule Marthe, c’est à peu près tout, l’ivresse.
Comme moi avec cette fille il y a longtemps : c’est une fille, elle pue la buée, l’animal marin tentaculé, corps entortillé dans son maillot de bain une pièce, c’est le vestiaire de la piscine, tout petits carreaux blancs à terre. Elle entre. Porte misérable du vestiaire, une planche de bois fine quoi, c’est-à-n’y pas croire, et les verrous alors, et alors les verrous c’est du luxe ? je suis nue moi à l’intérieur et cette fille tentaculée me veut, je crois qu’elle me veut, elle entre en tout cas dans le box, la buée fétide sur ses épaules, fumante, cette fille m’aura, elle sait déjà qu’elle m’aura. D’avance elle est entrée. Elle a su dans la minceur de la porte qu’elle entrerait et que je ne dirai pas mot ni souffle ni mon nom mais qu’elle m’aurait, elle lève un tentacule, dans le creux essentiel primitif du tentacule, dans sa ventouse essentielle primitive se dessine un losange de poils frisés et blonds vaporeux je baisse la tête, j’y vais, suis partie pour quelque-chose, je plonge dans la nasse, pressée par une main mécanique de l’ordre de la grue intérieure qui me pousse contre, tout se restreint, elle m’enserre la fille. Je ploie. On me courbe.
M’accroupis, elle s’étend, ses cuisses sont une robe octopédique, me noircissent, asphyxient la lumière, les carreaux me montent à la tête, on frappe autour – c’est une piscine municipale – il y a des enfants – des fillettes – bon certes – mais moi j’étouffe et halète – moi je suis dans le plein de la vague – c’toute une histoire dans ma bouche – y a tout un kilogue de lèvres bien fraîches, tout juste abattues à la chasse, dans ma bouche, qui palpite, pour le plaisir, en soubresauts.
Des années après ça Marthe et moi sortons de la boîte de nuit excrémentielle dans laquelle nous allons toujours, qui est notre prison nocturne inévitable, Marthe toujours intoxiquée au petit pois, ses yeux humides qui braient de larges rayons sexuels en tous sens, le premier venu est heureux, il a dû se faire vider sévère, il nous dit à bientôt, il espère qu’on se reverra, voudrait survivre à sa première fois, revenir premier venu, ignore qu’il échouera, on ne se réinvente pas, il n’y a que certains organes, à l’intérieur, qui se réinventent, certains bouts de l’œil je crois, l’estomac plusieurs fois dans la vie, bon et des tonnes de cellules, mais nous non, nous restons soit premier soit deuxième soit troisième venu, déplacé d’un cran chaque fois, c’est ainsi mon pauvre, il faut s’y faire, Marthe ne te videra plus, il y en aura d’autres des filles, mais qui te videront moins bien, tu regretteras.
La nuit. Grand-chose obscur pâle, brouillé de néons, l’eau roulante sous les ponts, les conducteurs des heures ivres zigzaguant tant bien qu’ils peuvent sur les artères creuses, la vie du monde arrêtée ou très ralentie comme on dit d’un enfant qu’il est ralenti pour ne pas dire Il est sot, c’est l’idiot du village.
Marthe marche avec moi. Je suis fière.
Je suis fière d’être avec Marthe qui marche avec moi, qui marche comme on danse, avec des déhanchements qui sont les déhanchements d’une femme qui a des hanches et sait s’en servir, sait comment tourne un corps de femme, rondement, pas à ma manière de sac d’os cliquetant, mais rondement, elle marche comme on tourne.
Est-ce que Marthe est fière aussi ? D’être avec le sac d’os cliquetant ? Est-ce qu’elle est fière d’être Marthe qui marche avec le sac d’os Lola qui ne sait marcher que rectangulairement, en cliquetant ?
C’est dur à dire. Y-faudrait ouvrir Marthe. Aller mettre la main au centre de la gorge, là où la fierté vibre. Alors on verrait ce qu’il y a à voir ; mais de là, d’où je suis, de par-derrière le corps de Marthe ce qu’on aperçoit c’est la jeune femme au petit pois, gaie, changeante, ce qu’elle veut être.
C’est ce que voient les types. Les faux types qui nous accostent, aimantés par Marthe comme par un pôle soudain, faux types qui sont la limaille de fer de la vie de Marthe, toujours à elle collés, électromagnétisés même de loin, déboulant pour elle, pour ses beaux yeux, sa gorge roulante, ses cuisses rondement menées.
Marthe qui soupire, malgré le petit pois, la chaleur du petit pois, car vingt fois par jour, cent fois par nuit, la bête mâle accourt, suante, pour la renifler, se mettre tout contre – et moi, identiquement fatiguée, de gueuler, sac d’os qui cliquète et aboie, aboiements de fémur et radius, craquant comme les bois déchirés par la foudre, moi qui hurle sur les hommes, les couvre de cris, pour qui ils se prennent, pour qui ils nous prennent, qu’ils ne nous sifflent pas, ces petites déjections, qu’ils ne nous parlent pas de cette façon, pas avec leurs mains poisseuses qui luisent sous les néons obscurs pâles de la nuit grand-chose, qu’ils ne nous insultent encore guère moins, surtout pas Marthe de bouche de suceuse à pipe, surtout pas moi de planche à pain à découper, qu’ils ne parlent pas de nous violer, même pour rigoler, parce qu’ils sont cinq et nous deux dans un coin sombre, d’autant qu’il y a des plaisanteries qui sont la préparation de choses sérieuses, ternes, sans quoi ils verront, un des faux types s’approche, il est balaise, il demande Qu’est-ce qu’on verra ? et je réponds On verra ça.
Lui balance mon genou tel un pieu à l’endroit de son siège viril, il ne comprend pas tout de suite, d’abord il fait un o avec sa bouche sans parvenir à dire vraiment o, ensuite il a mal, la respiration coupée comme s’il respirait par là justement, par le siège viril, ce qui n’est pas impossible, pourquoi pas, on a vu pire, un de ses copains passe devant lui et me met une tarte, main ouverte, une bonne tarte, pareille qu’en donnaient les papas aux mamans dans le temps quand elles comprenaient pas, il ne maîtrise pas sa force, n’a pas réalisé mon poids faible, je vole en éclats, fais un bond en arrière, projetée, ma tête rebondit salement contre une automobile à essence ou diesel derrière, sans enfoncer la vitre étonnamment, j’ai tellement mal, suis tellement sonnée que je glisse comme une chiffe le long de la carrosserie d’après Marthe qui va m’en parler et reparler jusqu’à ce que j’en aie marre de cette histoire, c’est assez beau à voir, on dirait un film, elle a cru que j’allais mourir, on aurait dû tracer dira-t-elle, courir on aurait dû courir directement, mais il n’y a pas moyen, moi je ne cours pas, moi je m’effondre à moitié évanouie sur le capot des bagnoles, ça vaut encore mieux.
C’est un autre jour pour le mouvement.
Il pleut froidement et dru, en tout ils sont une vingtaine, dix de chaque, dix CRS et dix de la BAC, gueules tirées, raides comme une branche de haine, nous à ce moment-là entre cinquante et cent, bientôt moins, et les CRS blang blang blang se mettent à frapper sur leur bouclier comme au temps des Romains, à sonner la charge, à côté de moi un type crie Ils chargent, panique dans les cordes de la voix, je lui dis Tiens bien la banderole, autour de moi, hors lui, que des filles, petites, cagoulées, en noir imperméable, que des filles à se faire charger sous la pluie froide et drue, les CRS ne courent pas si vite que ça mais ça fait peur, puis le choc, plusieurs filles aussitôt fauchées, la banderole pourtant tient, ce qui enrage, ils donnent des coups sur les mains, mais quoi, ces matraques sont molles, nous on tient, insectes tout en nerfs, globules résistants sous la pluie, femmes encagoulées, en voiles de révolte, décidées à ne pas baisser la main sous la matraque, à ne rien retirer, les matraques molles de toute façon, les tonfas mous, puis les claquements des bâtons télescopiques de la BAC, cinglants, fouets de métal, qui lacèrent, et la poussée, les filles qui se font débarouler, tombent, à terre écrasées, la banderole qui se dégonfle, s’aplatit comme un ballon crevé, le type à côté de moi tombe, j’essaie de le relever mais il est trop lourd, je lâche sa main, un baqueux lui marche dessus quoi qu’il en soit, rien à faire, puis un chef CRS, je l’ai vu à toutes les manifs, c’est un chef, c’est un gros chef, très grand, corps difforme, veut me filer un coup de pied dans le genou, j’esquive avant de me prendre un fouetté télescopique dans l’épaule, je me retourne, fuis, cours, et là on s’en donne à corps joie, par derrière un chassé dans les jambes, je m’étale, dans le dos plusieurs coups de fouet télescope, se relever, pas d’interpellation, se relever malgré les mains, les jambes gravillonnées, se relever croûte que croûte, je me relève, personne ne m’en empêche, dieu sait pourquoi car il sait tout, je me relève et j’essaie de grimper sur une auto coincée là, le conducteur ahuri, les mains bien campées sur le volant, au cas où, qui regarde son auto grimpée, je glisse, atterris sur le flanc, aiguë douleur, m’échappe enfin, cours sous la pluie, drue et froide, heureusement que j’avais mon petit k-way noir.
De toute façon il faudrait bien qu’on soit par le monde cassées, mais bien, mais comme il faut, hein, pas n’importe comment, qu’on soit pas cassées à moitié mais cassées de chez brisées en mille, ou alors qu’on le casse le monde pour de vrai : que toute la machine en prenne un coup de ces coups dont on ne se relève pas, de ces coups filés pour le knock-out, le coma, la tête qui rebondit sans vie, la nuque qui ne suit pas, le coma. Qu’on ne fasse pas semblant quoi, qu’on ne se bouche pas les yeux, les oreilles et les dents avec la cire fécale dont nos parents et avant eux les parents de nos parents s’étaient clos et oints, surtout côté Leibowitz, qu’on ne fasse pas semblant et qu’on voie bien enfin ce que c’est que le capital : le fluide mort vivant, la gelée autour des tubes, des oreilles, des valves du cœur, le feu mauvais des banques – qu’on ne chique pas à s’en sortir indemne malgré tout, qu’on ne chique pas à passer entre les gouttes de la monnaie, de l’or qui vous fige le sang vrai en boudin laqué.
Oué oué oué oué, me disais-je, me répétais-je, attention-les-yeux, faut-pas-croire, on-n’est-pas-là-pour, et d’ailleurs c’est la colle du monde qui va pas être contente, tellement qu’on va lui chier dedans, on sera pas du genre à casser une banque et à retirer nos biffetons le lendemain, nous, on sera pas des rombières plus tard aux yeux gris fibre de fer oh non, on ira tout de go ou on ira dans le mur, c’est-à-voir, et on verra.
Je croise mon frère. Un Sapin comme moi : mais le fil est rompu.
Il est avec sa femme – une grande fille, ils se connaissent depuis la maternelle, je suppose qu’il avait besoin d’elle pour un truc, pour faire ses découpages, il n’y arrivait pas, il voit cette fille, il lui demande, c’est elle, ils ne se quitteront plus.
Sa femme qui est un genre de fragment.
De roche glacée inentamable, très belle, environ six lieues au-dessus du crâne de mon frère dans tout ce qui est race et distinction, elle reste avec lui par un mystère qui tient sans doute à sa nature météoritique, je la soupçonne de venir d’ailleurs comme la vie, la vie ne vient pas de nulle part, la vie vient d’ailleurs, il y a du foutre dans l’univers, voilà voilà, il y a du foutre noire partout dans le cosmos et ce foutre fut giclée horizontalement et verticalement aux quatre coins cosmologiques, voilà ce qui s’est passé, toute la vérité : des gouttes de foutre sont arrivées balistiquement un jour sur notre belle planète et poum ! c’est la vie des plantes, c’est la vie des organismes unicellulaires, c’est la vie des animaux.
Et la femme de mon frère fait partie c’est sûr des filles-gouttes de sperme cosmique catapultées pour la fécondation de la Terre ; seulement elle est arrivée en retard. Très en retard. Elle a percé la couche atmosphérique des mille et des mille et des mille de temps après qu’il fallait, la vie humaine était déjà implantée, tout fabriqué depuis belle heurette, n’y-avait plus rien à faire, ce qui pouvait se tenter à la rigueur c’est de rebondir vers une autre planète, mais la femme de mon frère n’a plus d’élan, par fatigue elle s’accroche à la première chose humaine rencontrée : mon frère – qui évidemment ne se doute de rien, le sombre, le très obscur débile – qui n’y voit que dalle quand tout est devant ses orbites, en permanence, quand tout est là dans la créature qu’il appelle sa femme – mon frère, par une cécité magique, ignorant tout à fait l’éclat ultra-stellaire, la supériorité astrale de la femme qu’il dit la sienne.
Mon frère et moi causons deux minutes du mouvement. Il s’y intéresse de loin. C’est bien ce mouvement dit-il de la façon la plus fraternelle et condescendante possible. J’ai envie de lui dire que c’est un chien, un collaborateur ignoble, mais je me retiens, me mords les lèvres. Je préfère encore Marthe, qui nous trouve franchement ridicules, à mon frère qui fait semblant de nous admirer.
Ce n’est pas faute d’ailleurs d’avoir essayé d’éduquer Marthe.
Petite, mes seins à peine sortis, prototypes encore (environ l’époque de la fille aux tentacules de la piscine municipale), quand je venais chez Marthe : sa mère nous préparait un goûter, nous avions passé l’âge où les mères préparent le goûter, elle le préparait tout de même, ça lui faisait plaisir, la télévision, toujours allumée chez Marthe, crachait son règne de fausseté.
Or je gueulais : ne laissais rien passer.
Salauds, salauds, je disais.
Salauds de la pub, salauds des informations, salauds des fictions télévisuelles, des séries télévisuelles, je vomissais tout ce monde télévisé faux, j’expliquais chaque truc, chaque technique, je voyais tout, je disais ces gens-là sont payés pour mentir et manipuler, ils n’ont aucune morale, ce sont des salauds payés à dresser les ouvriers contre les non-ouvriers les grévistes contre les non-grévistes, les petits salariés contre les moyens salariés, les pauvres contre les demi-pauvres, voilà à quoi servait ces chiens-là, on leur voyait d’ailleurs très bien la laisse et le collier, la laisse en forme de cravate, le collier en forme de maquillage à joues roses et de gel dans les cheveux, il ne leur manquait plus que d’aboyer et c’est d’ailleurs ce qu’ils faisaient.
Je gueulais et la mère de Marthe disait mais qu’est-ce qu’elle a à s’énerver comme ça cette petite c’est à cause de tes parents c’est tes parents qui te racontent toutes ces choses et je disais non, ce n’est sûrement pas mes parents, je suis autodidacte de la haine politique, de la haine des riches. J’apprends toute seule avec chaque journée passée dans le monde.
Même ça me faisait ricaner qu’on puisse s’imaginer que je sois l’enfant, le produit de mes parents sur ce plan de la haine, de la véhémence, de la détestation, car bon les Leibowitz étaient ce qu’ils étaient, toute la politique des Leibowitz consistaient à se tenir le plus au centre possible, le plus loin du bord, dans l’espoir de ne provoquer jamais aucune vague ni onde ni commencement de ride à la surface des choses, considérant qu’ils s’étaient suffisamment fait brûler au cours de l’histoire, que s’ils pouvaient rester à l’écart c’était aussi bien, donc je ricanais, ma haine n’était sûrement pas Leibowitz, pour les Leibowitz tout allait très bien, le monde était le monde, le monde brûlait et avait toujours brûlé mais tant qu’on nous brûlait pas nous ça allait.
Alors les Sapin, ça pouvait venir des Sapin mais les Sapin ne parlaient pas, ni le grand-père, ni la grand-mère qui avaient pourtant eu des problèmes avec les gendarmes, au temps des mines, des grandes révoltes. On ne savait pas ce que les Sapin pensaient, c’était connu, peut-être mon père bouillait-il dans l’obscurité de ses veines, le sang fumant, attendant le moment, le jour où, peut-être qu’il serait là sans un mot, le jour venu où tous les pauvres et les demi-pauvres se soulèveraient, – ou qu’il serait nulle part, on ne pouvait pas savoir, c’était un renfermé.
Une autre fois la télévision chez Marthe m’avait tellement donné envie de vomir le monde que j’avais fait un bond jusqu’à l’appareil, en avait arraché les câbles, mes seins étaient encore deux petits bourgeons noirs (aréoles très brunes) et fermés – tubercules ramassés, graines dures et sèches, infertiles, ça ne voulait pas sortir, tandis que ceux de Marthe étaient déjà de vrais seins blancs laitiers luisant de laitance, animaux, je m’étais retournée piteuse vers Marthe, vers la mère de Marthe, je m’étais excusée, la mère de Marthe s’était demandé si j’avais de la température, avait posé le dos de sa main contre mon front, m’avait dit Tu es brûlante, m’avait donné quelque chose contre la fièvre, j’avais faim, la mère de Marthe nous avait donné du pain et du fromage, Marthe picorait, je me coupais de larges tranches et je mangeais les croûtes que laissait Marthe et la mère de Marthe se demandait si on me nourrissait bien à la maison. J’aurais pu la rassurer. On me nourrissait très bien. Je mangeais tout, n’importe quoi et la faim restait et je restais sèche comme un os et mon front brûlait en permanence.
Plus tard, à l’époque où mouvement prenait de l’ampleur, c’est-à-dire à présent, la télé n’a pas changé, sinon en pire, prédisant jour après jour la fin du mouvement, le mouvement s’essouffle ou bien il va s’essouffler. Dès la naissance signes d’essoufflement. Le nouveau-né est asthmatique. Il crie mais vous allez voir, dans un instant il ne crie plus, silence de mort dans la chambre, regard hanté de mort de la mère, poitrine, thorax qui ne gonflent pas. S’il y a plus de gens qui sortent dans la rue tout de même, toujours plus, chaque semaine, si les manifestations grossissent malgré la télévision c’est un leurre, on ne s’y trompe pas, en réalité le mouvement s’affaiblit, stagne, c’est fini, ou presque, ou ça va finir quoi, un moment, s’agit pas non plus d’être impatient, juste de savoir que c’est voué, encore un petit effort madame, le bébé est quasi bleu, donc faire partie du mouvement, vouloir faire partie du mouvement, c’est pour la télé refuser le monde réel, refuser la vie dans le monde, c’est s’agiter dans un cadavre. On n’agit pas quand on agit. Rien n’existe sinon ce qui est dit par le présentateur. Si jamais il se passe quand même quelque chose qui n’a pas été dit, la télévision et à sa suite les journaux et la presse nient en bloc. Expliquent que rien ne s’est passé. Ou inventent autre chose. Par exemple : les manifestants sont armés. Les manifestants attaquent les vitrines des petits commerçants honnêtes. La police n’a rien demandé. Et d’ailleurs ce ne sont pas des manifestants. Mais des briseurs. Ils sont là pour briser. Ces briseurs sont là uniquement pour les bris, les éclats, les fragments. Les autres manifestants sincères et loyaux les conspuent, s’écrient Halte aux briseurs. Les briseurs ternissent l’image du mouvement, car le mouvement a une image. Les manifestants honnêtes et normaux n’aiment pas les briseurs car les briseurs leur volent le mouvement. C’est tellement dit par le présentateur que ça en devient vrai, à force de les dire les choses deviennent vraies, elles se passent.
Il y a pourtant des choses qui se passent malgré le présentateur, contre lui, des choses qui n’ont pas été présentées à l’avance et que les gens voient tout de même. C’est ça qui est compliqué. Il y a des manifestants qui aiment les briseurs, qui défendent les briseurs, qui acclament les briseurs quand les briseurs brisent la vitrine d’un honnête commerçant qui a sué toute sa vie à la sueur de son front pour gagner le pain qui est le pain de sa vie. Car ce commerçant est aussi une banque avec des choses fiscales au Panama. Suivant qui la voit la banque se change en petit commerçant, c’est une illusion d’optique, ça dépend de l’angle. Un peu plus à droite : banque. Un peu plus à gauche : commerçant laborieux. C’est trompe-l’œil : faut-savoir se placer.
Puis moi, qu’est-ce que j’y fiche, c’est à n’y pas savoir, dans un mouvement on n’est jamais qu’une petite goutte qui suit le flux, on n’a pas l’impression de s’exprimer, on ne sait pas si on est soi, moi je suis là, bon, il y a des tas d’autres gens avec, bon, mais rien ne garantit que je sois mieux avec ces gens qu’avec n’importe qui d’autre, on a une chose à faire ensemble, voilà tout, on se côtoie parce qu’on veut bien se côtoyer, pas beaucoup de filles de la périphérie dans le mouvement, surtout des filles comme moi du centre, tout ça c’est une histoire de force, centrifuge, centripète, je sais plus, ou ni l’une ni l’autre, l’inertie, rien de ce qui est au centre ne va dehors, rien de ce qui est dehors ne va au centre, heureusement le pouvoir nous traite de plus en plus pareilles, je veux dire nous frappe pareilles, quand on a été bien frappées on sait mieux, on se rend mieux compte, on est rassemblées par les coups, on peut s’imaginer du centre à la périphérie, c’est l’égalité des chances grâce à la compagnie républicaine de sécurité.
À l’époque de ma grand-mère Sapin (c’était une autre époque), c’était pas des femmes comme moi, comme Marthe, c’était des femmes qui savaient vivre. Pendant les grèves de la mine elles y allaient, elles cognaient sur les CRS. Ces femmes-là elles étaient pas comme les filles d’aujourd’hui qui savent pas vivre, qui sont là perchées sur leur cigarette, le bout du doigt toujours prêt à toucher une surface tactile. Elles se cachaient pas le visage derrière des cagoules ou écharpes. Elles y allaient à découvert mais il faut dire que c’était une autre époque, pas de caméras, drones, hélicoptères, on pouvait y aller.
Elles étaient jamais malades ces filles-là : pas le temps pour ça : guéries d’avance. C’était des femmes du Nord glacial, du Nord sauvage, elles vivaient toutes leur vie dans le Nord, elles y mouraient aussi et n’auraient pas vu où ailleurs mourir. C’était des femmes sauvages et glaciales comme leur pays. Ma grand-mère avait des cals d’un bon centimètre d’épaisseur haut la main à force de couper des bûches. Souvent la lame de la hache partait en arrière et cassait une tuile ou crevait un nuage.
C’est vous dire si ma grand-mère était forte : la lame partait droit vers les ciels parce que mon grand-père Sapin avait encore oublié de serrer le fer sur le bois. Il se faisait engueuler, je peux vous dire qu’il se faisait engueuler.
Mon grand-père Sapin aurait dû être un artiste, c’était le genre d’homme à ne pas penser aux choses, à ne pas serrer le fer sur le bois, il aurait dû mourir cordon sur la gorge dès le début avec un sang rose et faible dans la bouche comme un artiste. Pendant les émeutes tandis que ma grand-mère cognait il restait derrière, dans le gros de la foule.
Pourtant c’est lui qu’on avait privé de mine. Il avait perdu le droit de travailler après les émeutes, on l’avait repéré, signalé comme un meneur, un beau parleur, lui qui ne parlait jamais.
De toute façon ce n’était pas un bon mineur. Si la grève ne lui avait pas fait quitter la mine il en serait sorti les pieds devant à trente ans, poumons silicosés, cœur noir. Il valait mieux qu’il pêche.
La grand-mère Sapin avait continué d’y travailler de nuit à la mine et le jour elle dormait peu et s’occupait de la maison. La grand-mère avait travaillé jusqu’au bout des mines avec une santé de fer, rien ne pouvait atteindre sa santé de fer, pas même le charbon.
Mon père lui n’a pas hérité du sang de son père, ce n’est pas un artiste. Mon père a repris le sang de sa mère et c’est le sang de sa mère qu’il m’a transmis, le sang avec lequel elle coupait les bûches et envoyait le fer de la hache dans les ciels et cognait sur les CRS pendant les grandes grèves de la mine.
J’ai ce sang qui me coule dans les veines, moi, le sang des filles Sapin. C’est du bon sang sombre. Mais le bon sang ne fait pas tout, je sais bien, faut-aussi le faire couler droit.
Mon frère n’a pas ce sang-là. S’il a du sang de Sapin c’est celui du grand-père : un sang tout fluide, clairet, une eau de rosée, un sang d’artiste. Ou alors il n’a que du sang Leibowitz : cette espèce de sueur de navet que les Leibowitz appellent leur sang.
Marthe est donc une réactionnaire, il y en a tant, elle est contre le mouvement, ce qu’elle veut c’est onduler, être vue et reniflée, avoir sa dose journalière de désir et puis voilà tout. Au fond ce qu’il faut en dire de Marthe c’est que c’est une paysanne, elle est faite pour des sabots, une robe de lin blanc, un ceinturon rouge comme le rouge des roses grimpantes, les mains dans la terre, se faire féconder le soir, rien de plus, elle serait parfaite.
Si elle reste avec moi, à la ville, si je reste avec elle, si l’on est gluées l’une l’autre, c’est en raison d’un malentendu, la colle un jour se détachera, et avec elle les tournures, l’esprit que nous avions en commun, ce sera comme de perdre deux bras, deux jambes, une tête, une vingtaine d’ongles, possible qu’on ne s’en relève pas, c’est sans doute Marthe qui amènera ce tranchage, c’est Marthe qui signalera la fin, c’est elle qui sait où m’arrêter, pour moi je la suivrais où qu’elle aille, vivrais avec elle quoi qu’elle vive, je m’habillerais de sa peau, me chaufferais du feu de ses nerfs, mettrais mes pas gauches dans les siens gracieux – elle finira par en épouser un, bon, c’est ainsi, je me ferai discrète, au moins au début, jusqu’à tant qu’il ne me voie plus, ne se rende plus compte, que je ne sois pour lui rien d’autre que l’ombre de Marthe, ce que je suis bien, en définitive, si on considère la chose du point de vue de l’optique, du spectre lumineux, mais alors une fois oubliée de lui je m’introduirai dans leur couche, me disposerai entre elle et lui comme on place une lame entre deux amants, pour sûr je serai cette lame.
Marthe ne l’autorisera pas, elle n’autorisera pas que je sois lame, mauvaise conscience de son désir d’être avec un homme non pour être avec un homme mais par goût du clonage, de la famille, de la division cellulaire, elle emploiera n’importe quel anti-adhésif, la haine vorace, le ressentiment pointu, la très basse méchanceté pour aboutir à mon éloignement, elle le fera, je sais qu’elle le fera, je redoute toujours qu’elle le fasse.
Or ça vient plus tôt que je ne pensais, Marthe n’a pas encore trouvé l’homme de sa reproduction mais au détour de n’importe quelle cigarette inexplicablement elle le fait, dit qu’elle ne peut plus, qu’il faut qu’elle prenne des vacances de moi, comme si une autre personne, la voir, lui parler, était un travail, il faut qu’elle prenne des vacances de moi, elle a dans la langue le goût d’acier des ruptures qui est un venin conservé dans des glandes secrètes glacées, qui lui monte à la gorge, dans les crocs, et qu’elle m’injecte, Lola tu m’empêches de respirer prétend-elle, ce qui est faux, je ne l’empêche pas, c’est vrai que je vérifie toujours de quel oxygène elle se nourrit, c’est vrai que je respire avant elle l’air qu’elle respire pour ne pas qu’elle s’empoisonne, c’est vrai et ça ne veut rien dire, Enfin je te laisse dit-elle, il n’y a pas forcément grand-chose à expliquer, puis ça ne nous empêchera pas de se voir dit-elle – tout se passe comme dans une rupture à l’amiable entre deux personnes qui comprennent, à aucun moment Marthe ne fait mine de comprendre que je ne comprends pas, elle me laisse comme ça comme une vieille chaussette de peau en forme de fille, je reste sur le trottoir, non sans l’avoir taxée d’une dernière fin de cigarette que je ne fume pas pour la fumée mais pour le goût de son rouge, de ses lèvres.
Mon père : sa grosse tête d’homme venu du Nord, ses yeux chinois, les sourcils noirs pareils au bois noir, c’est un souvenir, je suis petite, j’ai eu une mauvaise note, il explique :
– A ton âge Lola je n’étais déjà plus à l’école.
Je sais bien que c’est grave. Même si je concocte en permanence, dans l’arrière-fond du paysage de mon crâne, des plans cérébraux pour éradiquer chimiquement le collège, ou par une bombe le pulvériser, et avec lui les garçons, les filles de mon âge, qui ne comprennent rien à pas grand-chose, et les professeurs qui ont l’épaisseur des fantômes et la stupidité des rats, des cancrelats, des insectes, des puces, qui comme des puces bondissent au moindre rien, uniquement pour hurler qu’on n’est pas assez bons, qu’on ne réussira jamais, qu’on finira coiffeuse et caissière de supermarché et au chômage, malgré tout je sais que c’est grave, ce que veut dire mon père.
La question aussi c’est ce qu’il faisait s’il n’allait pas à l’école. Où il allait. Est-ce qu’il allait pêcher, est-ce qu’il errait dans les bois, est-ce qu’il restait chez lui, est-ce qu’on l’enfermait, est-ce qu’il était prisonnier, puni, en cage, c’est la question.
– J’étais apprenti. Dans une usine. J’apprenais mon métier.
– Alors tu comprends Lola, c’est une chance d’aller à l’école, de faire des études comme ta mère, c’est une grande chance, il ne faut pas la gâcher bêtement.
– Ce treize, bon, je suppose que ça peut arriver, mais en histoire, tout de même, l’histoire n’est pas une matière difficile, il suffit d’apprendre par cœur. Tu dois être dans les premières, la première. Moi j’ai été reçu premier au certificat d’étude.
– J’ai été reçu premier mais je n’avais pas la chance que tu as. J’étais premier mais sans la chance, ça ne sert à rien. Il faut être premier et avoir une chance, et la saisir. Tu comprends Lola. Rien n’est facile. Rien ne te tombe tout cuit dans les mains. Chaque repas il faut le payer.
– Le manque de chance Lola, c’est que mes parents n’avaient pas une très bonne situation dans la vie, ils subsistaient, mon père travaillait mal, il se faisait souvent renvoyer, ma mère travaillait pour deux mais ça suffisait tout juste, les femmes n’étaient pas bien payées.
– C’est pour te dire, Lola, qu’il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il ne faut pas être léger mais rester sérieux. Très sérieux. Un huit en histoire, ce n’est pas très sérieux, il faut plus, beaucoup plus.
Je suis petite, c’est un souvenir, mais je crois que je comprends : l’école c’est important, il faut être la première, il faut arrêter de penser à des bombes, à faire tout exploser, à la fumée qui tourbillonne sur les ruines du collège, aux professeurs gris, asphyxiés par le gaz de mon invention, il ne faut pas penser à ça, il faut réviser sa leçon, être meilleure à la prochaine, rester concentrée.
Elles ne plaisantaient pas les filles comme ma grand-mère Sapin, les filles du Nord, elles étaient dures au mal, on ne les voyait pas se plaindre si d’aventure elles se blessaient avec le fer d’une hache, la lame d’un couteau, ça saignait, bon, un sang lourd surgissait de la plaie dont les lèvres ne demandaient qu’une chose, se refermer, ce qu’aussi sec elles faisaient, les lèvres, bientôt closes, bientôt trait qu’une croûte solide recouvre, les filles du Nord ne plaisantaient pas, on les voyaient assez rarement rire, si ma grand-mère riait c’était un événement, comme le rire d’un cheval prisonnier d’une machine, d’un cheval qu’on ne laisse sortir de sa carapace mécanique qu’une fois l’an, le temps d’un bref, d’un obscur hennissement, c’était le rire, le passage du rire de l’animal de fer, et puis plus rien, pas un sourire pendant des semaines, mais une même grimace de concentration, le bois fendu, les muscles féminins qui saillent, le dos rond de muscles féminins.
C’était d’une orpheline : les orphelines rient peu et si elles rient c’est tels des animaux enfermés dans des machines ; ma grand-mère avait connu l’orphelinat, tout comme mon grand-père ; ils s’y étaient rencontrés, connus, étaient tombés l’un de l’autre amoureux dans ce grand orphelinat du Nord, les murs étaient froids, il fallait sans cesse souffler sur ses doigts pour qu’ils ne bleuissent pas.
Ma grand-mère Sapin s’appelait Sapin avant d’épouser mon grand-père, elle était deux fois Sapin, cela se comprenait qu’elle fût ligneuse, pleine d’écorce, après le mariage elle devint Sapin épouse Sapin, mais tout s’explique : la dame de l’orphelinat avait la mémoire un peu courte, le savait, choisissait toujours les mêmes noms pour les enfants à sa charge, de préférence des noms de choses de la vie ordinaire, il y avait beaucoup de petits Pioche, de Manique, de Tison, pas mal de Saint-Doux et de Sapin dans l’institution.
C’est ainsi que les choses se firent : la petite Sapin épousa le petit Sapin ; ce fut ma grand-mère essentiellement qui fit tenir bon le ménage ; mon grand-père ne s’en serait jamais sorti seul dans le Nord sauvage et glacial – ce qu’il aimait lui, c’était la pêche, la pêche était faite pour sa nature : il trempait sa ligne dans l’eau gelée du Nord, patientait, rêvait, mais à quoi, c’est difficile à savoir, j’imagine à tout et à rien, peut-être aux autres mondes, aux mondes qui auraient eu lieu si ce monde-ci n’avait eu lieu, à l’homme qu’il aurait été s’il n’était devenu l’homme qu’il était, puis un poisson gelé du Nord mordait l’hameçon de fer gelé, mon grand-père assommait le poisson sur la berge, contre une pierre, le poisson ruait, palpitait, faisait mine de mourir, se débattait de nouveau, mon grand-père lui cassait définitivement le crâne, lui coupait le jus, y soufflait toute lumière.
Je faisais les courses. J’étais fatiguée du mouvement et des coups. Il fallait que je mange, que je mange beaucoup.
Je croise mon frère accompagné de sa femme.
Ont l’air bien embêtés tous deux. Tous deux bien embêtés de me voir, presque déçus : comme s’ils m’avaient cherchée des semaines et des semaines dans une taïga noire au milieu des roses suant le poison et me trouvaient finalement là, au rayon plats cuisinés, lasagnes bolognaise, hachis parmentier.
Lèvres pincées chacun de leur côté.
– Qu’est-ce que tu fiches Lola demande mon frère.
– Qu’est-ce que…
– Qu’est-ce que tu fiches.
Je lui montre. Alentour, le patelin.
– Néons. Produits de grande consommation. Supermarché, quoi.
Je fais mes courses.
– Mais Lola.
– Tu es nue.
Je creuse le menton, vers mon petit bide : blanc. Je suis nue.
– Ah je dis.
– Ça doit être ma maladie qui revient je dis.
– Ça fait toujours ça quand je suis fatiguée j’explique.
Comme mon frère insiste je rentre avec eux.
Je flotte dans ses habits : les manches de son tee-shirt frôlent mes coudes.
J’observe. Qu’est-ce que c’est d’être chez eux. Comment ils vivent. Ce n’est pas inintéressant.
Ils mangent. Ne se parlent quasiment pas.
La femme de mon frère mange un haricot vert, quasi violet, elle l’a coupé en quatre (quatre parties parfaitement égales), les a considérées un bon moment, non mécontente de leur parfaite égalité, elle regarde en l’air, elle va saisir un des quarts, la fourchette s’approche, s’immobilise, une nouvelle chose en l’air l’a happée, quelque protubérance du plafond, quelque signe, détail, inscription, son regard astral déchiffre le plafond qui est aussi bien une carte des galaxies, une figuration du premier bang !, une mappemonde des mondes parallèles.
Mon frère pendant ce temps : ne fait ni ne dit rien, rumine comme une vache enceinte qui pense à son veau – seulement le veau est une idée qu’il agite dans son bocal, essaie d’amollir entre les deux mâchoires plates de ses méninges. Mon frère n’a peur que d’une chose : qu’elle lui échappe l’idée, si jamais, si pour une fois il tenait la bonne, l’idée pour le roman qu’il doit écrire, le roman que pourtant personne ne lui a demandé d’écrire, en tout cas pas moi, mais qu’il sent qu’il doit écrire, alors, si elle lui échappe, vlam, l’idée, si elle fout le camp sans qu’il ait pu la plaquer comme on plaque au sol un manifestant sauvage dans une manifestation sauvage, avec genou contre nuque, hein, bras dans le dos, hein – s’il ne la plaque contre le papier l’idée, s’il ne l’enduit d’encre l’idée, ne la glue au papier l’idée – ce serait catastrophe, fin des temps, n’y aurait-plus que ruines rongées de végétations folles, luisantes, soleils d’ombre fondant leur masse antimatière dans les mers de lave angoissée et forêts de soufre et de stupeur, plus rien au monde de valable, plus rien qui compte s’il ne parvient pas à l’épingler l’idée, papillon rare, aux quatre coins des ailes.
Pendant tout le repas : silence, pas un mot l’un pour l’autre, c’est à peine s’ils respirent, ils sont perdus, enfoncés ailleurs, je tape du poing sur la table, c’est à peine s’ils sursautent, mon frère se tourne vers moi, me dit qu’il ne comprend pas, je dis que moi pas plus, j’ajoute Dans le fond qui comprend ? l’affaire est complexe, il dit que ce n’est pas de cela qu’il parle, je dis qu’à ce compte-là je ne vois pas de quoi il parle.
– Qu’est-ce que c’est Lola il demande.
Et aussitôt :
– C’est une maladie il affirme.
Mais on n’en saura pas plus.
– Lâchez-moi je crie.
– Vous êtes dangereuse pour vous-même Madame Sapin.
– Lâchez-moi bande de chiens refoulés puant l’abattoir je leur explique.
– On ne peut pas vous lâcher. Si on vous lâche vous allez essayer de vous crever les yeux encore. Avec la fourchette.
Je regarde la fourchette. C’est une blague. C’est une blague de fourchette. Ça va même plus loin : c’est une fourchette qui en tant que telle est une blague sur les fourchettes, une blague sur les objets possibles en forme de fourchette.
– N’y a même pas de sang, de globe oculaire sur cette fourchette je temporise.
– On ne vous lâche pas.
– Vous allez me lâcher car vous savez.
– Arrêtez de vous débattre.
– Vous savez très bien je dis.
– On la met en chambre d’isolement ils se disent entre eux en s’échangeant des regards et force acquiescement et force signes d’entente et force signes de compréhension, par-dessus moi, par-dessus le sommet de mon crâne, parce qu’ils le peuvent, parce qu’ils sont plus grands.
– Jn’m’en fous de votre chambre d’isolement, lâchez-moi je leur propose.
– Ça vous fera du bien la chambre d’isolement. Vous pourrez vous calmer et vous ne vous ferez pas de mal à vous-même, vous ne pourrez pas vous mettre en danger madame Sapin, c’est pour votre propre bien.
– I n’y aura pas de fourchettes ?
Pas de réponse.
Mais je veux savoir si qu’y aura des fourchettes, l’isolement ct’une chose, la solitude élève l’homme, la femme, je veux mon neveu, mais si n’y a pas de fourchettes tout est vain et émasculé, à quoi ça sert la solitude sans fourchettes, sans quoi que rien à se planter le long du corps et à travers pour bien se sentir son corps, pour bien se sentir sa chair, les angles aigus des lames, les pointes autour de la peau profonde, la chaîne des connexions nerveuses, la gaine des nerfs qui remonte zip, comme un éclair jusqu’à l’esprit, la forêt de brume et ronces bleues de l’esprit.
– I n’y aura pas de fourchettes ? je dis très très fort.
– Pas de fourchettes madame Sapin et on va vous contentionner. Vous ne pourrez plus bouger c’est un moment à passer.
Alors là je me marre.
Je dis que je me marre.
Je dis que :
– C’ne m’empêchera de me bouffer le foie.
– Si.
– Jn’me bouffe le foie si je veux.
– Vous ne pourrez pas vous aurez des sangles autour des chevilles et des poignets.
– Jn’me ferai sortir les yeux du crâne sans fourchette avec ma pensée.
– C’est pas possible dit l’infirmier de gauche en serrant la lanière de gauche autour de mon poignet tandis que l’infirmier de droite serre la lanière de droite autour de l’autre poignet qui doit être mon poignet droit et je bande mes muscles et ne suis bientôt qu’un squelette de muscles suant et rageant mais ils les ont bien attachées les lanières les chiens refoulés pas à dire ils connaissent leur métier.
– Jn’vais m’étouffer avec ma propre bave.
– Ça c’est possible, dit l’infirmier de gauche.
Il doit être fatigué. C’est la fin de sa journée de travail je pense en me tordant le cou pour atteindre des dents le cuir plastique d’une lanière. Il va retrouver sa femme et ses enfants. Je comprends qu’il soit fatigué. La salive me baigne la gorge, tout se passe comme j’avais prévu.
Je la tourne la peine d’âme, contentionnée, la tourne et retourne, comme une vieille tumeur à laquelle on s’attache, patate germée d’un germe imbécile, monstrueux, plein d’œdème, bonne pour le pourrissoir, je la tourne et retourne sans parvenir à autre chose que bon, la peine est là, le cœur c’est à peine s’il bat, s’il veut battre encore, et qu’est-ce qu’on fait sans la bonne grosse mécanique, qu’est-ce qu’on fait si on est plus guidé par la grosse pompe, qui envoie, qui récupère, qu’est-ce qu’on fait sans les sas de pression, sans les explosions, sans les jets, sans les reflux ? qu’est-ce qu’on fait s’il faut y aller tout de même, mettre sa jambe nécrosée derrière sa jambe bleue, qu’est-ce qu’on fait quand on a plus que le petit filet, la minime électrique fibrillation pour se soutenir, est-ce qu’on appartient toujours au régime normal, habituel, au monde des choses qui bougent, des objets qui pensent, est-ce qu’on est encore une enfant de la structure, est-ce qu’on joue le jeu, est-ce qu’on boit la tasse, est-ce qu’on avale, est-ce qu’on recrache ? puis la civilisation, qu’est-ce que c’était la bidouille civilisation, qu’est-ce qu’il y avait là-dedans qui n’était pas aussi bien barbare, hoquet, grognement, et qu’est-ce qu’on avait avec les barbus, est-ce qu’on ne voyait pas que l’envers de barbe c’est les forêts de ciseaux, que le ciseau crée la barbe aussi sûrement que la fonction l’organe et la solution le précipité, est-ce qu’on ne comprenait pas le besoin, l’envahissement psychique, la destruction, est-ce que vraiment on ne savait pas à quoi s’attendre, est-ce qu’on n’avait pas vu venir le truc, pour moi j’avais tout prévu, ça, je l’avais bien vu venir Marthe, le temps où elle n’en pourrait plus de moi, j’avais vu venir le mouvement et la fatigue du mouvement, vu venir mon frère et sa femme stellaire, ma mère et son sang de navet, et l’empire qui régit tout, l’empire grand corps-cadavre sans tête, l’empire puissance directionnelle, force de la concentration, fil gluant autour duquel le monde s’agrège, j’avais tout vu venir, j’avais tout prévu.
C’était le top, le fond plus ultra : plonger au cœur du liquide, enfin je n’avais trouvé que ça de mieux, étant fatiguée, dénuée comme j’étais, retourner sans Marthe dans la toujours même boîte de nuit excrémentielle, murs, videurs, verres reflétant les inaltérables jaune rouge néons, engloutir de ces eaux marneuses, épaisses, qui ont noms d’alcools bruns, prendre une bouteille, payer la bouteille, la boire dans le noir, comme un prisonnier lape l’eau des murs de sa cellule dans le noir que trouble à peine le rai perçant la lucarne, dans le noir à peine semé d’une vague lueur, et finir la bouteille, surtout finir la bouteille, et après ça la jeter, la jeter derrière l’épaule à l’aveugle, comme un prisonnier pisse à côté de son seau dans l’obscurité que ne trouble pas le jaune timide, agité de poussières, du jour à travers la lucarne, la jeter et qu’elle retombe, se fracasse sur la piste de danse excrémentielle où de toute façon je ne danse pas, n’ai jamais dansé, car sont réservées ces contorsions vipérines à Marthe ou à des filles ophidiennes de son acabit, ou à des gonzes ophidiens de même calibre, à tout ce peuple nocturne de fausses couleuvres, nées pour le ravin, les fosses et les trous d’eau, quand pour moi à mon habitude je reste dans l’ombre, sous la face cachée de la vie, à l’écart des pistes et des jambes frénétiques, quand pour moi je consomme, sors et ressors ma carte bleue pleine de la sueur de mes jobs vains, de mes jobs d’été devenus d’hiver – ma carte bleue chauffe, elle rougit à blanc, s’évapore la sueur, c’est toujours moi qui me ruine, pour Marthe, pour les filles ophidiennes rien ne se paie, suffit de gigoter, d’agiter ses particules calorifiques et sexuelles et tout vient à vous, boissons et sexes, or la bouteille tombe enfin, se brise en mille bris fragments et éclats, la police n’avait rien demandé mais voilà la bouteille tombe, c’est la gravité, se brise, c’est les ondes de choc, les manifestants loyaux et sincères de la piste de danse s’écrient halte, s’écrient mon dieu, s’écrient c’est elle, elle est folle, elle aurait pu tuer quelqu’un avec sa bouteille lancée, ce qui est faux, je ne suis pas folle, tout au plus suis-je un peu MALADE, à force de les dire les choses deviennent vraie, on devient ce qu’on dit de nous, tout dépend de l’angle, de l’illusion, un grand Noir me saisit par les aisselles, me soulève, il sent bon le parfum d’homme de famille, il m’évacue, je suis dehors, n’avais rien de mieux à faire que d’être dehors, tout bien pesé.
Ma mère est là, c’est la visite, vos parents sont là pour la visite me dit-on, est-ce qu’ils viennent dedans je demande, et l’infirmier d’être au courant, de dire Pas à l’intérieur, vous pouvez faire un tour à l’extérieur, dans le parc, et de le dire avec une lueur gourmande dans les yeux, comme s’il me faisait un cadeau, une faveur, comme un tueur de femmes qui se croit un type bien au dernier jour parce qu’il épargne sa dernière victime – avec la gourmandise d’un salaud qui découvre au moment de l’espoir presque fini que dieu est pardon, qu’il pardonne depuis le début, qu’il a tout su, agencé, compris.
Donc c’est moi qui sors. Je sors.
L’air vif et vrai.
Ma mère, son grand nez de l’Est, droit et blanc comme l’albâtre qui est une matière que je n’ai jamais vue, sinon écrite, l’albâtre – et son corps gras de la graisse des ans, sa chair froide, les loches autrefois superbes contreforts, maintenant fanées, fleurs à sec, la grande natte noire le long du cou et contre la colonne, les yeux marrons, sauf parfois, dans la lumière rasante crépusculaire, verts ; elle vient à moi et répète Ma fille, Ma fille, tout à fait comme dans les films sur les Juifs – les films comiques s’entend.
Mon père derrière, nous encadrant, sombre tel un du Nord, le front orageux, les yeux d’un chinois, petits, le crâne nu et tanné, vieux cuir de tête qui ne craque pas, les épaules rondes de muscles masculins, le ventre lourd, la barbe comme de la cendre qui a bien braisé, regardant par-dessus moi l’infirmier, la baraque de l’asile, la forme de l’institution pour fous, avec un air de sain dégoût, de droite répugnance.
Nous marchons ensemble dans ce parc ridicule, ma mère veut être sûre que je vais bien, à quoi je réponds que ce n’est pas dit, en toute lucidité, sinon je ne serais pas là à faire des tours de ce parc ridicule jonché de lapins morts, à vingt ans j’ai sans doute de bien meilleures choses à faire comme de conquérir le monde car c’est l’âge, comme de finir, comme de commencer mes études, plutôt que de m’arrêter à chaque lapin pour voir s’il est bien mort, mort de ce qui s’appelle mort, inanimé, raide, l’œil absent, rouge, enflammé de myxomatose.
Quant à mon père il ne dit rien, ce qui est très normal, c’est un Sapin, les Sapin ne parlent pas, c’est connu, ils ne parlent pas mais ils n’en pensent pas moins.
Puis ma mère nous fait son spectacle il fallait bien. Elle se plie comme frappée de foudre.
Genoux plantés dans l’herbe. Sa robe autour faisant flaque. Les bras levés. Plaintes aux cieux. Adresse au seigneur. Mais qu’est-ce que j’ai fait, commence-t-elle. Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter pareille vie si pleine de drame, veut-elle savoir. Ça n’en finira-t-il donc jamais, interroge-t-elle.
Au-dessus d’elle, pile, pour les besoins de l’émotion, un nuage noir, silhouette torve, petite frappe de l’air, semble tout ouïe. Il est là pour elle, ne s’est formé que pour elle, pour sa détresse. Et ça continue. Qu’a-t-elle fait au seigneur.
Ce n’est rien. Ce n’est encore rien. Nous n’avons rien vu. Nous pensons naïfs que ma mère va s’arrêter là, qu’elle ne peut aller plus loin, mais c’est faux, elle peut aller plus loin, elle peut aller où elle veut et où elle veut c’est toujours plus loin que nous n’imaginions, nous ne pouvons pas suivre, sommes à la ramasse, à la traîne psychique de ses pensées et prières, bien trop loin derrière, nos esprits sont pauvres petites choses racornies, autant de grenouilles poussiéreuses, mortes de soif, nos esprits. Et elle : son esprit : une magnifique plante élancée, luxuriante, partout s’accrochant et bourgeonnant de nouveau, conquérante de toutes les directions.
Elle peut aller plus loin : elle y va. Les larmes lui balafrent les joues, brûlantes. Ses yeux se teintent du rouge même des lapins morts. Ses bras retombent, elle se couvre la tête de cendres qui sont de la terre mêlée de brins d’herbe qu’elle vient d’arracher à pleines poignées.
Elle hurle. C’est un goret.
La lame de l’affliction pénètre dans sa gorge de goret et elle hurle en goret.
Stridence insupportable, sinon pour les lapins cadavres, qui ne remuent pas d’un pouce.
Pourquoi tu me fais ça, à moi, ma fille, grogne le goret.
Est-ce une malédiction ?
Toutes les filles sont-elles condamnées ?
Dans cette famille ?
A être folles ?
Déjà ma mère avant moi ?
Et maintenant ma fille ?
Est-ce une malédiction ?
Et ça continue, ça continue, ça tourne, elle surpasse par la voix les ondes les plus aiguës parmi les aiguës, elle tourne, n’en finit pas de tourner comme un moulin de malheurs et de cris.
Mon père, sombre, front rayé de rides puissantes, sourcils arqués comme de vieilles arches, yeux chinois et tant plissés qu’on les croirait fermés, crâne comme un cuir bien ciré, barbe de sel, me prend par le bras, nous éloigne.
Nous marchons un moment. Ma mère disparaît, on l’entend à peine, je l’oublie. Ses cris ce sont des souffles.
Nous nous arrêtons, sommes arrivés aux limites du parc. Un grand mur anti-fous se dresse devant nous. Trois mètres de haut. Je n’arrive pas à voir s’ils ont mis du verre pilé, des pointes de fer, des clous rouillés, du barbelé sur le dessus.
– Tu sais que ta mère est fragile dit mon père d’une voix qui est la voix de mon père, grave, chaude, inexpressive.
– Ta mère est un être fragile, tu le sais, reformule-t-il.
– Son cerveau est fragile, peu résistant, friable.
Le mur : aucune prise sur le mur. Trois mètres : c’est haut.
– Il est plein de fritures, de parasites, l’esprit de ta mère. Plein de bruit qui empêchent les pensées de se former simplement.
C’est haut, trois mètres, mais peut-être, en courant ?
– Elle pense à une chose, puis à une autre, puis à une autre, sans s’arrêter, on ne peut pas être logique comme ça, on fait du saute-mouton dans sa pensée, on ne s’arrête pas, bientôt on est fatigué, c’est nerveux, c’est essentiellement nerveux, c’est un problème de nerfs, les nerfs qui ne sont pas bien emboîtés, peut-être, qui n’ont pas de court-circuit, de résistance, qui continuent à fonctionner quelle que soit la charge, qui ne font jamais de tri entre les informations.
En courant très vite on peut marcher à la verticale. Ça s’est vu.
– Qui mettent les petites contrariétés et les vrais chagrins, les choses pas importantes et les choses importantes sur le même plan. Peut-être qu’ils ne savent pas faire. Ne savent pas mettre de l’ordre, faire place nette, peut-être qu’il n’y a rien dans la tête, dans l’esprit de ta mère, qui lui permette de se concentrer.
Ça s’est vu dans des films : Chantons sous la pluie. Tigre et Dragon.
Mon père plonge sa main dans sa barbe sel et cendre, l’air embarrassé.
– Il n’y a pas grand-chose à faire, Lola. Peut-être aussi que tu es fragile.
Yeux chinois, plissés comme des traits, quasi obturés.
– Pas de la même façon, c’est sûr. Mais fragile aussi, sous la force. Sous la force qui est la tienne. Le cerveau est fragile. Il n’y a qu’une solution Lola : se battre pour l’ordre. Pour les limites. Rester rationnel.
Crâne comme du cuir, sentant le cuir.
– Se limiter. Il y a des limites. On ne peut pas être tout le monde à la fois. Ta mère essaie de rester tout le monde à la fois, tout le temps. On ne peut pas.
– On ne peut pas tout être, des fois il faut savoir rester qui. Celui qu’on est. Bien voir les limites entre nous et le reste du monde.
– Tu comprends Lola.
La seule chose qu’on ne pouvait pas lui enlever à ce docteur c’est qu’il avait de belles mains, doigts bien droits, phalanges parfaitement rangées, et puis du calme, de la rigueur, une classe distraite dans l’alignement des deux, voilà, de belles mains, mais ça ne m’a pas empêchée d’attaquer dur, sec, angle fermé, on ne peut pas non plus tout pardonner à ceux qui ont de belles mains, je lui ai demandé comment il s’en sortait au jour le jour et j’ai enchaîné, Vu sa tête de mine de crayon sordide on voyait très bien comment il s’en sortait, comme un chef, comme un chef avec une tête de mine de crayon sordide, c’était évident, ça transpirait comme de la sueur qu’il s’en sortait, qu’il était là pour s’en sortir, mais où, vers où est-ce qu’il allait sortir, savait-il seulement sur quoi donnait cette sortie à travers laquelle il essayait de sortir ?
Il m’a laissé venir, j’ai bien vu qu’il me laissait venir, ça ne me dérangeait pas, je n’allais pas pour si peu me gêner, même si c’était le but peut-être d’à la fin par son silence me gêner ou que je me gêne toute seule, ce qui est candide car je n’ai pas peur de la semoule, n’en ai jamais eu peur, je peux y pédaler des heures puis des heures durant, sans problème, je sais qu’on trouve toujours un levier, ça racle dans le fond et on se sert de cette chose raclante comme d’un levier, j’ai rigolé, j’ai rigolé de bon cœur et j’ai dit C’est étonnant, on voit tout de suite quel genre d’homme vous êtes, il y a des gens comme ça, comme du verre, transparents, on n’a qu’à les découdre, tirer le fil, tout vient, tout se débobine, vous je vous vois retrouver votre femme le soir après l’usine à cerveaux malades, je vous vois ranger les pensées folles que les fous ont cherché à vous inoculer, avec leurs aiguilles psychiques, toute la journée, je vous les vois ranger ces pensées folles furieuses dans votre vestiaire mental blindé et les pensées cognent contre la tôle avec des bruits de masse et bref votre femme, les enfants, le repas, je passe vite tellement c’est ennuyeux, on arrive au coucher, les enfants couchés, vous couché, et votre femme, cette insatiable, qui veut, et vous qui ne voulez pas, vous plein de pensées ignobles, vous sentant vous-même ignoble, contaminé par ce vestiaire blindé bondé de saloperies cérébrales, qui ne sont pas vous à l’origine, mais font partie de vous maintenant, de votre bagage permanent, on l’emporte où l’on est, qui occupent une part de vous de plus en plus importante, expansion du vestiaire, murs qui reculent, et lamentable vous murmurez à votre femme que ce soir, vraiment, mais elle vous prend déjà, s’en fiche, elle fait le boulot puisque vous ne faites pas le boulot, vous abandonnez, n’êtes plus là, êtes devant le vestiaire sombre, et votre femme y va, elle y va elle, il lui reste quelque chose, elle est déterminée à quelque chose, ce n’est pas comme vous, à force d’être comme un chef, de vouloir s’en sortir, de ne pas vous affronter, ça vous mène là où vous en êtes, pas un pouce plus loin.
– Madame Sapin dit le médecin, les mains toujours artistement rangées.
– Mademoiselle.
– Nous ne sommes pas là pour parler de moi.
On aurait pu lui enlever les mains cela dit. Avec une hache ou une hachette ou un long long couteau. Dans ce cas tout change. Ses mains ne sont plus la seule chose qu’on ne peut pas lui enlever, on peut lui enlever ses mains, on peut tout lui enlever.
– On est là pour vous Madame Sapin, c’est vous qui connaissez des difficultés.
– Vous vous ne connaissez pas de difficultés.
– Je connais des difficultés, comme tout le monde.
– Vous êtes comme tout le monde.
– Je suis comme tout le monde mais si vous êtes hospitalisée…
– Si je suis hospitalisée c’est pour mon bien.
– Si vous êtes hospitalisée c’est que vous êtes arrivée à un moment, dans votre vie, où vous n’arriviez plus à fonctionner.
– Vous vous arrivez à fonctionner.
– Restons concentrés sur vous madame Sapin.
– Mademoiselle.
– On ne dit plus mademoiselle à nos patientes.
– Non ?
– Il y a eu une loi.
C’était la meilleure. Ce type avec ses mains était si impliqué dans l’existence qu’il en était venu à se persuader qu’il y a des lois pour tout, par exemple une loi qui dit qu’il ne faut pas dire mademoiselle.
– Mademoiselle, ça peut être mal pris poursuit-il.
La meilleure ! La meilleure, vraiment : le type convaincu, hypnotisé par la loi : il y a une loi pour dire ! Ou ne pas dire !
– Mais si je me sens mademoiselle je demande.
– Si je me sens mademoiselle et veux me réaliser en tant que mademoiselle j’insiste. Si mon désir c’est d’être mademoiselle, de grandir mademoiselle, de vieillir mademoiselle. Si je m’espère vieille fille ?
– Mettons ça de côté. Il y a un moment, dans votre vie, ce moment, en ce moment, où vous n’arrivez plus à fonctionner, où vous avez dû être hospitalisée.
– Vous vous répétez, je note. Qui est le tiers ?
– Qui a fait la demande d’hospitalisation ?
– Oui. Qui est le tiers de la demande d’un tiers ?
Et là je les tenais presque, les traîtres, les assassins, les vandales. Je le tenais mon frère, ce cloporte à face de parasite, toujours à chiquer au chic type, avec ses dents pourries, rayées par l’acidité de ses propres sucs ! Je la tenais ma mère, cette pièce de théâtre sans scène ni public, grosse masse blanche aux yeux noirs, fourbes, biaiseux !
– Personne. Vous n’êtes pas là à la demande d’un tiers.
– Non ?
– Vous êtes là pour raisons de péril imminent.
– Et quel est le péril ?
– Vous vous mettiez en danger.
C’était bien la meilleure ! La deuxième meilleure, après la meilleure de tout à l’heure ! Je me mettais en danger ! Bien sûr que je me mettais en danger, pour sûr, si on comparait, si on regardait ça, ma vie, par rapport à lui, qui essayait de s’en sortir, forcément, pas d’ombre de doute, je me mettais en danger. Il n’y avait qu’à voir ses mains.
– La symétrie n’existe pas dans la nature dis-je.
– Vos mains développai-je. Ça ne sert à rien de les aligner comme ça. La symétrie n’existe pas, toute chose n’a pas son double, vous devriez arrêter d’essayer de vous en sortir.
Quitte à dormir, dehors, il aurait fallu un chien. Tous les types me l’avaient dit. Aussi les rares filles. Mais je hais l’odeur canine des hommes et pour cette raison je hais l’odeur humaine mouillée des chiens, leurs yeux émus, leur langue humide suant la tendresse, cette espèce d’affection qu’ils ont, vertigineuse, inentamable, végétale, pour tout ce qui est proche de la main qui nourrit, ce grand vide d’intelligence à l’intérieur de leur cœur de bête, je détestais tout ça, pas question d’en prendre, j’aurais préféré un chat, un mauvais chat fielleux, toussotant, l’œil encroûté, la mine défiante, c’est ça qu’il m’aurait fallu, un chat pelé, griffé, ayant connu mille combats, estropié mille fois, mais il ne m’aurait pas suivie, c’est bien le problème, il m’aurait fallu un animal qui ne m’aurait pas suivie, on ne s’en sortait pas, mieux valait dormir toute seule, être l’animal.
D’ailleurs je ne dormais pas. Je fixais la nuit cachée dans les lumières. Je pensais : la ville cache la nuit, par derrière la brume de lumière les étoiles clignotent, parfois elles baissent en intensité, c’est imperceptible, c’est une planète étrangère qui passe, il y a de ça longtemps, devant une étoile étrangère, son ombre se porte, c’est une pierre étrangère qui ombre un astre étranger qu’on ne voit pas, qui nous est caché, que notre propre lumière nous cache. Je ne dormais pas, je faisais ce genre d’astronomies, parfois on m’adressait la parole, des soûlards mais aussi des gens très bien, comme vous comme moi, dont une dame qui s’écria et ça venait du cœur Mon dieu qu’elle est jeune, dont un vieux monsieur qui promit qu’il allait m’apporter un sandwich et des bougies et une couverture, qui partit avec un sourire, les rides du sourire avaient creusé sa joue en larges sillons de labour joyeux, et qui ne revint pas. Parfois un soûlard passait, repassait, trimballant le parfum de son urine, me tournait autour dans l’attente de je ne sais quoi, je finissais par le menacer de lui lancer une bouteille sur le crâne, de lui ouvrir le crâne, de lui manger les lobes, il prenait ça à la plaisanterie, bonhomme, tendait les paumes vers le bas dans l’espoir de calmer le jeu, disparaissait finalement, libérant l’atmosphère de l’odeur de son urine infectieuse, ce qui était très bien, on pouvait sentir le gaz, le carbone, le fumet du pétrole, toute la chimie urbaine dans l’air d’autant mieux.
Et chaque nuit était une nuit pour rien, une de ces nuits où l’on ne voit plus le sens du courant, une de ces nuits où plomb et mercure coulent durement dans les veines, où la joie déprime, où le silence gagne contre le bruit. Puis je savais bien que tout ça n’était pas constructif et même ridicule. Que ça ne servait à rien de vivre dehors et de se couper de tout et de ne plus se battre pour le mouvement et de ne plus travailler à la chute de l’empire.
Car l’empire lui luttait sans relâche. L’empire ne lâchait rien. L’empire œuvrait dans le noir et dans le jour et aux quatre coins du monde, il n’y avait pas de répit, pas un souffle humain, pas une seconde humaine dont l’empire ne profitait pour se renforcer, pour se faire incontestable, pour s’infiltrer toujours plus profondément dans la trame des choses, dans l’organisation de la vie, par la guerre et par l’architecture, par la police et par l’urbanisme, par les routes, les vêtements, les meubles, la plupart des gens déjà pensaient que l’empire c’était le monde même, qu’il y avait coïncidence entre le monde et l’empire, oui, la plupart des gens pensaient ça, il n’y avait qu’un seul monde, c’était le monde impérial.
L’empire c’était le flux constant. La circulation. Ce qu’il aurait fallu c’est trouver le moyen de tuer le flux. C’est ça que cherchait à faire le mouvement : créer la croûte. Le caillot qui obture. Seulement à chaque blocage l’empire construisait des voies nouvelles, des ponts neufs par où se déversait ses fluides. On s’épuisait à couper et à saboter en vain.
Comme après les manifs : les services d’entretien de la ville qui effaçaient toute trace de la colère. Disparition du moindre tag. Remplacement des vitres brisées des abribus ennemis. Substitution des caméras brisées. Haine de l’angle mort. Ce qu’il aurait fallu c’est un caillotage général. Des boules de sang sec qui arrêtent tout. La fin du flux. Puis le lancement de la contre-production générale. En attendant on s’épuisait. Moi je n’en pouvais plus.
Chaque nuit était une nuit pour rien.
Dans ces nuits-là tout flingue, le sommeil tient les yeux ouverts. On voit l’univers. L’univers se tend, se contracte, se replie et les cerveaux s’ouvrent et les lobes se dilatent, on rejette dans le fleuve nos fleurs de femmes et fœtus ridés par bancs de trois cent cinquante. Les bronches fument. La toux ébranle, casse, on se lève dans le froid rhumatismal, on s’étire, c’est l’aube, c’est le jour qui vaut tout de même mieux que la nuit, mais le jour passe vite.
Sorti des brumes, l’œil chinois, les épaules rondes, sa silhouette perçant les lumières saturées de ville, c’est bien lui, c’est mon père qui vient à moi, je suis parée pour une nuit nouvelle, mon duvet et sac de couchage déjà installés sur la bouche de chaleur qui ventile sa chaleur nocturne, il m’a trouvée, l’idée me prend comme une boule terrible déchirant les tripes qu’il va me frapper, je ne sais pas pourquoi, lui qui est très doux comme sont les très forts, qu’il va m’en coller une si rude que le mur m’en retournera une deuxième, comme on dit au village, dans le Nord, dans le pays qui a vu les Sapin naître.
Or il ouvre ses bras c’est vrai comme deux grands bras-outils de fer et de plomb, lourds comme des masses, mais les referme sur moi lentement, hydrauliquement, m’enserre, je pleure, des larmes m’éclosent des pupilles, me rougissent le blanc, je dis à mon père que je suis sa fille, à quoi il répond oui comme si ça allait de soi, il me dit de rassembler mon barda, on va manger, il m’offre le resto, je demande si ce n’est pas trop tard, il dit que non, ça ne l’est pas trop, il a décidé que ça ne l’est pas trop.
Le serveur hésitait, sa patte gauche alternant avec sa patte droite, il piétinait d’hésitation, je devais sentir mauvais, je devais sentir le rat d’égout, ça devait être mon odeur, le serveur balançait, d’un côté le respect dû à tout client, à tout argent, à toute monnaie et de l’autre le prestige de l’établissement pour lequel il travaillait et qu’il représentait, dont il était garant, c’était un dilemme, on sentait bien que c’était un dilemme, il hésitait à nous placer, et en même temps mon père, voilà, il y avait mon père, digne comme sont les hommes à partir d’un âge, dressé comme un du Nord, droit dans sa veste prolétaire, né de la mine, et sa voix comme du sable, titanifère, et ses prunelles peintes à la houille, mon père flanqué de sa fille crasseuse, voilà, il y avait mon père, ce n’était pas le genre d’homme qu’on éclipse, le serveur déglutit et tente d’avancer un refus, l’esquisse d’un refus, mais rien ne sort de sa gorge, le regard de mon père fige salive et sons dans la gorge du serveur, qui s’incline, nous laisse passer, nous indique une table pour couple, bien au fond, sur laquelle une chandelle romantique brûle et fond.
On mange avec application, savourant chaque saveur, à la fin du repas mon père dit c’est bon ici, ça coûte un bras mais ça vaut le bras, au moins ces gens-là te font manger, ce n’est pas uniquement des noms compliqués sur la carte, il y aussi de quoi manger dans l’assiette.
On mange lentement sous des lustres très riches, sous des suspensions faites de mille joyaux de jaspe et de rubis et autres pierres précieuses et semi-précieuses comme dans la bible, le serveur s’est détendu, a dû s’habituer à ce que je pue, il ne nous chasse pas, il propose un digestif à mon père et mon père est tenté oui par un digestif et le serveur demande si je désire aussi un digestif, pour tout dire je ne suis pas contre, on nous amène peu après deux petites fioles d’or qui sont les digestifs, qu’il faut boire, que l’on boit et qui laissent dans nos gorges, tubes, estomacs, deux coulures tièdes.
Mon père tient à savoir.
– Je n’en sais rien dis-je, c’est ainsi, peut-être que c’est ainsi, peut-être que ça changera.
Il ne comprend pas comment je peux être assez malheureuse, assez stupidement malheureuse pour faire ça, à mon âge, avec toute la vie devant moi, une fille comme moi, la sienne.
– Je ne sais pas, c’est une chose ainsi j’explique, une chose que j’ai besoin de faire, il n’y en a pas d’autres que je me vois faire pour l’instant.
Mais il y a une différence, trouve-t-il, entre faire ce qu’on veut, et ne rien faire du tout, se gâcher, se pourrir uniquement pour se pourrir la vie, puis qu’est-ce que ça voulait dire, est-ce que je ne voyais pas le mal que je faisais, est-ce que je pensais à ma mère, à chaque nuit qui passait pour ma mère, à ce que ça lui faisait ?
– Ce n’est pas comme si tu ne savais pas qu’elle est fragile ajoute-t-il.
– Tu sais qu’elle a le cœur et l’esprit fragile, les deux comme du verre.
– Comment veux-tu qu’elle se remette, avec sa fille qui est dehors.
– Et je ne te parle que de ta mère. Je ne te parle pas de moi.
J’allais lui dire que je préférerais, justement, qu’il parle de lui, et de loin, car il ne parlait jamais de lui, son cœur propre était parasité par les lianes du cœur de ma mère, son cœur propre ne battait plus pour lui mais pour elle.
– C’est comme si on t’avait élevé pour rien dit-il.
– Comme si tu étais une fille de la rue.
Il hésite à ajouter une orpheline, ses lèvres forment le mot, il n’y met aucun souffle, ça ne sort pas, c’est idiot, ses parents, les vieux Sapin étaient des orphelins, oui, mais ça ne se transmettait pas, il n’y avait pas de lignées d’orphelin, ce n’est pas quelque chose qui vous coule dans le sang.
À force la ville s’est effacée, l’herbe a gagné, il y avait de moins en moins de routes qu’on pouvait appeler routes, de plus en plus de routes qu’on devait appeler chemins, je ne sais pas combien de temps j’ai marché, il paraît qu’un cracké, une crackée, un homme, une femme qui fait brûler les roches du crack dans sa pipe de fortune, un tel homme, une telle femme peut marcher pupilles azimutées des heures et des heures qui font des jours durant, sans boire ni manger rien d’autre que l’eau des rosées et la poussière du vent, avant l’effondrement, avant de s’abattre, il paraît qu’eux peuvent, donc pourquoi pas moi, je marche sur le bitume des routes qui s’est mué en terre des chemins, autour les câbles de la ville virent feuillages, les façades tournent troncs, les gens épines, les voitures oiseaux pépiant dans les fourrés, je marche, je voudrais un pouvoir, j’aimerais un pouvoir, n’importe lequel, faire des bonds immenses, voler dans les ciels, avoir un pouvoir, aller tellement vite que personne ne me voie, plus, jamais, ou à peine, faire du feu avec les doigts, cracher l’acier, suer la mort, me sublimer gaz roux, fuir au fond des cavernes, être géante, manger des banquiers, avoir un pouvoir, ne plus mouiller quand il pleut, ne pas être trempée comme trempée je suis, la goutte au nez pendante, les muscles qui tremblent et gèlent.
La ville, le mouvement, loin derrière moi, abandonnés. Pendant ce temps l’empire tissait sa toile, fils solides après fils solides. Il fallait pourtant que je parte. J’avais besoin de partir et de ne plus être là. De ne plus penser à l’empire. C’était un renoncement. L’empire lui ne renonçait pas. La police continuait de charger, de défendre les intérêts du capital. Le capital agitait ses cents myriades de bras en tous sens, brassant l’air si vivement que rien n’entrait dans nos poumons indemne de lui. L’air était plein de particules d’argent. Les riches grossissaient. Les pauvres maigrissaient jusqu’à l’inexistence, jusqu’à l’invisible. Il y a avait ce jeu de l’empire qui était un jeu sans arrêt, rien d’une conspiration, quelque chose de très ouvert, avec des rendez-vous non pas secrets mais officiels, avec des réceptions, et dans ces réceptions on servait des petits fours bourrés de gelée de langoustine poudrée de drogue blanche. Une structure. Un déploiement.
Je fuyais.
Pourtant rien qui n’avance. Les nuages qui n’avancent. Les lignes de l’horizon qui n’avancent, pourpre, parme, aubergine, braise.
Le paysan qui vient par là et me cueille au passage, me ramasse comme un champignon qui ne suis ni fleur ni plante ni lapin, qui ne suis d’aucun règne évident, il me ramène chez lui, il y a sa femme-là qui ne s’étonne guère, chez eux tout est bien roulé et huilé, ils sont prêts à tout les gens les plus cachés, Tu nous ramènes un drôle d’oiseau ce soir elle dit mais sans accent sur drôle, ni sur oiseau, ni sur nulle part, puis elle continue d’éplucher les patates qu’elle avait prévues d’éplucher, le paysan me dépose près du feu, qui brûle dans l’âtre noir avec des ronflements heureux, je me sens comme une crevette attrapée par un pêcheur titanesque à barbe d’écume, relâchée, remise au fond du trou avec la délicatesse difficile de ceux qui cognent, écrasent, hachent d’habitude, je retourne à l’eau et au sable, moi minuscule crevette, à cette fosse humide qui est pour nous crevettes la maison, je vois mon père crevette rentrer en disant La maison ! comme font les pères crevettes et ma mère crevette s’écrier Mon chéri ! et moi minuscule crevette grésiller ZZHzfgduzjdzzdikchve ! car je n’arrive pas encore à prononcer Papa !
Chaque doigt comme trois fois mes doigts, gris à force d’être terre, les ongles cerclés de noir pétrole suie, une main de travail dont il enveloppe ma main qu’on ne peut plus appeler main, qu’il faut appeler menotte, cette chose mienne fragile, cassée d’avance.
M’enveloppe.
Ma main disparue. Plus que la sienne.
Après quoi sa voix, la voix du paysan, le roulement de sa voix tel le roulement d’un tambour de grotte :
– C’est chaud Lola.
– Prends des patates avec du jus. C’est de chez nous.
– Si tu veux retourner dans les bois, tu manges.
– Tu finis l’assiette.
Et la femme d’acquiescer chaque fois. Et moi d’acquiescer.
– Avec une assiette comme ça
(elle est énorme, l’assiette, des morceaux de tubercules comme des demi-organes y dérivent sur une nappe de jus couleur sang vieux)
– Tu tiens quinze jours seule dans les bois.
Je remercie, j’engloutis, je lape, je lèche, je nettoie jusqu’au fond de la langue. Pas de gâchis. Mon ventre tendu. Je m’amollis.
La femme du paysan prend ma nuque dans la pince de phalanges recuites de ses doigts, à peine moins énormes que ceux du paysan, l’autre main sous mes genoux, elle me porte sans mal, me dépose près du feu, me ferme les yeux pareil que pour les morts.
On peut, si même on voulait, pas sortir de la caverne des paysans, il y a le soleil. Ce gros astre qui tape comme un sourd. Moi je n’ai aucune envie d’aller là-dedans, dans le gros bain, d’être dorée de rayons, rien de pire, ce qu’il me faut c’est de la pluie, bien gelée, de la pluie en cubes qui éclatent au sol avec un bruit de mauvais cristal, de faux cristal du supermarché, c’est ça qu’il me faut, qui serait adéquat, j’ai besoin d’accord, sans quoi je n’y vais pas, j’ai besoin d’un nuage qui remplisse tout, parfaitement carré, à la taille du ciel, qui ne laisse pas un angle à découvert, qui protège. Sinon je reste. Je reste au fond, collée à la pierre, dans le noir yeux ouverts, à trembler seule. Je fais la fille qui fait la plante qui s’accroche. La fille lierre avec ses minuscules ventouses, qui épouse la pierre, la creuse, la dessine, l’effrite pour s’ancrer plus profond, la fille paroi, rupestre, la plante parasite, je m’accroche. Je m’accroche jusqu’à ce que la pierre m’inocule sa maladie de pierre, par sa maladie je guéris de la maladie mienne, je profite de sa maladie comme d’une guérison, d’un antidote qui a la forme d’un poison jaune, puant, infect, mais qui sauve, c’est à peine si me vient, de par dehors, l’odeur âcre du bois qui pousse, s’élève, ramifie, monte au ciel tel un feu rude, je me fige, raide comme l’arthrose, c’est à peine si je vibre. En moi le bouillon s’arrête. Les globules de mon sang se regardent, air stupide peint sur leurs faces molles et rouges et blanches.
Les organes même qui ne palpitent plus, saturés de curare psychique. C’est la grande stase. Mes yeux tombent des paupières, seul le nerf tient. Je ne vois plus que dans une teinte qui est une teinte obscure. Mes poils s’éclipsent, à terre, forme à terre une balle comme une balle de foin noir. Ce qui était gras, le peu de gras des fesses, des bras, sous le menton, coule. C’est un régime, on se liquéfie. En outre on sait bien où tout ça mène : dans le sens inverse. Il y a le sens après quoi on court, et il y a le sens inverse. Le sens inverse est peut-être le vrai sens. Le seul sens qui soit vraiment une direction. C’est là que je vais. J’abandonne l’énergie, l’édification, les grandes structures, le bitume, la laque par-dessus le tout, l’organisation des masses, tout ce qui bourgeonne et insiste ; je reviens au cœur solide, et après le cœur solide il y aura le bang, la détonation, le monde premier, quand j’explose, mille matières.
L’orage couvrant le monde, écartant le ciel comme un petit frère, d’un revers de main. Les puits qui bouillonnent. Les nappes de l’eau furieuse à l’intérieur du sol. L’énergie cinétique du fond des souterrains. Cette chaleur qui n’est pas celle seule du bois, qui est celle du bois minée par celle de l’air qui le blesse, par celle du vent qui le coupe, par celle des feuilles qui le brûlent, l’enflamment, l’irradient, par le souffle de l’incendie, par la colère grasse de l’humus, par la poussée des troncs, cette chaleur qui ne vient pas de la seule force du bois, qui est mélange, réseau des forces, combinat des éléments qui ne sont pas atomes mais fluides idem au fluide des filles, à l’électricité du sexe, à la trémulation maline comme un cancer des cuisses qui résout l’orgasme, à l’appel des fonds, abîmes, gouffres hérissés de pieux, à l’attrait des proues pour les récifs, des ventres pour les lames, des enfants pour les vieillards, les choses mortes, les objets sans âme, les vers qui trahissent le fruit, fluides idem au désir du cœur pour le froid, la glace, le congélateur – cette association sauvage qui est le souffle vital piqueté des points noirs du décès, de la flamme, de la fin, ce tourbillon qui donne le seul change possible qui est la magie au centre des choses, le foyer inhabitable, la demeure faite pour tous sans être à personne.
Je quitte la caverne. Je marche et marche encore. J’arrive quelque part.
Ça ne pouvait pas être le Nord, je savais bien qu’on n’atteint pas le Nord à pied, mais ce n’était pas si mal, c’était une approximation du Nord valable, j’aimais le coin, c’était un pays au moins, pas une banlieue, pas un objet périphérique ni une métropole, c’était un pays, ça sentait le pays, il y avait une odeur de nuit des temps qui était peut-être l’odeur des boules de pin, de la colle de pin, des champignons moisis, des feuilles sous mes pas froissées, en tout cas on y était comme dans un pays dans ce pays-là.
Quoique ce ne fût pas le Nord ça se défendait. Ce n’était pas la terre qui avait été la terre de la femme qui avait donné la vie à mon père ; mais ça se tenait là et puis ça ne bougeait pas, c’était posé comme on dit Tu te poses un peu là mon vieux.
On était l’après-midi mais il y avait toujours cette sorte de soleil blanc du matin qui ne chauffe pas le ciel, se refuse à jaunir, reste blanc comme une fesse nouvelle, ce n’était pas aujourd’hui qu’il prendrait des couleurs, l’astre, il s’y refusait, n’était pas question pour lui de nous bronzer ni cuivrer, il était venu pour la lumière et c’était à peu près tout, se contentait de flotter au milieu de rien comme un gros œuf amniotique flotte dans sa gaine.
Ce n’était pas le Nord, bon, nulle trace des Sapin ici, de la famille, mais il y avait des bois, on pouvait courir dans ces bois, courir dans les grandes fabriques de résine, se déchirer aux branches basses, courir puis haleter joyeusement, les bras, les joues en sang, cracher un peu, sortir la bave des poumons, on pouvait faire ça, on avait le droit, c’était possible.
Ce qui manquait le plus c’était l’amour dans tout ça, la chaleur dans les autres corps, on était seule avec soi dans les bras, avec son corps froid, ne restait plus qu’à frotter, frotter, frotter jusqu’à ce que la friction allume en lui, ce corps, en ses parties inflammables, en ses parties soufre et phosphore l’onde des premières flammes, de la sorte je me retrouvai souvent à devoir me satisfaire, je me satisfaisais donc, avec n’importe quoi d’ancien, souvent une souche, pourvu qu’elle fût ancienne, eût l’air sage et moussu, j’allais tout contre la souche et me satisfaisais, par la friction, friction de plus en plus forte à mesure que prenait souffle, en ce corps, les parties inflammables, soufre, phosphore, j’arrivai au moment où cette friction perd nom de friction, devient tremblement, écume rose aux lèvres, crise de haut-bien, veines du cou gonflées à rompre, pieds tendus vers les ciels, peau criblée, soulèvements, tétanie, muscles cambrés comme mille étalons cambrés, et donc cavalcade, charge montée, puis choc, lumière, nœud.
C’était une fuite. Je regrettais mon départ. Pendant que je fuyais tout continuait, le mouvement, les luttes, les affrontements, blocages, inculpations, gardes à vue, tout continuait.
Il y avait eu ce repas, le repas des paysans, un repas pour tenir quinze jours, mais je partis plus de quinze jours. Au bout de trois semaines il me vint à l’esprit, en observant un petit oiseau sectionner un ver, que je devais manger. J’avais oublié ma faim. L’oiseau tranchait en bouts symétriques le ver comme la femme de mon frère coupait symétriquement ses haricots. Je pensai à une parenté. Une parenté occulte. Mais rien d’étonnant. Rien qui ne fût plus que hasard probable, car la femme de mon frère je l’ai dit était faite de ce foutre dont on fait les planètes, son destin balistique était de féconder l’écorce, on pouvait imaginer, on devait supposer que ce sperme femme cosmique n’était pas balancée à l’aveugle : puisqu’il y avait tir, il y avait aussi calcul, il y avait trajectoire donnée, la femme de mon frère était destinée à la terre, et serait-elle arrivée plus tôt, c’est-à-dire à l’heure, quand les pierres éruptives giclaient encore, quand les mers fumaient, quand les ciels pissaient lave et poison, serait-elle arrivée plus tôt qu’elle eût ensemencé le monde de la même exacte manière qu’il avait été ensemencé, et la vie des bêtes qui rampent, qui nagent et qui volent, la vie des plantes et des champignons et des hommes se serait développée de la même exacte façon, tout exactement pareil, je serais devenue qui je suis. Seule : la femme de mon frère n’eût pas existé, si ce n’est à l’intérieur de tout, comme oiseau, comme ver, comme tronçon de ver, comme tout ce qui luit, mue, palpite.
C’était à travers bois toujours, il y avait cette ligne pâle, cette eau qui semblait vous appeler, je m’arrêtai. De mes vêtements je fis un tas, les pliai soigneusement, les formai en pyramide, entrai du bout de l’orteil dans l’eau, puis la cheville, me baissai, m’allongeai, c’était la seule façon de s’immerger, il n’y avait pas beaucoup d’eau, elle était froide comme de l’eau d’hiver, je me relevai, il fallut s’ébrouer, mes cheveux ruisselaient mille ruisseaux. Il n’y avait rien pour frotter, je me lavai de neige comme les filles du Nord du temps du Nord. On était glacée mais de la bonne glace. De la pointe du doigt je sentis mes sourcils, ils broussaillaient à la façon des mauvaises broussailles, presque des sourcils d’esclave de l’Assyrie, noirs, touffus, rebelles, Marthe n’aurait pas supporté, m’aurait dit Ne bouge pas, très vite on serait parties dans l’épilation. J’aurais dit oui. J’aurais cédé à Marthe. J’aurais été heureuse de retrouver Marthe, d’être avec Marthe, je lui aurais pardonné ses hommes, sa recherche de la multiplication cellulaire, je lui aurais parlé simplement, nous nous serions parlé simplement, je lui aurais mieux expliqué le mouvement, je lui aurais dit c’est simple, c’est tellement simple que c’est dur à voir, le mouvement est la seule chose qui vaille car c’est la seule chose qui soit dispersion, refus de l’empire, qui soit geste, tremblement, vitesse, qui soit ailleurs, contre-présent, souterrain.
Après ça je sèche, l’air pique, le vent larde, ma peau, tout mon corps de peau rougit, se couvre de peau-rouge, sauf pour le triangle noir, qui est ma toison.
Au bout de trente jours la faim est là vraiment. Je la trompe avec de petits riens. C’est l’occasion d’un jeu, courir à pleines enjambées la bouche ouverte, grande, avaler quelques éphémères virevoltants, et laisser faire l’estomac, persuadé qu’on l’a chargé, laisser l’estomac lancer toute sa machinerie gluante, sucs et viscosités, laisser l’estomac se tromper lui-même pour deux brins d’éphémères. Sinon, avec les ongles : entailler un tronc, détacher l’écorce, l’amollir de bave, la corroder, puis l’introduire, bout par bout, sous les mâchoires, et ruminer, ruminer, jusqu’à former en gueule une boule de salive marron, de jus de chique, et déglutir, lentement, lentement, ce n’est pas très bon, mais nourrissant oui, nourrissant comme un arbre ; enfin c’est une technique, il y en a d’autres, j’en avais d’autres et des plus obscures.
Une fois : un oiseau blessé, le cou rompu. Il pépie à l’aide lamentablement. Je mâchouille longtemps ses plumes soyeuses. Ça vous reste en gorge. Ça s’accroche. Mais on s’y fait comme on se fait à tout. Je lui romps le cou car il ne cesse de pépier lamentablement. Quand son cou est brisé ce qui s’appelle vraiment brisé, il cesse de geindre, l’oiseau, son œil se vitrifie. On peut mordre la chair ; les plumes je les ai avalées, ensuite c’est la chair, douce comme de la chair d’enfant, blanche, je grignote ça doucement, ça vous coupe l’envie de manger.
Je sors de ces forêts premières, traverse des pays.
Je marche et marche encore.
Il y eut ce pays fumeux, incendié de tabac, j’accélérai le pas, c’est à peine si l’air se respirait, on l’engloutissait en purée. Dans ce pays-là tout était chaud, les pierres clapotaient, à leur surface se formaient des bulles grises, goudronneuses, elles grandissaient, grandissaient puis éclataient en répandant un liquide semblable au pétrole, mais qui ne prenait pas, même avec un bon briquet, beaucoup de gaz, ça ne prenait pas, ça restait noir et poisseux simplement. Les hommes de ce pays avaient le rire pareil aux rires de vin, on les entendait dans les villages, je ne m’approchai pas, passai les peuplements humains toujours de nuit, il y avait partout des effusions de terre, le pays semblait né d’une brûlure.
Il y eut des champs de blés roux comme le cuivre, des machines à grain vous les broyait mathématiquement, je laissai derrière moi aussi ma maigre trace d’épis couchés, des mouches goitreuses cerclaient ma tête, me faisait une couronne, je m’amusai à me dire la reine des mouches, en gobai une de temps en temps, ni par adresse ni par maladresse, les mouches venaient seules à ma bouche et je refermai, il y eut de ces orages, des lueurs d’argent, des éclairs noirs, un grand rugissement d’étoiles, la pluie vint, horizontale ou presque, de face, c’était une misère d’avancer, ce pays-là se dilatait, je croyais en avoir fini qu’il continuait encore, ce n’était que blés, orages, mouches.
Enfin ce fut le Nord, on n’avait pas cru ça possible, d’atteindre le Nord à la force des jambes, mais si, il suffisait de s’acharner, de ne pas compter les jours et pays, de traverser tout droit et encore tout droit, sans un regard pour les précipices et tunnels, les crêtes écailleuses et falaises luisantes de suc, il fallait y aller, y aller encore et on finissait par s’y retrouver, en ce pays du Nord entaillé, couturé par les grands sillons de la flamme rouge et de l’acier fluide, couvert d’un azote sombre, fumée de brouillard qui donnait à la terre sèche, stérile, rouille, son contraste premier ; ce pays-là n’était pas beau à voir, mais c’était un vrai pays, celui d’où je venais ; partout, aussi loin qu’on pouvait, on voyait cadavres d’usine et hommes désaffectés aux mains noueuses bombées d’abandon ; puis les routes noires, les nuées de petits oiseaux raides, le givre sur les pierres ; c’était un monde frontal ; chaque chose était en face de l’autre ; c’était un pays où il y avait eu de grandes mines et de grands combats, des combats de l’ancien temps, face à face, visage découvert ; l’air sentait encore le sang la fusillade et la sueur des CRS, de l’armée venue mitrailler les mineurs, on voyait encore les traces de chenilles des tanks qu’un ministre socialiste avait envoyé contre les ouvriers du sous-sol, on voyait presque tout ça, presque, il suffisait d’imaginer un peu.
Je n’ai pas de mal à reconnaître le village, mon père m’en a parlé avec la précision d’un homme de peu de mots, je reconnais les toits, le chemin semé de cailloux obscurs, la grande bâtisse obscure de l’orphelinat, carreaux des fenêtres brisés, toit sans tuiles, charpente tordue. C’est donc là, je me dis, que tout commence : Par un soir d’hiver on dépose, devant les grilles, un être dont on ne veut pas. Il crie. Ses cris percent la brume. La dame de l’orphelinat vient voir ce qu’il se passe. Aussi bien c’est une bête blessée. Mais non : ce n’est pas une bête blessée : c’est un nourrisson aux joues cyan. Elle le prend dans ses bras, il n’est pas bien lourd. La bise lui mord le front, elle rentre avec son nouveau fardeau de vie. Dans la grande salle, elle pose l’enfant, qui crie toujours, près de l’âtre. Assez près pour qu’il dégèle. Quelques orphelines, les plus grandes, les plus mères, viennent voir l’enfant. On dénoue ses langes. C’est un garçon. On demande à la dame de l’orphelinat comment il s’appellera s’il n’est pas mort. Les garçons qui jusque-là se contentent de manger leur soupe dans un grand silence de cuillères cognées contre les bols dressent l’oreille. C’est qu’il s’agit de savoir. Le petit pourrait devenir un de leur famille, un baptisé de même nom qu’eux, et alors il faudrait s’en occuper comme d’un frère, car c’est la règle. La dame de l’orphelinat hésite un instant. Elle regarde le feu, les bûches fumantes. Un Sapin, dit-elle. Ce sera un Sapin.
Il y a un grand mouvement de désintérêt. Dans la salle le silence des cuillères cognées contre les bols reprend. C’est qu’il n’y en a pas tant que ça des Sapin. C’est une petite famille, dans l’orphelinat. Il y a deux grandes Sapin, qui partiront bientôt, iront faire bonnes, servir. Dont une Sylvaine, et l’autre, l’autre on ne se souvient jamais de son nom. Une Sylvaine Sapin, et l’autre : quelque chose Sapin. Et aussi une petite, c’est elle qui s’approche de l’enfant à peine dégelé, encore cyan des lèvres, elle c’est aussi une Sapin, elle a six ans, c’est ainsi que mon grand-père et ma grand-mère se rencontrent. Ma grand-mère est de six ans plus âgée que mon grand-père et c’est elle qui s’occupera de lui toute sa vie, c’est elle qui le sauva, qui continuera de le sauver, comme l’enfant qu’elle fut, dans la salle de l’orphelinat, ce jour-là, s’approche, prend mon grand-père contre sa poitrine, le sauve.
Mon grand-père n’est pas fait pour être abandonné. On le comprend vite. La grand-mère Sapin, enfant, le sait en son cœur : le grand-père Sapin, ce petit gars-là, est fait pour vivre dans un vrai foyer, avec des parents doux qui lui apprendront le français des villes, du centre, le vêtiront de riches étoffes, jeune homme ce petit gars-là fumera, sur l’argent de ses parents, du fin tabac.
Pourtant on l’abandonne. Il partage avec ma grand-mère, à l’orphelinat, une petite chambre sans feu, blanche. J’en pousse la porte, à moitié dégondée. La chambre est telle que mon père me l’a décrite. Sans feu, blanche. Un Christ d’ébène cloué au mur : figé dans la grimace de son dernier souffle.
Ma grand-mère se marie à l’église, elle ne voit pas comment faire autrement, et pourtant elle hait la face du Christ, sa face de douleur qui l’a suivi de ses yeux morts, année après année, dans la chambre sans feu de l’orphelinat. Le prêtre ne fait pas de salamalecs heureusement : c’est un prêtre du Nord : il les marie en deux coups de cuillère.
Le matin elle s’est levée Sapin, le soir elle se couche Sapin épouse Sapin. Personne n’est venu au mariage ; on n’a invité personne. On aurait pu inviter la dame de l’orphelinat ; si elle n’était morte quelques mois plus tôt, d’une congestion pulmonaire.
Ensuite, pour toute la vie : la grand-mère Sapin s’occupe du grand-père, qui n’est bon qu’à la pêche, et à rester seul, dans ses pensées : c’est un doux, ma grand-mère ne le dérange pas, elle l’aime, elle coupe le bois, elle s’occupe de tout, il l’aide quand elle a besoin, pour le potager, il essaie de travailler un peu, ça ne dure jamais, pour l’essentiel ma grand-mère le laisse se promener, courir les bois, c’est un homme qu’il faut laisser aller, elle n’a pas peur qu’il aille voir une autre femme, on ne trompe pas la femme qui nous a donné la vie.
Il y a les émeutes. Ma grand-mère cogne et mon grand-père perd son boulot. Il en perdra d’autres.
Ma grand-mère saisit un CRS avec les autres grands-mères orphelines dures au mal qui sont avec elle et ensemble elles lui baissent le pantalon. Jusqu’aux chevilles. Le fiche cul-nu et tout le monde voit ses petites cuisses blanches de poulet et se moquent de lui, c’est l’humiliation, on rit comme on a jamais ri, s’élève toute une collection de rires d’animaux de fer, d’orphelines du Nord, on glousse même, on n’avait jamais gloussé, pas une fois, jamais de la vie, mais cette fois-là on glousse.
On mitraille les ouvriers. C’est un combat perdu. Il y en aura d’autres.
J’essaie de retrouver la maison. C’est dur. Mon père m’en a juste dit : elle est à l’écart. Briques rouges.
Il y a cet homme que je croise, sur la route : les moustaches tombantes, les épaules droites, regard très sec : un homme du pays. Il n’est pas surpris de me voir là, j’ai l’air d’une fille du coin. Je lui demande pour la maison. Il ne sait pas. La maison des Sapin, j’insiste. Il ne voit pas. M’accompagne bien qu’il ne voie pas. Me fait faire le tour. Toutes les bâtisses du village en ruine. Les arbres poussent au milieu des murs. Les lianes de lierre qui font tomber les gouttières, les toits. Les portes enterrées sous les feuilles.
Je demande s’il y a encore du monde par ici. Qui vive ici.
Ce pays-là est disparu, me dit l’homme. Il hausse les épaules. C’est le Nord.
Bientôt un rêve. Ces hommes qui étaient les hommes et les femmes du Nord, on me fait comprendre, c’est une race éteinte. Ces hommes-là et femmes-là qui avaient deux jambes et deux bras et travaillaient de leurs mains, c’est évanoui. Ces hommes-là et femmes-là qui luttaient, ne voulaient pas se faire avoir, se battaient solidement sur leurs deux jambes, accrochés à leur travail, à leur pays, c’est fini. Ils ont combattu en face et ils ont perdu en face. Ne reste après eux que les cadavres des grandes usines, les ciels gris, le souvenir des grandes coulées d’acier chaud dans la nuit, et c’est tout, il n’y a plus rien debout dans ce pays-là.
Je vois bien qu’il a raison, l’homme du village. Je vois que la vérité sort simplement de sa bouche comme un sabre avalé qu’on recrache, acier luisant de bile.
C’est ainsi : le Nord est un pays sombré. Des hommes et femmes comme ma grand-mère, de vraies Sapin, des orphelines dures au mal, il n’y en aura plus. C’est une époque où les gens étaient droits, pouvaient être droits.
Maintenant est une autre époque qui est l’époque des filles de biais comme moi, des filles qui vont d’un lieu l’autre, sans repos, condamnées à l’invisible car toujours filmées, gardant visage caché, qui ne s’attacheront jamais, ni à l’homme ni au travail, qui ne s’incrusteront nulle part.
C’est l’époque des filles qui ne baisseront pas le pantalon des CRS parce qu’on s’en fiche, les CRS ce ne sont que des hommes, c’est l’époque des filles qui baisseront le pantalon des autoroutes, aéroports, billets de banque, câbles, tuyaux sous la mer, réseaux et filets, plomberies de tous ordres, qui mettront à nu la ridicule partie basse du monde et de l’empire, celle qui mue sans cesse, qui agite tout, qui trame.
C’est l’époque du mouvement qui est un mouvement de biais, où l’on se cache, où l’on bouge, qui est un mouvement désespéré mais qui est le seul mouvement, si bien qu’il n’y a pas le choix, il ne faut plus regretter les vieux pays, les vieux combats, il faut s’habiller de noir, ne rien regretter, être partout, être nulle part, combiner, couper le flux, s’organiser pour le prochain blocage, la prochaine émeute, le grand court-circuit.
3 notes
·
View notes
Text
Dimanche 15 Juillet 2018
Journée tranquille au programme. On a roulé jusqu’à 2h du matin pour s’avancer. Aujourd’hui, on va découvrir le Metor Crater. Suite à une exposition sur les météorites au Jardin des Plantes de Paris, on a découvert qu’une météorite s’était écrasée non loin de là où on irait en voyage. On s’est donc dit qu’on pourrait y faire un tour.
Réveil tranquille à 9h ou 10h, je ne sais plus trop puisqu’on n’arrête pas de changer d’heure en ce moment : +1h en Utah, -1h en Arizona… Bref, on est un peu décalés. Heureusement qu’on ne prête pas vraiment attention à l’heure.
On quitte Flagstaff où on a dormi et c’est parti ! Un peu avant d’arriver, nous rencontrons un troupeau de vaches qui traversent la route à leur rythme… Il ne vaut mieux pas être pressé !

Au loin, on voit déjà se dessiner la crête du Meteor Crater.
On arrive et on entre dans le bâtiment principal qui donne accès au cratère et qui abrite un musée.

On y est ! C’est impressionnant de voir l’envergure du cratère causé par l’impact d’un météore il y a 50 000 ans. On admire, on lit les indications pour en savoir plus, puis on fait le tour du musée. C’était une visite très intéressante (surtout après avoir vu l’exposition à Paris).
Au loin l’orage gronde et nous allons droit sur lui sur le chemin vers le Grand Canyon (Sud). On aimerait marcher sur la “Skywalk” : une passerelle transparente qui donne sur le vide. Personnellement, j’ai peur du vide… mais je l’aurais fait pour me surpasser et pour une petite dose d’adrénaline !
On arrive au Grand Canyon, on se gare et on va au Visitor Center. Là, on apprend que la passerelle en question se trouve en fait du côté Ouest, nous irons donc demain. On part pour une randonnée le long du canyon mais le chemin entièrement aménagé manque cruellement de naturel. On profite de la vue puis on s’éloigne pour trouver un chemin dans la forêt où les troupeaux de biches sont de sorti.
On tourne, on tourne et pas moyen de trouver de sentier pour une rando’. On décide alors de reprendre la route. On se trouve un motel à Seligman où on pose nos valises… Le MOTEL craignos par excellence… avec les chaises à l’extérieur, à côté des portes, les bruits étranges et les camés…
Bonne nuit !
Lundi 16 Juillet 2018
Réveil difficile après une nuit tourmentée par des voisins bruyants… les motels…
Bref, on se lève, on se prépare et on part à la recherche d’un endroit où prendre le petit déjeuner. “Denny’s” en vue ! Le pied ! On a trouvé notre QG ! Petit déj’ au top : oeufs brouillés, potatoes, pancakes bananes, fraises, myrtilles. Trop bon !
Après ce délicieux petit déjeuner, on prend la route direction le Grand Canyon West. Après 2h30 de route, on arrive sur une espèce de base aérienne. On entre dans une bulle géante genre quarantaine et on demande pour la “Skywalk” (en anglais en vrai).
— Bonjour, nous voudrions aller sur la “Skywalk” s’il vous plaît.
— Oui, bien sûr, c’est 71$. Vous prenez le bus et vous avez accès au “Skywalk”. C’est un package.

— Okay… mais on voudrait juste aller sur le “Skywalk”…
— Oui, c’est 71$. Si vous voulez juste le bus c’est 50$.
Whaaaaat ?! 71$ pour marcher sur cette passerelle ? No f**kin’ way! On fait un tour dans la boutique histoire de ne pas être venus pour rien, puis on met les voiles sur Las Vegas.
Après 2h de route, on voit la ville se dessiner à l’horizon. l’excitation nous gagne ! Vegas baby !
On y est ! On va à l’hôtel, on pose nos affaires dans notre suite royale située au 16ème étage avec vue sur le strip… 80€ la nuit… pourquoi s’en priver ? Puis on attend la nuit pour sortir.
21h, il est temps d’aller se dégourdir les jambes sur le strip. Petite parisienne que je suis je prends mon gilet parce que ça risque de se rafraîchir. On sort de l’hotel… chaleur monstrueuse ! Je regarde mon téléphone : 41° à Las Vegas… Ah oui, c’est vrai qu’on est en plein désert… La flemme de retraverser le casino, reprendre l’ascensceur pour déposer mon gilet dans la chambre, je l’accroche autour de ma taille et on se met en marche.
#gallery-0-16 { margin: auto; } #gallery-0-16 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-0-16 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-16 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
On arpente le strip qui brille de mille feux. On entre dans le Bellagio qui est magnifique ! On assiste à deux shows au niveau de la fontaine de l’hôtel. Magique !
Puis on va flamber un peu au casino : machines à sous, tables de jeux, tout est là sous nos yeux émerveillés. On se remémore le film “Ocean’s 11”. Nous sommes dans un autre monde.
#gallery-0-17 { margin: auto; } #gallery-0-17 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-0-17 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-17 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
On joue un peu puis on ressort découvrir le reste de l’extravagante Las Vegas : New-York, Paris, Rome… Autant de petits univers recréés à la perfection. On adore !
On se prend un smoothie, on retourne flamber un peu (les machines “The Walking Dead” nous ont piqué tous nos dollars…) puis on se pose dans un bar sympa avant de repartir.
2h du mat’, il est temps de rentrer à l’hôtel.
Jeudi 18 Juillet 2018
Réveil le lendemain d’un mariage parfait ! (Oui, tu as bien lu ! Et si tu lis encore mieux tu verras que j’ai sauté une journée 😉 )
On quitte la chambre et on file faire un tour dans le vieux Vegas qui est vraiment très sympa. On en profite pour faire un tour à la boutique Pawn Star, que tu as peut-être vu à la télé. Il nous arrive de regarder cette émission quand on part en festival et qu’on dort à l’hôtel.
Puis on découvre le Downtown de Vegas vraiment cool ! On arpente la rue principales, puis on met les voiles sur Needles.
On y découvre la Route 66 puis on continue vers Amboy où on s’arrête près d’un motel abandonné. Il y a également les restes d’une vieille école…

On part ensuite vers le Amboy crater, un cône d’origine volcanique. On s’aventure dans le désert entourés de roches noires volcaniques.
N’étant pas équipée pour gravir des montagnes – pourquoi j’ai mis mes ballerines ? – je décide de rester en bas dans un genre d’abribus et d’attendre Thib qui est parti escalader le volcan.

Nota bene : C’est moi dans cette boîte au milieu du désert volcanique…
Après cette balade, direction Barstow pour aller se reposer à l’hôtel.
On the road : Meteor Crater & Las Vegas Dimanche 15 Juillet 2018 Journée tranquille au programme. On a roulé jusqu’à 2h du matin pour s'avancer.
0 notes
Text









15 juillet
Encore un réveil matinal pour une visite que nous ne voulions pas manquer avant de quitter l’île de Java: le volcan Ijen. Nous renonçons au lever de minuit qui permet avec un peu de chance de voir ce que les locaux appellent ‘Blue fire’, autrement dit les fumerolles de soufre en pleine nuit qui revêtent une couleur bleue. Nous quittons notre Guesthouse à 4h en direction de l’entrée du parc de l’Ijen. Équipés de nos frontales et de nos masques, nous parcourons 3km et 500m de dénivelé en moins d’une heure sous un crachin persistant et dans une pénombre laissant vite apparaître les flancs verdoyants du volcan. L’accompagnateur local censé nous guider jusqu’au cratère du volcan se laisse vite distancer et nous abandonne après quelques centaines de mètres prétextant des maux aux genoux et un souffle perturbé. Nous découvrons les contours du cratère (2360m) sous un froid humide avant d’emprunter un sentier raide et glissant qui nous amène près d’un lac au bord duquel sont extraits les morceaux de soufre. Munis de masques à gaz, nous croisons des porteurs parfois pieds nus, exténués, détruits par leurs efforts physiques démesurés et l’inhalation du soufre. Ils transportent des blocs de roches jaunes dans des paniers en équilibre, positionnés aux extrémités d’une barre en bois, pesant jusqu’à 70kg, vendu 70ct le kilo! Chaque jour, ils effectuent 2 trajets (+500m/-200m/+200m/-500m par aller-retour). Rarement nous avons vu des hommes souffrir autant au travail et susciter autant la pitié et la compassion, mais aussi parfois, à notre stupéfaction, l’indifférence totale des visiteurs. Nous faisons finalement la descente dans le cratère accompagné d’un porteur de 39 ans qui, en raison de douleurs aux genoux et aux épaules, a dû réduire drastiquement ses heures d’intense labeur. L’expérience demeure tout de même unique et inoubliable. Tôt ou tard, espérons-le, ce gagne-pain n’existera probablement plus et sera remplacé par des machines. Nous redescendons sur le même versant du volcan jusqu’à Banyuwangi, par une route sinueuse bordée de villages et de champs où poussent clous de girofle, café, poivre ou encore hévéas. En fin de matinée, nous rejoignons le port de Ketapang d’où partent régulièrement des ferrys à destination de Bali. La traversée dure à peine une heure. Nous poursuivons directement pour la petite localité balnéaire de Pemuteran, prisée par les plongeurs et passons le reste de la journée au bord de la mer et de la piscine. Sur la plage de sable noir, nous assistons à la mise à l’eau d’une tortue qui s’est laissée piéger dans les filets d’un pêcheur local. L’hôtel est magnifique et nous profitons de cette pause bien méritée.
0 notes
Text
INDONÉSIE 🇮🇩 - JAVA
Dimanche 3 février 2019
Et on retourne à l’aéroport pour récupérer le paquet en provenance de France : Mary-Lou! Une fois n’est pas coutume, elle a une heure de retard mais c’est un bonheur de voir sa petite tête (plus blanche qu’un cachet d’aspirine). Nous avons malheureusement passé une grande partie de la journée à l’aéroport mais nous avons fini par décoller à 15h30 pour Surabaya où notre driver nous attendait pour 3h30 de route jusqu’au parc national de Bromo. Nous avons dîné dans un petit bouiboui local (pour 62 centimes à deux) avons dû foncer au lit puisque nous devons nous lever à 3h du matin.
Lundi 4 Février 2019
Bon ça pique mais nous n’avons pas regretté !! Nous avons pris une petite jeep rouge avec notre guide pour nous diriger vers le plus haut point de vue pour voir le lever de soleil sur le mont Bromo, le mont Batok et le mont Semihur. Le soleil s’est levé vers 5h15 du matin et nous a laissé sans voix. On a fait la rencontre d’un balinais qui nous a filé deux trois tips pour Bali puis nous avons repris notre jeep pour aller au pied du Mont Bromo et entreprendre l’ascension à 6h du matin. Le mont Bromo est toujours en activité donc nous avons pu voir pas mal de fumée et un cratère en activité assez exceptionnel !




S’en est suivi un petit dej à notre auberge puis 7h de route pour gagner Ijen (nous avons roupillé au moins 5h comme des bébés). Nous sommes arrivées à notre super hôtel avec piscine au milieu des rizières et nous avons fait la visite des alentours sous la pluie mais avec le sourire !


Mardi 5 février 2019
Le réveil sonne à 00h45 pour se préparer en vitesse (clairement pas réveillées du tout) avant de rejoindre notre chauffeur Harry qui nous emmène à l’entrée du parc du volcan pour rejoindre un guide local. Nous commençons à marcher vers 1h45 dans la nuit noire (mais alors bien noire) mais comme on avait la tenue technique, hop Mary Lou a sorti sa lampe frontale et nous avons gravi les montées assez raides durant la première partie pour arriver au sommet du volcan vers 3h30. Malheureusement pour nous, il y avait pas mal de fumées qui émanait du cratère mais nous avons réussi à convaincre notre guide de descendre dans le cratère pour essayer d’apercevoir les fameux blue fires (on dirait des flammes blue-violet assez impressionnant). Nous avons mis une heure à descendre les pentes glissantes dans le noir, nous arrêtant à plusieurs occasions pour laisser passer les mineurs qui remonter jusqu’à 80kgs de souffre sur les épaules ...
Le souffre est extrait du cratère et remonte pour être utilisé à des fins médicinales mais ce travail ressemble plus à une tâche inhumaine et éreintante, que peu de touristes semblent respecter. Bref, nous voilà arriver en bas, avec nos masques à gaz, et nous avons réussi à voir des blue fires sur une roche (bon petites mais tout de même !) et à observer tant bien que mal l’extraction du souffre par les mineurs.
Nous sommes remontés pour 5h, pour voir le lever du soleil sur le cratère et révéler le blue lake, un magnifique lac dans le cratère du volcan. Nous avons ensuite tout redescendu pour rejoindre Harry à 6h50, foncer à l’hôtel pour prendre un petit dej et surtout une douche et repartir direction Bali pour rejoindre Juliette !




0 notes
Photo


Monet on the Run - 19. Not there
This Hôtel des Roches Noires was the best of the best in Trouville in those days. Monet was impressed, and painted it in all its splendor during that summer of 1870.
But the Monets themselves had to settle for less. They found a room in the Hôtel Tivoli, a few streets away from the beach, where they stayed for about three months.
Claude Monet, L’Hôtel des Roches Noires à Trouville, 1870. Oil on canvas, 80 x 55 cm. Musée d’Orsay, Paris.
57 notes
·
View notes